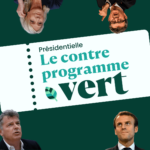Le talk chaud. Imaginé par les quatre ONG à l’origine de « l’Affaire du siècle » – Oxfam, Notre affaire à tous, la Fondation pour la nature et l’Homme et Greenpeace – le « débat du siècle » s’est tenu ce dimanche 13 mars sur la plateforme en ligne Twitch. Cinq des douze candidat·es à la présidentielle ont eu l’opportunité de présenter plus amplement leur vision de l’écologie.
« Nous méritons une discussion de fond pour savoir comment les candidat·es comptent sortir la France de l’illégalité climatique », annonçait l’Affaire du siècle en amont de ce « débat présidentiel 100 % consacré au climat ». En parallèle d’une pétition qui avait rassemblé quelque 2,3 millions de signataires, ces ONG sont parvenues à faire condamner l’État pour son inaction en la matière. Celui-ci doit désormais rattraper son retard sur ses propres objectifs (Vert). Après avoir essuyé le refus de plusieurs chaînes de télévision, la coalition a organisé ce débat avec le streamer politique Jean Massiet et la journaliste Paloma Moritz (Blast).
À lire aussi
Chaque candidat·e avait 30 minutes pour donner sa vision de l’écologie, et répondre aux questions des deux animateurs qui maîtrisaient, une fois n’est pas coutume, le fond des sujets. Parmi ceux-ci : les alertes du Giec, la neutralité carbone (ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que l’on peut en absorber), la prise en compte des limites planétaires, les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, la mobilité, le logement, le nucléaire ou l’agriculture. Plus de 20 000 personnes ont suivi les échanges qui ont duré près de trois heures. Un temps très court pour balayer autant de sujets.
Premier à ouvrir le bal de ce « grand oral », Yannick Jadot (EELV) a rappelé à quel point l’inaction climatique a des effets sur les plus précaires. Avec lui, la France adoptera le nouvel objectif européen de baisse des émissions (-55 % d’ici à 2030 par rapport au niveau de 1990, contre un objectif français de -40 % aujourd’hui). « Il faut dépasser le capitalisme, je veux une économie régulée écologiquement et socialement », a-t-il déclaré. Il a insisté sur les chantiers de la rénovation thermique, de l’agriculture et sur la nécessité de mettre en place un crime d’écocide avec une vraie police de l’environnement.
Rarement entendue sur ces questions, Valérie Pécresse (LR) s’est affichée pour une écologie « incitative » sans « interdits », mariant technologie et sobriété. Elle a vanté la réindustrialisation et le « protectionnisme écologique » tout autant que l’économie circulaire, avec un objectif de 100 % de recyclage en 2030 – sans détailler de quoi il retournait. Sur l’artificialisation des sols et la gestion des forêts, ses arbitrages seront effectués selon une « hiérarchie des priorités (économiques, NDLR) » qui paraît peu compatible avec sa volonté de protéger la biodiversité. Sa conception de la « croissance durable », semble difficilement conciliable avec les objectifs de réduction des émissions de CO2 de 55 % d’ici à 2030 qui imposent un changement rapide de trajectoire.
Connu pour certaines positions à rebours de la gauche sur l’écologie, le communiste Fabien Roussel a insisté sur le besoin d’agir vite en effectuant « une révolution fiscale, sociale, démocratique ». Il veut investir chaque année 140 milliards d’euros (6 % du PIB français) dans la transition écologique. Favorable au redéploiement du nucléaire, il souhaite rénover massivement les logements et relocaliser l’agriculture (surtout l’élevage). Face à l’envolée des prix, il veut baisser le tarif du carburant à la pompe pour aider les travailleur·euses dépendant·es de leur voiture. Il veut aussi une prime à la conversion sur les véhicules hybrides ou électriques, « si ça ne coûte pas une blinde à recharger ».
Philippe Poutou, candidat du Nouveau parti anticapitaliste, n’était pas initialement convié au débat et il a dû écourter son audition en raison d’un horaire de train à respecter. « Actuellement, on fait pire que l’inaction en matière d’écologie. Il faut rompre avec le capitalisme et sa logique productiviste », a-t-il rappelé en rendant hommage à l’ensemble des acteurs associatifs et syndicalistes engagés partout en France.
Anne Hidalgo, enfin, a misé sur son expérience de maire de Paris. « Mon volontarisme reste intact », a plaidé la candidate socialiste qui ne veut pas de nouvel investissement nucléaire (mais la prolongation de certaines centrales) et plaide pour une « écologie de la vie ». L’instauration d’un impôt sur la fortune (ISF) climatique financerait les efforts en matière de transport et de logement. Un nouveau Défenseur de l’environnement pourrait, à l’image du Défenseur des droits, faire valoir le crime d’écocide qu’elle veut imposer dans la législation.
Les candidat·es d’extrême droite n’étaient pas convié·es à ce débat. Quant à Emmanuel Macron, il n’a pas répondu aux sollicitations des organisateur·rices. Après avoir confirmé sa venue, Jean-Luc Mélenchon s’est décommandé : « Je me tiens à la disposition de l’Affaire du siècle pour un échange dans les mêmes conditions dès les prochains jours », a-t-il indiqué sur Twitter. « Dans une campagne présidentielle, tout est question de priorités », notait le soir même un·e membre de l’Affaire du siècle en déplorant ces absences. Pour l’équipe organisatrice, l’essentiel est de diffuser largement sur les réseaux la parole des candidat·e·s qui se sont prêté·es au jeu.
Vous pouvez retrouver l’ensemble du Débat du siècle dans la vidéo suivante :
À lire aussi
-
Demandez le contre-programme présidentiel de Vert !
En cette campagne qui continue de parler davantage d'immigration et de sécurité que des crises qui vont bouleverser nos existences, Vert veut remettre le climat et la biodiversité à l’agenda politique. -
La rénovation thermique des logements : un chantier nécessaire pour le climat, la justice sociale et contre le gaz russe
La guerre en Ukraine nous contraint à réduire notre consommation d'énergie pour tourner le dos aux hydrocarbures russes. Pour cela, il existe un remède, qui sert à la fois le climat et la justice sociale : la rénovation thermique du parc immobilier. Malheureusement, la France est très en retard sur ce chantier et seule une poignée de candidat·es à la présidentielle semblent en saisir les enjeux. -
Et si l’on donnait de vrais droits au vivant ?
Venue d'Amérique latine, l'idée de donner des droits au vivant peine encore à s'établir pleinement en France. Voilà qui nous permettrait pourtant de décoloniser notre rapport à l’environnement et changer la manière dont on s’en (pré-)occupe. Tour d’horizon des outils juridiques à notre disposition.