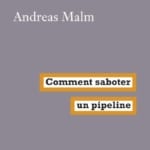Spécialiste de la gouvernance du climat et des migrations, directeur de l’Observatoire Hugo à l’université de Liège, enseignant à Sciences-Po, François Gemenne est membre du groupe 2 du Giec, qui étudie la vulnérabilité et l’adaptation de nos sociétés aux effets du changement climatique. A Vert, il livre sa vision des points saillants du rapport publié ce lundi et sa perception de l’engagement des scientifiques dans le débat public et la politique.
Le groupe 2 du Giec a pour vocation de réunir les dernières connaissances scientifiques en matière d’adaptation au changement climatique. Quels éclairages apporte cette nouvelle synthèse par rapport à l’édition précédente, parue en 2014 ?
Une attention particulière a été portée sur les inégalités et la justice sociale. Ce nouveau rapport insiste sur la manière dont les inégalités démultiplient les effets du changement climatique. C’est un vrai cercle vicieux : une société plus inégalitaire, par les réponses qu’elle apporte aux effets du changement climatique – souvent plus adaptées aux plus riches –, peut accroître les inégalités et ainsi être plus vulnérable aux effets du changement climatique.
La notion de « social tipping point », ou seuil de rupture sociale, est également un mécanisme mis en avant dans cette synthèse. Il montre à quel point les phénomènes climatiques ont des effets sociaux qui varient de manière non proportionnelle à l’impact climatique. Deux ouragans de même ampleur vont engendrer un nombre de morts et de dégâts matériels fort différent selon qu’ils ont lieu au Bangladesh (ouragan Sidr) ou au Myanmar (ouragan Nargis) où le régime autoritaire n’a pas prévenu les populations ni organisé leur évacuation. Idem pour les effets d’une hausse des températures sur le prix du pain et le renversement de régime au Soudan, ou alors la famine actuelle à Madagascar.
Dans cette nouvelle synthèse, on quantifie aussi plus finement les impacts : auparavant, les corrélations entre la hausse de la température et les risques engendrés étaient plus vagues. Cette fois, nous avons travaillé de manière plus systémique, avec des modèles qui évaluent la manière dont les risques et les impacts se renforcent mutuellement, par des effets de force cumulative.

Cela signifie que les connaissances scientifiques permettent aujourd’hui d’identifier plus finement le rôle des processus sociaux et politiques dans l’adaptation au changement climatique ?
Dans le chapitre 8, auquel j’ai contribué, on montre en effet que les impacts du changement climatique peuvent stopper le développement de certains pays – voire même leur faire perdre certains acquis. Les données socio-économiques permettent de mesurer les impacts d’une hausse de température sur le volume des récoltes, puis sur la perte de PIB de certains pays et le million de gens qui retombent alors dans la pauvreté…
« L’ampleur de la famine dépend bien davantage de processus politiques d’adaptation et de résilience que de l’impact du changement climatique lui-même »
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on ne peut pas parler de « famine climatique » ou de « conflit climatique » en tant que tels : ces processus sont politiques par nature, ils découlent d’un système d’attributions et d’allocation des ressources et des moyens. La faible capacité d’adaptation de certains pays est telle que certains impacts, même limités, du changement climatique vont provoquer des changements importants. Ainsi, l’ampleur de la famine dépend bien davantage de processus politiques d’adaptation et de résilience que de l’impact du changement climatique lui-même.
Comment se fait-il que l’on soit désormais plus attentifs à ces dimensions ?
Parce que nous sommes face à un fait social qui se mesure mieux, mais aussi parce que le Giec a renouvelé son équipe de chercheurs : un certain nombre d’anciens sont partis, remplacés par des chercheurs plus sensibles à ces dimensions sociales. Ils sont plus jeunes, il y a plus de femmes et les chercheurs issus des sciences sociales ne mesurent pas les liens de cause à effet de manière mécanique comme le font les climatologues. Les approches de l’adaptation sont donc beaucoup plus variées. On ne se concentre plus seulement sur les infrastructures de l’adaptation – il faut faire des digues, des barrages, etc. – pour aborder des dimensions plus sociales : préparer l’alerte précoce des populations, avoir des plans d’évacuation clairs, etc.
Est-ce que cela permet de mieux chiffrer les efforts financiers à fournir, notamment pour le Fonds vert pour le climat, ces « 100 milliards de dollars par an » promis par les pays riches aux pays en développement pour financer leur adaptation aux effets du réchauffement climatique ?
Le rapport évoque cette question, mais sans la chiffrer outre mesure : il s’agit d’une question politique, et le Giec a tendance à évacuer les questions de migrations, de paix et sécurité par crainte que cela bloque l’approbation. Les débats entre auteurs sont nombreux en interne pour savoir si ces questions doivent être plus visibles.
La question de l’adaptation des pays du Sud n’a pas fait partie des sujets prioritaires lors de la COP26 à Glasgow en décembre dernier…
Bien souvent, l’adaptation passe au second plan dans les négociations internationales : cela nourrit fortement le ressentiment des pays du Sud qui voient bien que les pays du Nord ne tiennent pas leurs engagements en matière de baisse des émissions et ne donnent pas plus de moyens pour l’adaptation. L’argent du Fonds vert, de surcroît, ne correspond pas à des financements additionnels, mais à un réétiquetage de financements déjà existants, que les pays du Nord veulent, en plus, fournir sous forme de prêt plutôt que sous forme de don. Autant sur la question des investissements pour réduire les émissions, les pays du Nord se disent que cela peut être rentable, autant sur l’adaptation, c’est de l’investissement à fonds perdu !
À lire aussi
Est ce que le droit international est adapté pour gérer la question des migrations et des déplacements internes de populations liés au climat ?
Je ne crois pas du tout, malheureusement, que le droit international puisse arriver à un quelconque résultat. Même la convention de Genève [relative aux droits des réfugié·es, Ndlr] n’est pas respectée, et je crois que c’est un fantasme occidental d’imaginer que le droit international peut être encore supérieur au droit national. Dans la réalité des faits, ce n’est pas le cas.
Aujourd’hui par exemple, pour essayer de protéger les droits des déplacés, il est plus efficace de travailler directement avec les gouvernements pour voir ce qui peut être fait au niveau local ou régional. Prenez les États d’Afrique de l’Est qui, il y a deux ans, ont mis en place un protocole de libre circulation – notamment pour éviter les problèmes entre bergers nomades et éleveurs sédentaires au Nigeria, au bord du lac Tchad ou dans le nord du Burkina Faso. Cela a permis des avancées réelles.
Ces dernières années pourtant, plusieurs États ont été attaqués pour leur inaction climatique…
En effet, il y a plein de litiges climatiques et d’« affaires du siècle » dans plein d’États [aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique ou en France, Ndlr] mais ce sont à chaque fois des procès intentés par les citoyens d’un pays contre leur propre gouvernement. Aucun État n’a encore porté plainte contre un autre alors que la Cour de justice internationale pourrait potentiellement accueillir ce type de procès. Il faut du courage pour cela ! Tuvalu a essayé, en 2002, contre les États-Unis et l’Australie qui n’avaient pas ratifié le protocole de Kyoto : Tuvalu voulait les attaquer en justice pour violation d’intégrité territoriale, mais on l’a menacé de faire cesser les aides internationales. Diplomatiquement, l’outil du droit est compliqué à utiliser et peut même nuire à l’aboutissement des négociations internationales.
On entend souvent dire que le coût de l’inaction sera supérieur à celui de l’action. Est-ce une bonne idée de raisonner en termes de coûts ? Ne faut-il pas changer de paradigme ?
Les ordres de grandeur n’ont pas changé depuis le rapport Stern sur l’économie du changement climatique [commandé par le gouvernement du Royaume-Uni à l’économiste Nicholas Stern en 2006, Nldr], qui était l’un des premiers à avoir une approche en termes de coûts. Le souci est qu’il est compliqué d’avoir une approche rationnelle : comment comparer des coûts immédiats à des coûts futurs ? N’est-on pas toutes et tous pareils, à attendre le dernier moment pour payer nos factures ? N’est-il pas logique que les États fassent de même, surtout quand ils sont en difficulté budgétaire, à court d’argent et de liquidité ?
« Je crois ainsi qu’on aurait intérêt à remettre en avant les questions morales : les États peuvent agir sur la base de fondamentaux moraux, et pas uniquement sur la base de calculs économiques. »
Sans parler des enjeux liés à cette approche par coûts et préjudices : comment quantifier le coût d’une migration ? Ou la perte d’une culture traditionnelle ? Le traumatisme d’un événement climatique ? Tout l’enjeu de la négociation est aussi d’arriver à quantifier les impacts non-matériels, ou en tout cas non-monétaires, du changement climatique. Je crois ainsi qu’on aurait intérêt à remettre en avant les questions morales : les États peuvent agir sur la base de fondamentaux moraux, et pas uniquement sur la base de calculs économiques. Ils le font déjà très bien d’ailleurs, quand il s’agit des frontières : économiquement, une frontière coûte cher, cela entraîne des phénomènes de passeurs, etc. Mais les arguments économiques ne passent pas, il y a un mur idéologique sur le sujet.
En France, la candidate LR Valérie Pécresse s’est engouffrée dans le « grand remplacement ». Globalement, la droite et l’extrême droite font campagne contre l’immigration, sans avoir de programme ambitieux sur le climat, dont le réchauffement risque d’aggraver le phénomène. Ce camp ne scie-t-il pas la branche sur laquelle il est assis ?
Si l’extrême droite est à ce point hostile aux questions d’immigration, il faudrait absolument qu’elle ait un programme béton sur le changement climatique, mais ce n’est pas le cas !
Sur ce sujet, il y a un problème de narratif et d’imaginaire : on essaye d’utiliser cet argument migratoire et ce prétexte d’invasion massive pour essayer de convaincre les États de changer leurs pratiques vis-à-vis du changement climatique. Je pense que c’est une erreur : ce faisant, on accrédite l’idée que la migration doit être perçue comme une menace, comme une crise à redouter, mais cela peut renforcer des aprioris et des politiques très restrictives en terme d’immigration aujourd’hui.
La réaction logique de nombreux États en termes d’immigration n’est pas de réduire les émissions, mais de construire des murs aux frontières. Donc cet argument, souvent utilisé par des militants du climat avec les meilleures intentions du monde peut aller contre l’action qu’on souhaiterait susciter. Qui plus est, l’immigration d’aujourd’hui n’a rien à voir avec celle que nous aurons dans 20 ou 30 ans…
Vous avez toujours été engagé en politique, et depuis quelques mois vous conseillez l’équipe de Yannick Jadot, candidat EELV à la présidentielle française. Pourquoi l’avez-vous rejoint ?
Deux raisons essentielles m’ont poussé à le faire : l’urgence de la situation est telle qu’il est de mon devoir, en tant que scientifique, de prendre parti. Jadot m’a sollicité et j’ai accepté. Peut-être que si Taubira ou Hidalgo me l’avaient proposé, je l’aurais fait aussi. Mais quand on regarde les programmes, sur les questions de climat d’une part, et sur les questions d’asile et d’immigration de l’autre, il me semble que la ligne portée par les écologistes est la plus adaptée. Cela ne veut pas dire que je suis une groupie de Yannick Jadot ni que les autres ne proposent pas des choses intéressantes, mais les solutions qu’il affiche pour la France me semblent les plus souhaitables – à la différence de Mélenchon dont le programme, sur les questions internationales, l’asile et l’immigration, me pose problème.
On reproche à Jadot de porter une écologie peu sexy, avec des mesures guère enthousiasmantes… que répondez-vous à ces remarques ?
Je ne suis pas sûr qu’on arrive à rendre ces propositions plus convaincantes : on a mis en avant des gens radicaux, puis des gens plus lisses, on a mis des gens clivants, d’autres plus rassurants ou plus excités… On a tenté plein de choses et, à force, j’en conclus qu’il n’est pas possible d’atteindre une majorité démocratique. Pour se donner une chance d’y arriver, il faut le faire via la mobilisation de quelques-uns, à l’image de la lutte pour l’égalité raciale aux États-Unis : les noirs ont su trouver des relais et des appuis chez les blancs, mais ce n’est pas parce qu’ils sont devenus majoritaires, qu’ils ont réussi. C’est parce qu’ils ont réussi à mobiliser un noyau dur très déterminé qui a embarqué ensuite le pays pour faire basculer les choses et obtenir la reconnaissance de certains droits.
Donc il faut peut-être réfléchir à un changement de stratégie : nous ne manquons pas de réflexion, nous essayons de les intégrer pour cesser de passer pour une gauche trop intello, éloignée des classes populaires… On a fait plein de choses pour expliquer que les plus défavorisés allaient être les plus directement touchés [par la crise climatique, Nldr], mais si les classes populaires estiment que l’extrême droite défendra mieux leurs intérêts que l’écologie politique, à un moment on ne peut plus rien faire : c’est leur responsabilité individuelle.
« Je considère aussi que les chercheurs ont une grande responsabilité : leur frilosité politique me surprend toujours autant et leur refus de s’engager me met très en colère. »
Je considère aussi que les chercheurs ont une grande responsabilité : leur frilosité politique me surprend toujours autant, leur désir de rester au balcon et leur refus de s’engager – comme si le débat public était sale ou comme si cela allait nuire à leur neutralité ou leur carrière – me met très en colère. La tribune des 1 400 chercheurs qui en appellent à ce qu’on parle plus de changement climatique dans la campagne m’a profondément énervé. Ce qui compte, ce sont les actions que les gouvernements vont acter au final. À se comporter comme si le climat n’était ni de droite ni de gauche, ou que les candidats étaient pareils tant qu’ils parlent du climat, on devient complice de l’immobilisme et de l’inaction. Je suis exaspéré de la posture des chercheurs qui font « ouin ouin, on nous écoute pas », qui brandissent Don’t look up et ne font rien pour se faire écouter : quand on leur propose de rencontrer un candidat, de contribuer au programme et qu’ils ne veulent pas se mouiller, il ne faut pas se plaindre de ne pas être écouté. C’est trop facile d’être dans la posture de lanceurs d’alerte, de crier au feu plutôt que d’appeler le pompier. Et cette question, dans le fond, se pose aussi pour le Giec : sa posture est-elle encore tenable aujourd’hui ? Que va-t-on faire après ce 6ème rapport ? Un 7ème, un 8ème, un 9ème ? Quand allons-nous inciter plus largement à l’action politique ? Pourquoi ne pas initier des rapports thématiques sur des sujets controversés dans le débat public, comme la géo-ingénierie par exemple ?
Demain, imaginons que vous soyez aux manettes, quelles mesures prioritaires lanceriez-vous ?
Petite précision à vos lecteurs : je ne serai jamais aux manettes en France, car je ne suis pas français, et donc je soutiens un candidat pour lequel je ne peux pas voter. Comme je milite pour que le droit de vote soit effectué selon le lieu de résidence plutôt que la nationalité, je me tirerai une balle dans le pied de mon propre argument si je me faisais naturaliser (rires) !
Ceci étant, ma priorité serait assurément de signer la fin des subsides aux énergies fossiles : on arrivera à rien tant qu’on aura une telle déformation du marché en faveur des énergies fossiles. On a beau accuser le capitalisme, le marché public est biaisé par les subventions aux énergies fossiles, il faut changer la finance climat, mettre les banques et la finance autour de la table pour changer la donne car ce levier n’a clairement pas été assez mobilisé.
À lire aussi
Ma seconde mesure, moins essentielle et pourtant cruciale, serait d’assurer les transferts de technologie : nous sommes tellement obnubilés par l’idée de réduire nos propres émissions que nous ne réfléchissons pas assez à l’échelle globale. Si on estime que les EPR [les réacteurs nucléaires à eau pressurisée, comme celui en construction à Flamanville, Ndlr] sont une solution fiable et idéale – ce que je ne crois pas –, ce n’est pas en France qu’il faut les implanter, mais dans des pays qui sont en train de choisir s’ils vont dans une voie fossile ou s’ils vont vers autre chose. Sans aide de notre part, ils vont aller vers le plus simple, le moins cher et ce qui pollue le plus. Derrière cette idée, il s’agit de bien comprendre l’enjeu : engager la baisse des émissions de gaz à effet de serre dans le monde entier, et pas seulement celles de son pays.
Faut-il saboter les pipelines, comme le suggère le chercheur activiste Andreas Malm, pour aller plus vite et plus loin ?
Ça peut être utile : les actions directes, portées par la société civile, peuvent être une forme de réaction pour répondre à une impuissance et réparer certaines formes d’injustice.
Certains de mes étudiants sont très engagés, mais ne voteront pas : ils ne veulent pas être complices de ce qu’ils perçoivent comme une mascarade inutile pour affronter défis du 21ème siècle. Hélas, il y a une vraie crise de la démocratie participative qu’on ne résoudra pas sans se poser de questions sur la crise de la démocratie représentative…
À lire aussi
-
Andreas Malm : « L’extrême droite voit des minarets dans les éoliennes »
Dans un entretien accordé à Vert, le géographe suédois Andreas Malm détricote l'amour de l'extrême droite pour les énergies fossiles et prône une plus grande radicalité du mouvement écologiste pour lutter contre la crise climatique. -
Comment saboter un pipeline
Trop tièdes pour le climat. Dans son essai « Comment saboter un pipeline », le géographe suédois Andreas Malm propose de hausser le ton dans la lutte contre le changement climatique.