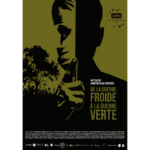Marches pour le climat, manifestations anti-mégabassines, quête du loup gris : Vincent Verzat connaît toutes les facettes du mouvement écologiste. Le vidéaste engagé, connu sous le nom «Partager c’est sympa» sur Youtube, filme depuis 2015 les ravages des bouleversements écologiques… et les personnes qui entrent en résistance. Il sort ce jeudi 6 novembre un documentaire intitulé Le vivant qui se défend.

En libre accès sur Youtube, le film a donné lieu à 370 projections auto-organisées dans toute la France. Vincent Verzat revient sur la lutte anti-mégabassines à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) ou celle contre l’autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Et il retrace son cheminement vers une autre forme d’engagement : la contemplation du monde sauvage. Toujours armé de son incontournable casquette bleu-jaune, le youtubeur revient pour Vert sur dix ans de combats.
Cela fait une décennie que vous couvrez les mobilisations écologistes. Comment le mouvement climat a-t-il évolué ?
À chaque victoire, nous faisons face à de très mauvais perdants, qui changent les règles du jeu. Nous avons dû nous réinventer et passer par plein de phases. Au début, il y a eu la grande mobilisation autour de la COP21, où les États ont fait miroiter qu’ils allaient enfin s’y mettre. [Le 21ème sommet mondial sur le climat, en 2015, a abouti à la signature de l’Accord de Paris. Celui-ci vise à limiter le réchauffement climatique à +2°C d’ici à 2100 par rapport à l’ère préindustrielle (milieu du 19ème siècle) – et si possible +1,5°C, NDLR]. Mais mon militantisme a commencé dans la branche désobéissante de ce mouvement, avec le réseau ANV-COP21 ou l’ONG les Amis de la Terre : nous souhaitions accompagner une transition du pays… et nous savions qu’il allait falloir un rapport de force.
Je suis très fier d’avoir raconté et questionné ces changements. Ma vidéo «On s’est planté…» [en 2019, NDLR] a trouvé un écho dans le monde militant. Je demandais si les marches climat allaient nous permettre de remporter les victoires espérées : ne faudrait-il pas un mouvement plus ancré dans des territoires, prêt à mener des actions – y compris de destruction de biens matériels – lorsque des chantiers avancent malgré tout ?
Aujourd’hui, cela existe avec Les Soulèvements de la Terre. C’est un mouvement de masse, qui peut rassembler plus de 20 000 personnes, et qui est partout sur les territoires. Il assume un niveau de conflictualité qui va jusqu’à casser des machines qui détruisent le vivant.
Maintenant, j’ai l’impression de vivre une fin de cycle avec ce film, qui boucle dix années de militantisme. Je suis très curieux de voir ce que l’on inventera pour la suite.
Vous avez commencé vos vidéos en 2015, au moment de la vague d’espoir portée par l’Accord de Paris. Son premier objectif – limiter le réchauffement climatique à +1,5°C – semble hors d’atteinte. Toutes ces mobilisations n’ont-elles servi à rien ?
Qui peut dire où l’on en serait sans ces mobilisations ? La situation serait bien pire. Les scientifiques nous le disent : il y a une différence majeure entre un monde à +1,5°C et un monde à +3°C, et ces différences se jouent en centaines de millions de vies humaines et non humaines.

Nos mobilisations ont entraîné des victoires, c’est l’association Terres de luttes qui nous l’apprend : entre 2014 et 2024, les combats locaux ont été victorieux 162 fois ! Toutes nos luttes ont changé le pays et les histoires qui sont racontées. Même les batailles que nous sommes en train de perdre, comme celle de l’autoroute A69, nous ont permis de déployer des récits qui n’existaient pas avant. On ne parlait pas de la route comme on en parle aujourd’hui : il y a seulement dix ans, c’était rarissime de la voir comme un problème.
De toutes les manifestations que vous avez couvertes, quelle est celle qui vous a le plus marquée ?
Il y en a tellement ! Je retiendrai d’abord le blocage du sommet du pétrole offshore à Pau (Pyrénées-Atlantiques), en 2016. Pour l’avoir vécu dans les coulisses, c’était ultra-ambitieux et peu de personnes pensaient qu’on y arriverait. Pourtant, pendant trois jours, nous avons empêché le bon déroulement de cette grand-messe des foreurs de pétrole, qui se tenait quelques mois après la COP21. J’ai ressenti la puissance du collectif, du travail d’information en amont, et notre formidable ingéniosité.
«Nous nous sommes retrouvés face à un mur de policiers et de grenades qui ont traumatisé énormément de militants.»
Nous avons tout fait pendant ce blocage : activer les sirènes de leur hôtel, craquer des boules puantes dans le centre du congrès, empêcher la nourriture d’arriver, bloquer l’endroit de telle sorte que les gazages de la police atteignent aussi les participants du congrès…
Un deuxième exemple, c’est Sainte-Soline. Au milieu de la pampa de Charente-Maritime, 20 000 personnes se sont retrouvées avec une détermination de fer pour un acte fondamentalement symbolique : faire une chaîne humaine sur la mégabassine – même si l’envie était aussi de démonter quelques pompes (notre reportage). Nous nous sommes retrouvés face à un mur de policiers et de grenades qui ont traumatisé énormément de militants.

Dans mon film, j’ai tenu à raconter à quel point cette résistance a fait peur et a été remarquée par le pouvoir. C’est bien pour cela que, dès le lendemain, Gérald Darmanin [le ministre de l’intérieur de l’époque, NDLR] a cherché à dissoudre Les Soulèvements de la Terre (notre article).
Dans votre nouveau documentaire, vous parlez beaucoup de l’épuisement militant. De quoi s’agit-il ?
C’est le moment où l’on perd de vue la grande histoire et où l’on se laisse toucher, voire abattre, par nos petites défaites. C’est aussi le moment où l’on perd la clarté de ce qu’est la part de responsabilité qui nous incombe.
On vit personnellement comme un échec le fait que telle mégabassine soit construite ou que telle coupe ait lieu dans une forêt. C’est une erreur : ce n’est pas nous qui menons ces constructions, ou qui coupons ces arbres. Nous avons cherché à l’empêcher, et nous l’avons fait sur notre temps libre, bénévolement. Dans ces moments-là, il faut célébrer le rôle qu’on a joué et ne pas s’en vouloir d’avoir échoué, car tout joue contre nous.
Dans ce film, vous racontez aussi l’échappatoire que vous avez trouvée ces dernières années : partir dans la nature pour filmer la faune sauvage et vous reconnecter au vivant. Comment en êtes-vous venu à passer du militantisme au naturalisme ?
Je suis parti dans des friches industrielles en milieu périurbain. À cause des contraintes du milieu, ces espaces sont très peuplés, avec beaucoup de terriers. J’ai cherché à repeupler mon monde de ses habitants, en m’intéressant à ce qui vit dans ces interstices.
Cela m’a apporté beaucoup d’émerveillement et d’apaisement. Mais aussi beaucoup de tristesse et de douleur : pour la première fois, j’ai pleuré la perte d’un animal sauvage. Je ne pensais pas que cela m’arriverait un jour.

Cette expérience m’a aussi réancré dans le réel, dans un réel qui intègre aussi la manière de vivre et les espoirs que j’ai pour ces animaux sauvages. J’ai regardé différemment mes luttes, comme celle contre l’A69 : aujourd’hui, on peut considérer que c’est une défaite à partir du moment où une pelleteuse arrive sur une terre agricole. Mais tant qu’aucune voiture ne roule à 130km/h sur ce truc, ce n’est pas la barrière infranchissable que cela risque de devenir. Tout le temps qu’on leur a fait perdre – et Dieu sait qu’on leur en a fait perdre ! –, c’est autant de vies animales qui ont été sauvées.
Quelle est la rencontre animale qui vous a le plus marquée ?
Évidemment, celle avec un blaireau. En général, les gens se marrent quand je leur dis, mais j’aimerais réhabiliter cet animal. Pour avoir passé beaucoup de temps avec eux, j’ai halluciné de voir à quel point ces animaux sont beaux, propres et tendres les uns avec les autres. C’est aussi une espèce ingénieure : ils créent de l’habitat pour tout le monde.

À mes débuts, la quête de cet animal, qui sort souvent à la tombée du jour et a plusieurs lieux de vie, a été ultra-intense. Cette longue attente s’est vue récompensée par une simple observation : j’avais le cœur qui battait à mille à l’heure. C’était l’équivalent du moment où tu es sur le point d’embrasser quelqu’un pour la première fois. J’ai été touché de voir que je pouvais vivre de telles émotions sans être dans un rapport tactile, sans caresser l’animal, qui ne m’a même pas vu [le blaireau a une très mauvaise vue, NDLR].
Qu’est-ce que le mouvement écologiste gagnerait à se reconnecter à la biodiversité qui nous entoure ?
Je pense qu’on y gagnerait d’abord un ancrage de nos luttes. Quand j’ai accompagné des Naturalistes des terres [un réseau de naturalistes qui veulent aider les mobilisations écologistes locales, NDLR] sur la lutte des Sucs [en Haute-Loire] pour empêcher qu’une route traverse un territoire magnifique, ils s’intéressaient mètre carré par mètre carré à ces espaces et trouvaient chacun valable et utile à préserver.
À lire aussi
Ensuite, je pense que le fait de se dire qu’on ne fait pas cela uniquement pour nous, que nous sommes reliés à d’autres destins que les nôtres, cela nous aidera à traverser cette époque. Des animaux sauvages sont déjà des emblèmes de nos luttes : à Sainte-Soline on avait la loutre et l’outarde. Mais quand nous étions là-bas, je ne suis pas sûr que nous avions vraiment conscience que nous luttions aussi pour ces individus. Notre lutte pourrait avoir encore plus de sens. Dans les combats contre les entrepôts ou les fermes-usines, il faudrait pister ce qui vit dans ces espaces et qui y palpite.
Quel conseil pouvez-vous donner à une personne qui aurait envie de se lancer dans le naturalisme ?
On peut d’abord trouver de super conseils auprès des associations naturalistes, qui sont vraiment les expertes de la nature. Il y en a partout en France, et certaines existent depuis plus d’un siècle sur les territoires : la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), France nature environnement (FNE), les Centres permanents d’initiatives pour l’environnement (CPIE)… Ils organisent par exemple des sorties, ça peut être une super piste.

Après, il y a aussi la série de vidéos YouTube sur mon apprentissage. Par exemple, erreur à ne pas faire : mettre davantage d’énergie à avoir des habits peu voyants, plutôt qu’à m’interroger sur le sens du vent.
Je sais aussi que les naturalistes recommandent souvent de commencer par les oiseaux, c’est plus accessible que les mammifères, même si je trouve ça moins fun. Dernier conseil : acheter une paire de jumelles. On ne peut pas s’émerveiller de la faune sauvage sans la voir de très près, c’est là que se révèlent ses couleurs, ses miroitements et ses textures.
À lire aussi
-
«C’était une boucherie» : deux ans après la manifestation de Sainte-Soline, les militants antibassines tentent de se reconstruire
Eau des espoirs. Pour commémorer les deux ans de la manifestation violemment réprimée contre la mégabassine de Sainte-Soline, des militant·es ont reconstruit un monument de pierres en mémoire des deux cents blessé·es à Melle. Là-bas se trouvait la base arrière qui a recueilli les colères et traumas de cette journée décisive de la lutte contre ces projets de stockage d’eau. -
«De la Guerre froide à la guerre verte», un documentaire au cœur de «la République du soja» remporte le prix Empreinte du festival Pariscience
Ce documentaire d’Anna Recalde Miranda vient de remporter le prix Empreinte, consacré aux films qui traitent des enjeux climatiques et environnementaux. Dans un récit intime et politique très tendu, la réalisatrice montre l’une des conséquences de la dictature au Paraguay : des millions d’hectares destinés à la culture intensive du soja, aux mains des soutiens de ce régime ultra-violent.