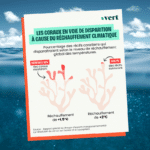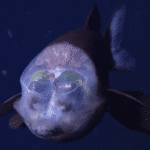En visitant l’étang de Thau, à 30 minutes de route de Montpellier (Hérault), il est de coutume de s’arrêter dans l’un des 500 élevages de coquillages locaux, qui détiennent parfois un petit restaurant au bord de l’eau. On y déguste des moules gratinées ou des huîtres à seulement quelques centaines de mètres des cadres de bois où elles sont élevées. Et, à l’ombre des parasols en roseaux de Camargue, on écoute le producteur parler des secrets de l’étang.

«Vous voyez cette bande de terre, au loin, qui nous sépare de la Méditerranée ? Elle nous protège des aléas de la mer et des prédateurs naturels des coquillages, tout en laissant entrer l’eau salée et le plancton qui nourrissent les moules et les huîtres», explique Laurent Arcella. Ce conchyliculteur – le nom donné aux personnes qui élèvent des coquillages – travaille depuis 25 ans à Loupian (Hérault), où il a repris l’exploitation de son grand-père.
«Ce qui rend l’étang de Thau vraiment unique, c’est sa profondeur, souligne-t-il. Plus de dix mètres par endroits, c’est parfait.» Voilà pourquoi ce plan d’eau de 19 kilomètres de long sur cinq de large concentre 80% de la production de coquillages français en Méditerranée.
Du paradis à l’enfer
Mais comme beaucoup d’éleveur·ses, Laurent Arcella garde en permanence un regard anxieux. Il sait que le réchauffement climatique transforme ce paradis pour l’élevage… en enfer maritime. «Cette année, on a évité de peu un désastre», souffle-t-il. L’immense canicule qui a frappé toute la France au début de l’été a fait grimper la température de l’eau du bassin jusqu’à 27,6 degrés (°C) le 7 juillet. «Au-delà de 28°C, toutes les moules meurent», explique-t-il. Sans même atteindre ce seuil fatidique, des chaleurs trop importantes peuvent entraîner un phénomène de malaïgue, «mauvaise eau» en occitan : une perte d’oxygène brutale dans l’eau qui asphyxie tous les coquillages.
«Début juillet, j’ai vu le rivage devenir tout blanc. C’est l’un des symptômes de l’apparition de la malaïgue [la couleur pouvant venir de la prolifération massive de bactéries qui survivent sans oxygène, NDLR]. Heureusement, un coup de vent a mis fin au phénomène sans qu’il n’y ait eu de dommages», se souvient Laurent Arcella. Par précaution, depuis quelques années, il sort de l’eau toute sa production de moules dès la fin juin. Le souvenir de 2018, quand une canicule marine a tué la quasi-totalité des moules de l’étang (1 200 tonnes) et plus d’un tiers des huîtres (2 700 tonnes), est toujours vif.
Plus aucune moule d’ici à 2050
«Malheureusement, les conchyliculteurs de l’étang de Thau ne sont qu’au début de leurs peines», s’inquiète Frédéric Gazeau, biogéochimiste et directeur du laboratoire océanographique de Villefranche-sur-mer (Alpes-Maritimes). Pendant un an et demi, ce scientifique a déposé un caisson expérimental rempli d’huîtres et de moules dans la lagune. En faisant varier la température et l’acidité de l’eau pour tester des scénarios probables pour 2050, 2075 et 2100, il a essayé d’anticiper l’impact du réchauffement climatique.
«Pour les moules, dès 2050, la culture dans l’étang de Thau sera sûrement impossible, car les canicules marines vont s’intensifier. Ce sont des organismes très sensibles et, dès juin, elles commenceront à mourir. Puis, il faudra les sortir en mai. Économiquement, c’est inconcevable, détaille Frédéric Gazeau. Les huîtres sont beaucoup plus résistantes, on observe “seulement” une baisse de production de 40% en 2100 – ce qui est déjà énorme.»
Conserver son patrimoine écologique et culinaire
Tout un patrimoine local est en danger, en plus de 2 000 emplois directs sur le territoire. «La conchyliculture est au cœur de notre identité et, si elle est affectée, le tourisme le sera aussi», confirme Loïc Linares, président de Sète Agglopôle Méditerranée, l’agglomération qui regroupe toutes les communes autour de l’étang. En 2024, huit millions de personnes à la journée ont visité le bassin de Thau, selon Hérault tourisme, dont un tiers venant de l’étranger. La préservation de cette activité traditionnelle est donc un enjeu écologique… et économique, avec quelques victoires ces dernières années.

Selon une étude de l’Ifremer (l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer) publiée en 2020, les travaux de restauration écologique de l’étang entrepris dans les années 2000 ont été efficaces. En réduisant en amont les rejets de phosphate et d’azote, la qualité de l’eau est revenue aux standards d’il y a 50 ans, avant les pollutions humaines massives. En quelques années, les risques de malaïgues ont chuté malgré le réchauffement de l’eau. «On voit qu’on obtient des résultats. Mais, quoi qu’on fasse, les dégâts du changement climatique seront dévastateurs, et on n’a aucune prise sur ce paramètre», explique Loïc Linares.
Faut-il retourner en mer ?
L’heure est donc à l’adaptation et à la reconversion de toute une filière. Avec 100 autres conchyliculteur·ices de Méditerranée, Laurent Arcella vient de créer une coopérative, sur le modèle agricole, dont il est aussi président. «Nous manquions d’une structure qui nous permette d’agir de concert, ou même de toucher des subventions européennes pour nous adapter», détaille-t-il.
La coopérative va tester plusieurs alternatives, comme des tables d’élevage nouvelle génération pouvant être oxygénées pour éviter les épisodes de malaïgue. «Quant à l’élevage de moules, la meilleure option à long terme est sûrement de délocaliser la production en mer», explique Laurent Arcella. Les canicules marines y ont moins d’impact, car une vague de chaleur surchauffe seulement les premiers mètres d’eau de surface.
Élever des moules en mer amène toutefois de nombreuses contraintes : sans la protection qu’offre l’étang, il faut beaucoup plus de matériel et d’investissements, et les bancs de dorades, des poissons qui se déplacent par milliers et qui raffolent des coquillages, peuvent détruire toute une exploitation en quelques jours. Laurent Arcella résume : «Si on veut conserver une production locale, nous n’avons pas beaucoup de choix.»
À lire aussi
-
Pollution, changement climatique, surpêche : tout savoir sur les enjeux écologiques liés à l’océan en six graphiques
Schémas mer. La question de la préservation des océans est sur toutes les lèvres lors de la conférence mondiale sur le sujet à Nice. Hausse des températures, disparition des coraux… voici six infographies pour bien comprendre ce dont on parle. -
Poissons à tête transparente, «oxygène noir», exploitation minière… plongez dans les mystères des profondeurs de l’océan
On se fait l’abysse ? La question des fonds marins déchaîne les passions des participant·es à la conférence mondiale sur l’océan à Nice. Alors que les États-Unis de Donald Trump veulent forer à tout-va dans les abysses, d’autres pays s’y opposent en l’absence de connaissances scientifiques suffisantes. Il faut dire que les profondeurs de l’océan conservent une grande part d’ombre… Vert vous aide à y voir plus clair.