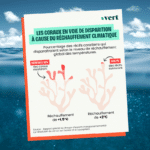Près de 25 degrés Celsius (°C) à Argelès-sur-mer (Pyrénées-Orientales), 24 à Marseille, 28 à Saint-Tropez (Var) ou à Calvi, en Corse… En cette troisième semaine d’août 2025, la Méditerranée affiche des températures de surface jusqu’à 4°C au-dessus des moyennes saisonnières.
Ce qui réjouit sans doute les baigneur·ses cache une réalité inquiétante : celle d’une vague de chaleur marine qui a commencé il y a une semaine (juste après l’épisode caniculaire qui a touché la France à partir du 8 août) et qui, si elle dure trop longtemps, risque de perturber les écosystèmes.
Pour comprendre ce que cache cette apparente douceur estivale, nous avons interrogé Thierry Perez, directeur de recherche au CNRS et spécialiste en écologie marine. Depuis plus de 20 ans, il observe l’évolution des habitats marins. Auprès de Vert, il alerte sur un phénomène qu’il compare à un incendie… sous l’eau.

Peut-on dire que la Méditerranée traverse actuellement une canicule marine ?
Il faut d’abord rappeler que le terme «canicule marine» est assez récent – il est apparu dans un rapport du GIEC en 2019 – et qu’il n’existe pas encore de définition universelle. Ce qu’on observe en ce moment, ce sont des anomalies thermiques majeures, notamment en surface, avec des températures qui dépassent largement les normales saisonnières.
Mais attention : une vague de chaleur marine ne se résume pas à une température élevée pendant quelques jours. Ce qui compte, c’est la durée, l’intensité, mais aussi la profondeur atteinte. Une élévation modérée mais prolongée peut avoir un impact plus grave qu’un pic bref et intense. Si la chaleur s’installe durablement, elle pénètre en profondeur, avec des effets potentiellement catastrophiques sur les écosystèmes.
En ce moment, on n’en est pas là. Mais on continue d’observer le phénomène.
Les vagues de chaleur marine sont-elles exceptionnelles ?
Pas du tout. Les premières manifestations de ce type de réchauffement datent de plusieurs décennies. On pense par exemple au phénomène El Niño, bien connu dans le Pacifique, qui provoquait, il y a cinquante ans déjà, une anomalie thermique sur une large portion de l’océan. Ce type d’événements [qui se produisent encore, NDLR] ne touchent pas que la surface, mais d’importantes masses d’eau.
En Méditerranée, on a commencé à documenter des vagues de chaleur marine dès la fin des années 1990. Le premier événement sur lequel j’ai travaillé, c’était en 1999. Ce n’était pas 30 degrés à l’époque, c’était 24-25°C… mais pendant plus d’un mois, jusqu’à des profondeurs de 40 à 70 mètres. Ces températures étaient inédites pour les espèces vivant à ces profondeurs, et les impacts ont été très importants. Ce qui change aujourd’hui, c’est la fréquence et la régularité de ces vagues de chaleur : depuis 2022, on est dans un état quasi permanent d’anomalie thermique, toute l’année.
Quels sont les effets sur les écosystèmes marins ?
Ils sont nombreux. Dans une vision anthropocentrée, on pourrait trouver des effets «positifs» : certaines espèces de poissons thermophiles (qui aiment la chaleur) migrent vers le nord et entrent dans les pêcheries locales. On voit par exemple des bancs de barracudas ou de dorades coryphènes s’installer durablement dans des zones où on ne les voyait pas auparavant. Pour les plongeurs, c’est parfois spectaculaire.
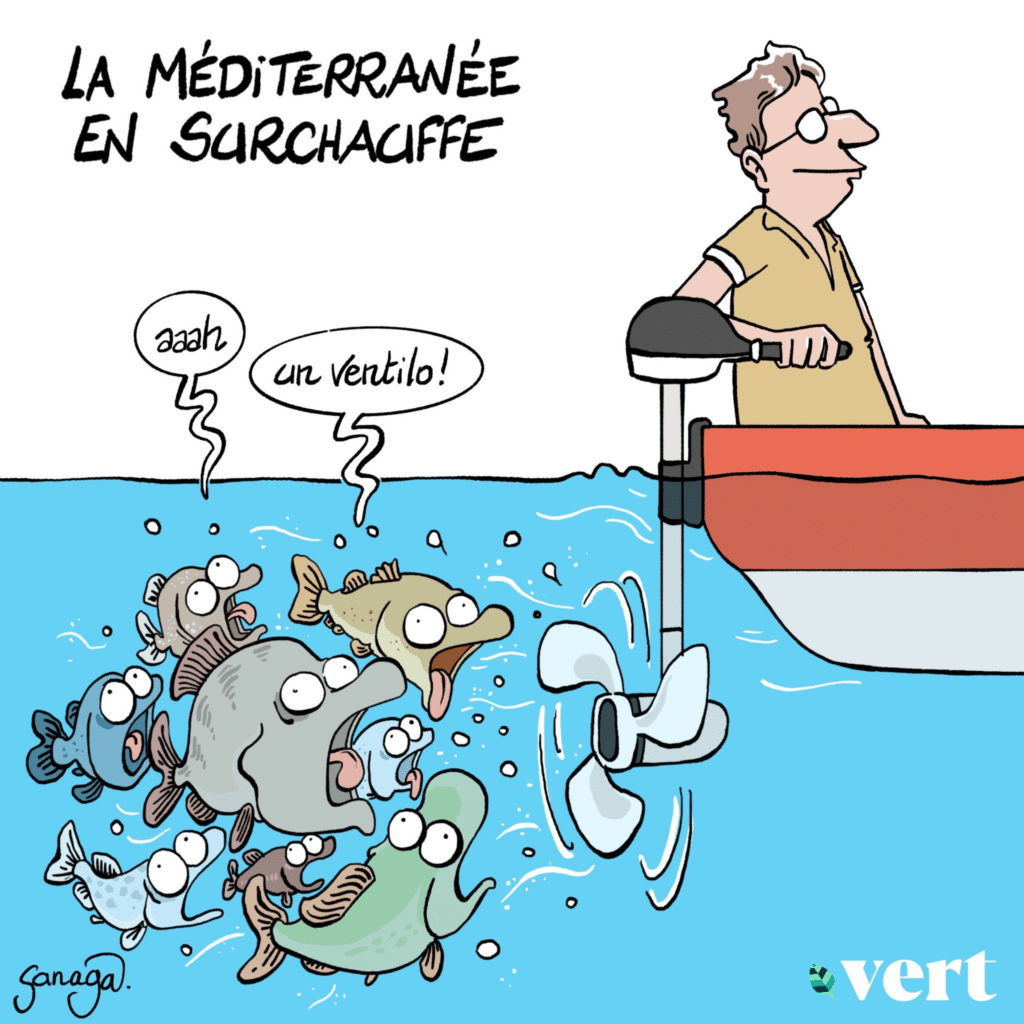
Mais cette lecture est très partielle. Car dans le même temps, les espèces fixées – comme les gorgones, les éponges, les coraux –, qui n’ont pas la possibilité de migrer, subissent de plein fouet la hausse des températures. Quand elles dépassent leur seuil de tolérance thermique, on assiste à de véritables épidémies, à des mortalités massives, comme ce qu’on observe dans les récifs de Nouvelle-Zélande avec le blanchissement des coraux. On peut parler d’un incendie sous-marin : quand ces organismes disparaissent, c’est tout l’écosystème qui s’effondre autour d’eux.
Pourquoi la disparition de ces espèces est-elle si inquiétante ?
Parce qu’elles sont les piliers de ces écosystèmes. Ce sont elles qui structurent les habitats, abritent d’autres espèces, produisent de la matière organique, nourrissent des invertébrés, des poissons, parfois même des oiseaux marins. Leur disparition équivaut à celle d’une forêt entière. Imaginez une forêt qui brûle : vous perdez les arbres, mais aussi tout ce qui vit autour – insectes, oiseaux, mammifères. Sous l’eau, c’est la même chose.
En 2022, on a connu un épisode de mortalité d’une ampleur jamais observée jusque-là. Et ces phénomènes peuvent survenir très rapidement. Il suffit que la température dépasse un seuil critique, en durée et en intensité, pour que tout bascule du jour au lendemain.
Peut-on compter sur les éléments naturels pour limiter ces effets, comme le vent ?
Oui, dans une certaine mesure. Des épisodes de vent fort, comme le Mistral, peuvent temporairement rafraîchir les couches superficielles de la mer, en brassant les masses d’eau. Cela ralentit la pénétration de la chaleur en profondeur, et c’est bénéfique pour les écosystèmes côtiers.

C’est d’ailleurs un paradoxe intéressant : un coup de Mistral peut être catastrophique pour la forêt, en attisant les incendies, mais salutaire pour la mer, en limitant les effets du réchauffement.
Est-ce que le réchauffement favorise l’arrivée d’espèces envahissantes ?
Oui. Le réchauffement crée des conditions idéales pour certaines espèces introduites par l’homme, notamment via le canal de Suez. C’est le cas du poisson-lion ou du poisson-lapin, par exemple. Elles sont déjà très présentes en Méditerranée orientale, et commencent à apparaître en Méditerranée occidentale.
Le problème, c’est qu’elles entrent en compétition directe avec la faune locale. Par exemple, ces poissons-lapins sont des herbivores voraces. En Méditerranée, on avait une seule espèce herbivore. Avec l’arrivée de ces deux espèces nouvelles, on triple la pression sur les écosystèmes. C’est comme si on passait d’une à trois chèvres dans un même pré : la végétation ne suit plus.
Depuis quelques temps, on observe une prolifération des méduses sur les côtes françaises. Est-ce lié à la hausse des températures ?
Le lien entre méduses et canicules marines est plus indirect. Mais il est clair qu’un réchauffement global favorise leur prolifération, surtout en cas de météo anormalement chaude.
Par ailleurs, les méduses consomment beaucoup de plancton, qui est la base alimentaire de nombreuses espèces de poissons pélagiques. Quand les méduses sont là en masse, on observe souvent une baisse des rendements de pêche sur certaines espèces. C’est un autre effet collatéral du dérèglement climatique.
Si le réchauffement de la Méditerranée se poursuit, à quoi faut-il s’attendre ?
On va vers une homogénéisation progressive des écosystèmes méditerranéens. Les paysages sous-marins que l’on connaît en Méditerranée occidentale vont finir par ressembler à ceux de la Méditerranée orientale, beaucoup plus pauvres en diversité. Et ça, ce serait une immense perte.
La diversité, c’est la clé. Elle permet aux écosystèmes de s’adapter, de résister aux perturbations. Si on la perd, on réduit leur capacité à encaisser les chocs, et on s’expose au risque d’extinction.
L’objectif, aujourd’hui, c’est de limiter le réchauffement climatique et limiter les pressions. Car ce qu’on observe aussi, c’est que la nature sait s’adapter, si on lui en laisse le temps.
À lire aussi
-
Alerte aux méduses : votre plage préférée est-elle infestée ?
Le bon, la brute et le gluant. Depuis plusieurs jours, les mises en garde concernant la présence de méduses se multiplient, surtout sur le littoral méditerranéen. Une prolifération due aux vents violents. Découvrez la carte de France des plages qui recensent le plus de ces animaux aquatiques urticants. -
Pollution, changement climatique, surpêche : tout savoir sur les enjeux écologiques liés à l’océan en six graphiques
Schémas mer. La question de la préservation des océans est sur toutes les lèvres lors de la conférence mondiale sur le sujet à Nice. Hausse des températures, disparition des coraux… voici six infographies pour bien comprendre ce dont on parle.