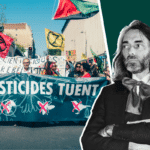Abeilles, scarabées, libellules, vers de terre, coccinelles, punaises… Ils sont si petits et pourtant essentiels. On estime que les insectes assurent la pollinisation de 90% des plantes sauvages à fleurs et qu’un tiers de la production agricole mondiale en dépend. Ils jouent aussi un rôle crucial pour recycler la matière organique, purifier l’eau et contrôler certains parasites de cultures.

Ces petites bêtes sont le «carburant de la vie» : elles nourrissent massivement les plus gros animaux (oiseaux, amphibiens, poissons…) et leur disparition perturbe l’ensemble de la biodiversité. Depuis plusieurs années, de multiples travaux scientifiques mettent en évidence un effondrement inquiétant de ces précieux insectes, de l’ordre de 60 à 80% en Europe sur les dernières décennies. Voici une sélection des cinq études les plus marquantes.
La plus récente : -63% d’insectes volants au Royaume-Uni entre 2021 et 2024
Voilà un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître : il y a encore quelques décennies, il était impossible de faire un long voyage d’été en voiture sans devoir s’arrêter régulièrement pour nettoyer le pare-brise des nuées d’insectes qui s’y étaient écrasées. Aujourd’hui, nos vitres restent désespérément propres.
C’est de cet «effet pare-brise» que s’inspire l’enquête «Bugs matter», une vaste étude participative organisée en Grande-Bretagne par deux associations environnementales. Chaque année, plusieurs milliers d’automobilistes enregistrent leurs trajets GPS sur une application et photographient leur plaque d’immatriculation pour recenser le nombre d’insectes percutés. «C’est une manière simple et standardisée de tester le déclin des insectes, et les résultats sont probants», explique à Vert Laurence Gaume, écologue au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et spécialiste des interactions plantes-insectes, qui n’a pas participé à l’étude.
Les dernières données, publiées mercredi 30 avril, mettent en évidence une chute de 63% des populations d’insectes volants en l’espace de trois ans sur l’ensemble du Royaume-Uni. S’ils s’étalent sur une échelle de temps assez réduite, ces résultats «montrent les mêmes tendances que d’autres études participatives similaires», note Laurence Gaume. En 2019, une autre enquête participative menée à partir des pare-brises de voitures au Danemark avait montré une diminution de 80% des insectes volants entre 1997 et 2017.
La plus connue : -76% d’insectes volants en 27 ans dans des zones protégées en Allemagne
C’est sans doute l’étude de référence en la matière, citée par de nombreux·ses scientifiques, et érigée en symbole dans les manifestations écologistes (notre article). En 2017, une équipe de chercheur·ses européen·nes a calculé que la quantité d’insectes volants capturés dans leurs pièges en Allemagne avait diminué de 76% entre 1989 et 2016. Pire : les 63 endroits sur lesquels les insectes ont été collectés étaient tous… des espaces protégés.
Ces résultats ont été renforcés par une autre étude publiée deux ans après dans la prestigieuse revue Nature : entre 2008 et 2017, les prairies étudiées en Allemagne ont vu disparaitre 67% des populations d’arthropodes (qui regroupent les insectes, les araignées ou les crustacés…). L’équipe de recherche allemande a aussi montré que la diversité d’espèces recensées a fondu de 34% sur ces neuf années.
«Ces deux publications ont marqué le paysage scientifique», témoigne auprès de Vert Philippe Grandcolas, directeur de recherche en écologie au CNRS. La force de ces études, c’est de converger vers les mêmes tendances avec des protocoles sensiblement différents.» Ces dernières années, les preuves de l’effondrement de différents groupes d’insectes s’amoncèlent partout en Europe et ailleurs : -50% de papillons au Royaume-Uni depuis 1976 et -22% aux États-Unis en 20 ans, -50% de sauterelles en Suisse entre 1992 et 2011…
La plus française : les oiseaux insectivores en grave déclin dans les campagnes
Les études sur l’état de différentes populations d’insectes se multiplient en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis… mais que sait-on sur la France ? «On a très peu de suivi des insectes, il y a beaucoup d’espèces [plus de 40 000 dans l’Hexagone, NDLR], peu de spécialistes et pas assez de financements», regrette Philippe Grandcolas. «Il est beaucoup plus rare d’avoir des données standardisées et fournies pour les insectes que pour les oiseaux, par exemple, dont les enregistrements ont commencé il y a déjà une quarantaine d’années», confirme Laurence Gaume.
Selon sa collègue Marion Desquilbet, spécialiste d’économie agricole à la Toulouse School of Economics et à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), l’état des populations d’oiseaux est justement «un bon indicateur indirect de celui des insectes». En 2021, une grande enquête basée sur les comptages menés par des naturalistes depuis 1989 a mis en évidence un déclin alarmant de 30% des oiseaux agricoles en France en 30 ans.

La disparition des insectes, dont de nombreux oiseaux se nourrissent, est une des explications proposées par cette étude majeure, coordonnée par le Muséum national d’histoire naturelle, la Ligue pour la protection des oiseaux et l’Office français de la biodiversité. Le déclin alarmant des oiseaux agricoles a été confirmé deux ans plus tard au niveau européen avec des données encore plus inquiétantes : en l’espace de 37 ans, ce sont 60% des oiseaux de milieux agricoles qui ont disparu (notre article).
La plus controversée : un déclin mondial de «seulement» 9% par décennie ?
Il existe très peu d’études globales sur l’état des populations d’insectes. En 2020, une équipe de scientifiques a tenté de faire une synthèse en compilant les résultats de plus de 160 recherches menées partout dans le monde : d’après leurs résultats, l’abondance mondiale des insectes terrestres ne perdrait que 9% tous les dix ans… et grandirait même de 11% par décennie pour les insectes d’eau douce. Le tout en écartant l’impact potentiel de l’agriculture.
Des résultats en contradiction avec beaucoup d’études locales, s’étonne Laurence Gaume : «La méta-analyse [une étude sur plusieurs études, NDLR] s’est avérée biaisée ; ils ont fait des erreurs grossières, à la fois dans la sélection des données, dans les données elles-mêmes, et dans leurs analyses.» «Ils ont inclus des études qui ne concernaient pas uniquement des insectes mais l’ensemble des invertébrés, comme des moules invasives», illustre Marion Desquilbet. Chiffres mal recopiés, mauvaises coordonnées géographiques… en octobre dernier, les deux chercheuses ont publié un article largement relayé démontant point par point les biais de cette étude controversée.
Bien que relue et publiée à l’époque par la revue de référence Science, et aujourd’hui accompagnée d’un «erratum» partiel, les résultats de cette grande synthèse sont considérés comme inexploitables. «C’était important de débunker cette fausse base de données, qui a conduit à des travaux rassuristes affirmant que certaines espèces allaient mieux», souligne Philippe Grandcolas, qui n’a pas participé à ces travaux.
La plus incriminante : plusieurs centaines de pesticides jouent un rôle certain dans la mortalité des insectes
Si la crise de la biodiversité des insectes est aujourd’hui un consensus scientifique, le débat porte désormais sur les causes expliquant un tel effondrement. «Dans les milieux agro-industriels, les pesticides sont le problème majeur, mais il y a aussi la perte d’habitats et le changement climatique qui jouent», liste Philippe Grandcolas, reprenant les grands facteurs généraux définis par la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité (IPBES, ou «Giec de la biodiversité») pour expliquer l’effondrement en cours du vivant (notre article).
«Il est très difficile de mettre en évidence une cause principale, car on a très peu de données sur les insecticides épandus qui pourtant, par définition, tuent des insectes», note Laurence Gaume. En laboratoire toutefois, une étude importante publiée en 2024 par des chercheur·ses européen·nes a prouvé l’impact clair des produits phytosanitaires, aux doses où ils sont utilisés dans les champs, sur la survie des petits organismes. Elles et ils ont testé plus d’un millier de substances sur des mouches et leurs larves, et ont observé des effets sublétaux (qui amènent indirectement à la mort : problèmes de mobilité, de reproduction, de capacité à s’alimenter…) dans plus de 50% des cas.
En avril dernier, une méta-synthèse publiée dans la revue BioScience a aussi identifié l’agriculture intensive comme étant le facteur le plus souvent mentionné dans la disparition des insectes. «Toutes ces publications devraient influencer notre manière de réglementer les pesticides, mais les scientifiques ne sont pas écoutés sur cette question», regrette Laurence Gaume. En France, la dynamique est même inverse : fin mai, l’Assemblée nationale devra débattre de la réautorisation sous conditions de l’acétamipride, un pesticide «tueur d’abeilles».
À lire aussi
-
Insectes, oiseaux, champignons, microbes… une étude prouve la nocivité des pesticides pour l’ensemble de la biodiversité
Chimique mac. Ces substances nuisent à de nombreuses espèces qu’elles ne sont pas censées cibler, démontre une étude majeure publiée dans la revue Nature Communication, jeudi. Une preuve supplémentaire de leur rôle dans l’effondrement du vivant. -
Cédric Villani : «Le printemps, c’est le temps des contestations»
Printemps de vivre. Dans cette chronique à la fois poétique et politique, le mathématicien Cédric Villani explore les multiples visages de cette saison en mutation, où les floraisons précoces témoignent du réchauffement climatique, où les cortèges fleurissent autant que les cerisiers, et où l’on rêve, malgré tout, d’un printemps sans fin.