Pourquoi parler de « mythologies » dans votre livre pour évoquer les idées reçues sur l’écologie ?
C’est un terme un peu provocateur, mais intéressant, car une mythologie est une idée sur laquelle se fonde toute une construction sociale et sur laquelle nous basons nos vies. À force d’être répétées, ces idées deviennent des évidences et ne peuvent plus être questionnées.
Je voulais sortir d’un certain manichéisme. C’est de plus en plus compliqué d’aller au fond des choses ; tous les problèmes auxquels nous faisons face nécessitent de prendre du temps. Mais les réseaux sociaux fonctionnent sur l’instant T et les médias se conforment aussi à ce rythme-là. On voit moins de débats de fond, en particulier à la télévision, qui se veut une distraction permanente.
Vous êtes professeur de géographie. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux idées reçues sur l’écologie ?
Cela fait une quinzaine d’années que je m’intéresse à ces questions. J’ai participé à des conférences, des tables rondes. Je me force d’écouter tous les débats, y compris sur des médias qui ont une vision de l’écologie différente de la mienne. Dans mon livre, j’ai essayé de réfléchir à la question de la démographie, de la technologie et des comportements individuels. J’avais lu Nos Mythologies économiques, d’Eloi Laurent, un ouvrage dans lequel il déconstruit une série de clichés sur l’économie. C’est un outil puissant pour essayer de gagner la bataille des idées. Celles-ci sont souvent simplifiées et les enjeux, mal compris et caricaturés.
Il y avait aussi une volonté de fournir un outil simple. Il existe beaucoup de littérature spécialisée sur l’écologie, mais beaucoup d’ouvrages sont très techniques et déconnectés d’une écologie de terrain, populaire. L’un des gros échecs de l’écologie dominante, c’est de s’être déconnectée des classes populaires. Je ne suis pas naïf : je sais que ce livre va majoritairement être lu par des convaincus, mais il faut élargir le public.

Le nombre de clichés sur l’écologie est infini. Comment avez-vous choisi les « mythologies » traitées dans le livre ?
Les idées sont venues spontanément. J’ai travaillé sur celles qu’on entend le plus. L’ordre était arbitraire, en discussion avec l’éditeur. Je suis professeur de géographie, et la géographie est souvent sous-estimée comme outil pour comprendre notre monde et gagner des luttes. Je voulais un sous-chapitre consacré aux questions spatiales. Dans certaines idées reçues, il était fait référence à l’histoire – au passé – pour décrédibiliser certaines politiques. La technologie nécessitait une partie à elle seule. Celle du nucléaire, des énergies renouvelables et du numérique concernent l’avenir : que proposons-nous ? Que risque-t-il de se passer ?
Quelles sont les trois mythologies qui vous semblent les plus puissantes aujourd’hui, et comment, selon vous, est-il possible de les déconstruire ?
D’abord, la question de la démographie ‒ « on est trop nombreux sur la planète ». Elle est incontournable et légitime. Nous sommes passés de deux à huit milliards d’êtres humains sur terre en quelques décennies. Celui qui pense que cela n’a aucun impact environnemental se trompe. Le fait d’être huit milliards ajoute une contrainte majeure pour l’humanité et une pression environnementale certaine.
« Il faut absolument éviter les réponses simplistes : la population n’est pas une variable dans une équation. »
Mais ce constat une fois fait, faut-il aller vers des politiques de coercition, comme en Chine ? Certaines réponses d’extrême droite consistent à dire qu’il faut supprimer une partie de la population, notamment en Afrique subsaharienne où on fait le plus d’enfants. Le problème serait donc la natalité. Or, même dans des pays à forte natalité, les femmes ont moins d’enfants qu’avant. Dans les autres pays, la natalité est très basse.
En creusant le sujet, on se rend compte que c’est la répartition des richesses et l’amélioration des conditions sociales et économiques dans les pays du Sud qui constituent les grands enjeux. La population mondiale va continuer à augmenter, avec un effet d’inertie sur des décennies. Mais il faut absolument éviter les réponses simplistes : la population n’est pas une variable dans une équation.
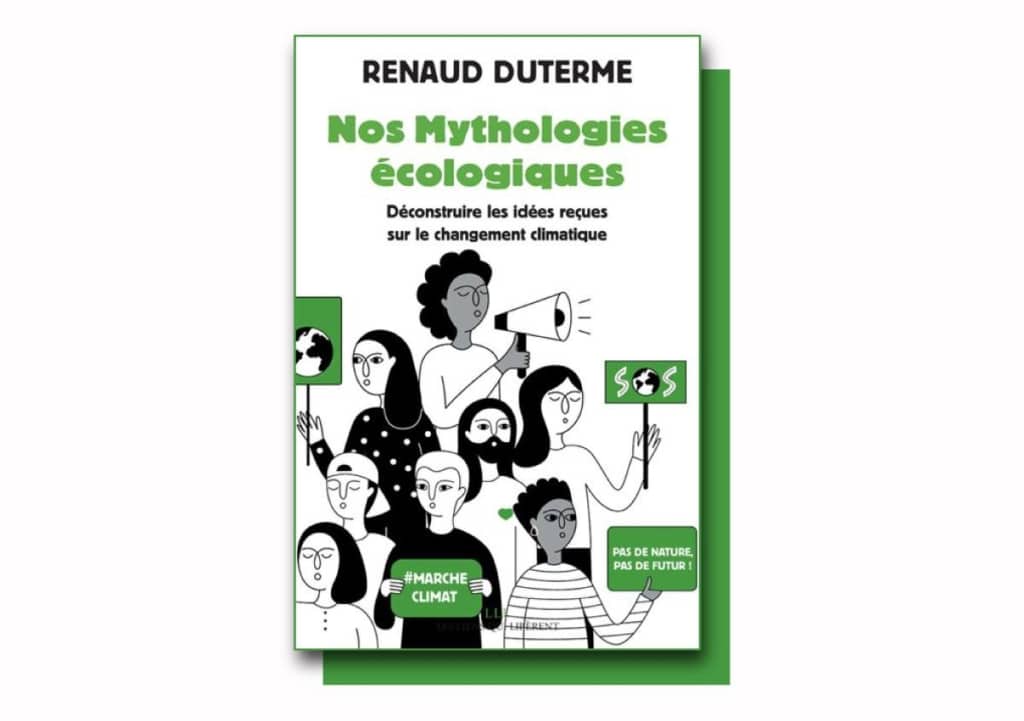
Une autre croyance majeure est que « la technologie nous sauvera ». Je ne suis pas ingénieur, et on peut se sentir exclu·e de ce type de débats quand on ne maîtrise pas le jargon technique. Néanmoins, il m’a semblé utile de mener une réflexion plus générale sur la technologie, sans occulter ses effets pervers.
Prenons l’exemple de la voiture électrique, qui est une prouesse technologique. Il y a un milliard de voitures sur terre. Le débat se cristallise sur la pollution : la voiture électrique est-elle moins polluante que son équivalent thermique ? Or, la question devrait plutôt être : la généralisation des véhicules électriques est-elle possible et même souhaitable ? Passer à l’électrique nécessite de transformer complètement notre société, des constructeurs aux garagistes. Par ailleurs, les matières premières se raréfient.
« Face à un ingénieur, on se sent piégé, mais envisager les problèmes sous un angle global et systémique permet de gagner la bataille des idées. »
Autre exemple avec la fusion nucléaire. Il y a quelques semaines, une équipe de chercheurs a maintenu la fusion pendant cinq secondes : c’était une prouesse absolue. Mais quand un journaliste a demandé à quelle échéance cette technologie pourrait être disponible, les chercheurs ont répondu : « dans les années 2060 à 2070 ». Il s’agit de délais faramineux compte tenu des enjeux. On ne peut pas attendre 2060 pour résoudre le problème de l’électricité. Je conseille de prendre les technophiles à leur propre piège et d’éviter le débat entre pro et anti-technologie. J’admets leur posture tout en la déconstruisant. Face à un ingénieur, on se sent piégé, mais envisager les problèmes sous un angle global et systémique permet de gagner la bataille des idées.
L’argument spatial est intéressant ; les différentes technologies ne prennent pas en compte la question de l’extraction de l’uranium, de son approvisionnement et de ses conséquences écologiques et sociales. Si la France est fascinée par le nucléaire, c’est qu’il y a beaucoup d’uranium dans ses anciennes colonies. Est-ce envisageable d’en mettre partout ? Comme le dit Jean-Marc Jancovici, le nucléaire est la moins mauvaise chose dans un contexte de sobriété et de décroissance. Mais d’autres vantent le nucléaire uniquement dans un contexte de décarbonation et veulent continuer, comme si de rien n’était, le « business as usual ». Je ne vois pas comment on peut promouvoir cette énergie dans des zones sismiques, dangereuses. La technologie n’est jamais neutre, elle est utilisée à différentes fins selon le problème à résoudre. Les ingénieurs oublient parfois qu’elle s’inscrit toujours dans un contexte économique et social.
L’une des croyances les plus diffusées dans notre société est la croyance que l’on peut s’en sortir par des petits gestes. Que répondez-vous à cela ?
L’importance parfois démesurée accordée aux choix individuels nous fait croire qu’il n’y a pas besoin de changement structurel. Ces croyances détournent le problème, elles permettent de ne pas questionner les vrais enjeux que sont nos problèmes de consommation et de production.
« Tout baser sur les changements individuels fait porter une trop grande responsabilité aux personnes et nourrit une écologie culpabilisatrice, donneuse de leçons, urbaine, déconnectée de la réalité de la vie. »
Malgré tout, les choix individuels ne servent pas à rien. Je prends moins ma voiture, je me nourris sans aller au supermarché. Mais une grande partie de ces choix ne dépend pas de nous. Je vis en zone rurale où la voiture est obligatoire. Pour aller faire du sport, aller à la pharmacie, les transports en commun sont peu utilisés. J’ai de la chance, car je peux aller au travail à pied. Certaines politiques écologiques ne prennent pas en compte le mode de vie des classes populaires, elles sont élaborées d’un point de vue urbain et privilégié. Les supermarchés font partie du problème : quand on n’a pas le temps et l’argent, il est compliqué de faire autrement. Tout baser sur les changements individuels fait porter une trop grande responsabilité aux personnes et nourrit une écologie culpabilisatrice, donneuse de leçons, urbaine, déconnectée de la réalité de la vie.
Beaucoup de changements individuels dépendent de politiques plus larges : repenser les aménagements du territoire, le développement des transports en commun, la redynamisation des zones rurales. Ce point est important, car voir le changement prioritairement comme une modification des comportements individuels est conforme à l’idéologie néolibérale. Margaret Thatcher disait qu’il n’y a « pas de société, uniquement des individus ». En faisant cela, on considère ceux qui n’appliquent pas le changement comme des parias, des égoïstes, alors que la transformation dépend de politiques publiques. Quand on parle des changements individuels, ce sont toujours des changements qui concernent les privilégiés, socialement ou économiquement.
« L’écologie est avant tout sociale, donc de gauche, car elle induit des politiques de redistribution des richesses et d’amélioration des conditions de vie. »
L’écologie populaire n’est jamais envisagée : peu de gens ont vu dans le mouvement des gilets jaunes des revendications écologistes. De facto, satisfaire leurs revendications aurait eu des impacts écologiques plus larges : redynamiser les campagnes, faire revenir les services publics, amener des transports ferroviaires, arrêter la délocalisation. L’écologie doit être d’abord sociale si elle veut être efficace et populaire.
Votre livre reste un essai, qui ne sera pas forcément largement diffusé. Ne faudrait-il pas, par exemple, concevoir un jeu à partir de ces idées reçues ?
Le livre est un outil parmi d’autres. Mais il faut être sur tous les fronts. On pourrait utiliser ces clichés pour inventer des jeux d’éducation populaire et les utiliser dans les écoles, pour les illustrer par des reportages, permettre à des youtubeurs de s’en emparer. Il faut utiliser tous les formats. Parfois, il y a un mépris de classe de la part des intellectuels, qui préfèrent privilégier certains formats. Or, pour pouvoir penser l’après-demain, il faut assurer ses conditions matérielles actuelles. Avant la fin du monde, il y a la fin du mois. C’est en améliorant les conditions de vie des populations qu’elles pourront s’intéresser à ces questions-là.
J’ai de la chance : je suis prof et j’ai du temps libre. Si j’avais un métier manuel et que je rentrais à sept heures du soir, je n’aurais pas envie de m’atteler à la rédaction d’un ouvrage. C’est pourquoi il faut une réduction du temps de travail, qui serait un merveilleux outil de redistribution des richesses. Pendant le confinement, beaucoup de gens se sont investis localement, ont fait leurs courses autrement. Ce que le rythme de vie effréné actuel ne permet pas. Cela demande aussi d’avoir accès à une bonne information. J’ai des outils parce que je suis né dans un certain milieu. Il est absolument nécessaire de fournir des outils d’éducation permanente, pour celles et ceux qui voudraient trouver ce genre d’information. L’écologie est avant tout sociale, donc de gauche, car elle induit des politiques de redistribution des richesses et d’amélioration des conditions de vie. Tous les défis à venir pourront être relevés dans un contexte de justice sociale et dans une logique de confrontation avec les leaders économiques.
À lire aussi
-
Vincent Liegey : « Une majorité de personnes aspire à rompre le système et à aller vers des modes de vie plus conviviaux »
Vincent Liegey est ingénieur et chercheur spécialiste de la décroissance. A Vert, il raconte comment les idées de la décroissance, porteuses d’alternatives concrètes et joyeuses, sont entravées par un système médiatique miné par les intérêts financiers, et les nombreuses raisons d’espérer les voir émerger. -
Les techniques des climatosceptiques pour nier la réalité scientifique
Alors que le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) a mis un point final à son sixième rapport, la poignée de climatosceptiques qui subsiste dans les médias s'agite (espérons-le) une dernière fois. Voici les arguments qu'elles et ils ne manqueront pas d'utiliser pour nier la gravité de la crise et l'urgence des actions à mener.


