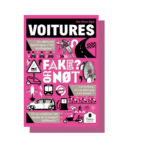Caisse qu’on fait ? Dévoilée ce mardi, une enquête conduite par les laboratoires d’idées la Fabrique écologique et le Forum Vies Mobiles révèle que le partage de l’auto pour aller au boulot peine à s’imposer en France.
Sur le papier, l’équation relève du bon sens : pour décarboner les transports, où la part des trajets effectués seul·e en voiture (l’«autosolisme») reste très majoritaire, il suffirait de partager les trajets en embarquant des covoitureur·ses. En France, pour les longues distances, ça marche. Avec ses 20 millions d’utilisateurs, BlablaCar est aujourd’hui le symbole de cette réussite, ouvrant la voie à de nombreuses plateformes de partage de trajets (Mobicoop, Karos…). Mais, pour les trajets du quotidien – faire ses courses, se rendre au travail ou chercher ses enfants à l’école, ça coince.
Premier constat : en pariant sur un boom du covoiturage au quotidien d’ici à 2027, le gouvernement et les collectivités semblent, pour l’instant, avoir fait fausse route. Avec un objectif de passer de 900 000 trajets covoiturés par jour en 2023 à trois millions en 2027, le plan Covoiturage lancé par l’Etat fin 2022, a sans doute péché par ambition. «Au cours du 1er semestre 2023, les trajets covoiturés chaque jour via des plateformes numériques, représentaient un peu moins de 3% de l’ensemble des trajets covoiturés !», souligne ainsi l’étude.
Parmi les freins, le fait de s’embarquer à plusieurs pour faire un trajet ne présente pas toujours, sur de courtes distances, un fort intérêt économique. Autres obstacles identifiés : «l’organisation de la société, comme les horaires de travail, et plus structurellement […] l’organisation du territoire et […] la géographie française». Mais encore, «la dispersion des activités sur le territoire (travail, loisirs, courses, etc.) liée notamment à l’absorption par les métropoles d’espaces ruraux et semi-ruraux où la population augmente, mais où l’emploi diminue».
Autre aspect de l’étude qui attire l’attention : le plan Covoiturage fait état de 50 millions de sièges «vides» qui circulerait sur les routes françaises chaque jour ; mais les autorités ne savent pas avec précision où et quand roulent ces véhicules.
Compte tenu de toutes ces limitations, l’étude interroge la pertinence de développer à marche forcée la pratique du covoiturage au quotidien. «La zone de pertinence écologique du covoiturage devrait ne concerner que les déplacements de plus de 10 kilomètres où une offre de transports collectifs adaptée n’existe pas déjà», recommandent les auteur·rices. Manière de rappeler que, partage ou pas, c’est bien l’usage même de la voiture qu’il faut interroger…
À lire aussi
-
Et si on repensait la place des voitures dans nos vies?
Avec Voitures, le chercheur indépendant sur les mobilités Aurélien Bigo se livre à une critique vulgarisée et imagée de ces bolides encombrants, toujours plus lourds et nocifs pour notre santé comme pour le climat, et propose des solutions pour limiter la casse. -
Réduire la vitesse au volant permet-il de faire baisser la pollution des voitures ?
Dans un contexte de crise énergétique, réduire sa vitesse au volant apparaît comme une solution efficace pour le climat comme pour le porte-monnaie. Une mesure controversée qui a pourtant de multiples bénéfices.