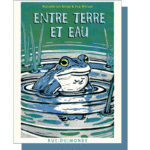Ce qu’il faut retenir :
🧑⚖️ Attention à la réglementation : il est interdit de construire un plan d’eau à moins de 50 mètres des habitations, et des autorisations peuvent être nécessaires pour les plus grosses mares.
🗺️ Choisir un endroit dégagé, ensoleillé, au pied d’une pente, si possible proche d’un bosquet mais à une distance d’au moins trois mètres des arbres et de leurs racines.
✏️ Varier la profondeur et le contour de la mare : creuser un point bas d’environ un mètre avec des paliers de profondeurs variées ; préférer des contours sinueux.
⚒️ Commencer le chantier à l’automne (octobre-novembre) ; prévoir pelle, bèche et grelinette pour creuser la terre.
💧 Faire attention à l’étanchéité du sol , en installant une bâche ou de l’argile.
🪷 Laisser l’eau de pluie remplir la mare, aménagez les abords (tas de bois, végétation, muret…) et laisser la nature faire le reste !
Tritons, grenouilles, iris, joncs, libellules, dytiques et autres petites bêtes aquatiques… Comme de nombreuses zones humides, les mares peuvent abriter une biodiversité remarquable. Souvent alimentées par la pluie, ces étendues d’entre quelques mètres carrés (m2) et 5 000 m2 servent aussi à réguler et à épurer les eaux.
Pourtant, ces précieux écosystèmes sont dans le creux de la vague : autrefois essentielles en agriculture ou pour les besoins domestiques, on estime qu’environ la moitié des mares ont disparu du territoire français depuis 1950. Alors, depuis plusieurs années, associations, bénévoles et simples citoyen·nes mettent la main à la terre pour redonner vie à ces milieux oubliés.

🧑⚖️ Quelques précautions réglementaires
«En théorie, on peut faire une mare n’importe où, détaille Victor Dupuy, écologue et responsable études mares à la Société nationale de protection de la nature (SNPN). Mais il faut faire attention à la réglementation, aux milieux naturels, et à ne pas créer des nuisances potentielles pour les voisins.»
Si construire une petite mare dans son jardin ou sa propriété ne nécessite pas d’autorisation, il est interdit d’en construire à moins de 50 mètres des habitations dans la plupart des départements. Mais «une petite mare ombragée attirera peu de grenouilles et ne causera probablement aucun tapage nocturne», rassure le spécialiste, qui prône le dialogue avec les voisin·es et la mairie.
À noter que, pour les mares les plus grosses (à partir d’une surface de 1 000 m2), une déclaration doit être faite auprès des services des eaux de la préfecture, voire une demande d’autorisation pour une retenue d’eau de plus de trois hectares, comme le rappelle la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO).
📍 Bien choisir son emplacement
Une fois ces précautions administratives étudiées, il faut ensuite identifier l’endroit précis où installer son plan d’eau. Pour bien choisir, on peut déjà prendre du recul et regarder les zones humides et réseaux de haies qui existent dans le voisinage, pour en rapprocher sa mare et favoriser les corridors écologiques – ces passages où circulent les espèces. «Plus les gens auront de mares, plus on aura une connectivité, avec des relais entre les milieux aquatiques», confirme Victor Dupuy.
À lire aussi
Dans le détail, certains critères sont à considérer : un endroit dégagé et ensoleillé (avec au moins quatre à six heures de lumière par jour sur environ deux tiers de la mare, afin d’assurer son oxygénation) et si possible en point bas (au pied d’une pente) – pour favoriser le remplissage par le ruissellement de l’eau de pluie.
Pas question pour autant de l’installer au beau milieu d’un terrain nu : la SNPN conseille de se rapprocher le plus possible d’un bosquet – pour servir de refuge à certaines espèces – tout en veillant à respecter une distance minimale de trois mètres avec les arbres et leurs racines. Attention aussi à ne pas être proche d’une route, dont la circulation pourrait sérieusement affecter la migration des amphibiens.
✏️ Varier la profondeur et le contour de la mare
Vous avez trouvé l’endroit idéal ? Alors vous pouvez commencer à tracer la forme de la mare de vos rêves. Si tous les formats sont possibles, la taille de surface idéale est de trois mètres sur six, recommande l’observatoire participatif sur les mares et petites zones humides. Si vous avez de la place et des ambitions, vous pouvez aussi créer plusieurs mares de différentes tailles, pour multiplier la diversité des espèces.
Niveau profondeur, il faut creuser au maximum entre un mètre et un mètre cinquante. Et pas question de faire une simple piscine cubique, avertit Victor Dupuy : «Il faut y aller par paliers, avec plusieurs profondeurs pour avoir différents gradients de température. On conseille souvent de creuser trois niveaux, avec un point bas d’environ un mètre pour éviter le gel.» Entre ces différents niveaux et les berges, des pentes douces favoriseront les déplacements de la faune et l’installation d’une flore variée.

Quant au tracé du contour, on peut laisser libre cours à sa créativité : «Il est préférable de créer une mare aux contours sinueux plutôt que des formes géométriques, conseille le groupe mares du conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. D’un point de vue esthétique, cela renforce le côté naturel ; d’un point de vue écologique, cela crée davantage de linéaire de berge, zone de grand intérêt pour la faune et la flore.»
⛏️ À vos pelles !
Une fois votre projet en tête, il faut idéalement lancer le chantier à l’automne (octobre-novembre), pour profiter du remplissage de l’eau jusqu’à l’été et déranger le moins possible la faune. Avant d’entamer les premiers coups de pelle, pensez bien sûr à vérifier l’absence d’espèces protégées dans la zone de travaux.
Pour préparer le chantier, il est conseillé de tracer les contours de la mare avec des piquets ou une corde, et de commencer à creuser sur un sol sec. Niveau matériel, la traditionnelle pelle ou bèche de jardin fera l’affaire. Une grelinette peut permettre de décompacter la terre pour creuser plus aisément. Pour les projets plus ambitieux, on peut recourir à une petite pelleteuse : «En dessous de 20 m2, c’est jouable à la main, surtout avec des amis ou des voisins !», estime Victor Dupuy.
Le creusement se fait par étapes : enlever la surface végétale du sol, puis excaver le sol en profondeur, en respectant les différentes règles (creuser par palier, créer des pentes douces, dessiner des formes sinueuses…). Quant à la terre retirée, rien ne se perd, tout se transforme : «On peut la valoriser sur site en créant de petits reliefs sur lesquels l’herbe va revenir, ou encore un talus de pierres qui plonge dans la mare», conseille Victor Dupuy.
💧 Faire attention à l’étanchéité du sol…
Pour que la mare se remplisse d’eau, elle doit en retenir plus qu’elle n’en perd. Il existe une grande variété de méthodes, liste Victor Dupuy : «On peut utiliser une bâche en caoutchouc, ou un béton adapté lorsque la pluie est la seule source d’eau, ou différentes applications d’argile lorsque qu’on a un apport d’eau complémentaire régulier.»

En cas de sol peu étanche, la technique la plus courante – mais pas la moins coûteuse – est d’installer une grande bâche (de préférence une membrane «éthylène-propylène-diène monomère», ou EPDM, plus résistante et durable dans le temps) dans le fond. Pour cela, il faut préalablement enlever tous les éléments tranchants (cailloux, branches…) et creuser une vingtaine de centimètres en plus. On l’étale ensuite en veillant à éviter les plis ou les déchirures, puis on enfouit les bordures sous la terre et on recouvre le fond d’un peu de terre ou de sable.
🪷 … et laisser la nature faire le reste !
Le remplissage se fait ensuite à l’eau de pluie, avec éventuellement l’aide d’un récupérateur d’eau. «Il faut vraiment éviter d’utiliser de l’eau potable, cela vaut le coup d’être patient», glisse Victor Dupuy. Ce dernier note qu’il ne faut pas s’inquiéter en cas d’assèchement au cœur de l’été.
Ne pas oublier d’entretenir régulièrement la mare, en enlevant les branches et végétaux tombés à la surface ou en coupant les parties hautes des plantes aquatiques ou des arbres avoisinants, qui pourraient apporter trop de matière organique dans l’eau. Cependant, il faut éviter de faire cet entretien au printemps – période de reproduction de nombreuses espèces.
Il est recommandé d’aménager les bords de la mare en variant les propositions pour les différentes espèces : tas de bois, murets, talus, graviers, végétation… Si la nature fera son office, il est possible d’installer quelques plantes aquatiques locales, comme des iris, des joncs ou encore des prêles.
Dans tous les cas, il faut absolument éviter d’introduire des espèces végétales envahissantes ou des poissons, qui risquent de nuire aux autres espèces. La biodiversité viendra d’elle-même au fil du temps, et sera l’occasion de multiplier les découvertes et les émerveillements.
À lire aussi
-
Comment bien choisir son terreau pour éviter de détruire les zones humides ?
Tourbe ou rien. La démocratisation du jardinage a gonflé l’achat de terreau qui comporte de la tourbe. L’extraction de ce matériau fossile fragilise, voire détruit, les tourbières, ces réserves de biodiversité uniques qui sont aussi des puits de carbone géants. Des alternatives naissent pour préserver cet environnement précieux. -
Dans le livre pour enfants «Entre terre et eau», 35 animaux nous font redécouvrir notre «jardin commun»
Mare à boue. L’autrice néerlandaise Eva Moraal nous emmène à la découverte de la faune des zones humides, en compagnie d’animaux qui expliquent leur monde aux drôles d’humains que nous sommes. Accessible à partir de sept ans.