Il est invisible et ingéré quotidiennement, sans le savoir, par des millions de consommateur·ices. L’hexane, ce solvant pétrochimique employé pour extraire les huiles végétales, fait parler de lui depuis qu’un livre-enquête lui a été consacré, paru le 18 septembre aux éditions La Découverte.
Dans De l’essence dans nos assiettes – enquête sur un secret bien huilé, le journaliste d’investigation Guillaume Coudray documente ce nouveau «scandale sanitaire silencieux», passé sous les radars depuis plus de 50 ans. L’écho de son enquête a été amplifié par l’ONG Greenpeace, qui a documenté dans une étude parue fin septembre sa présence généralisée dans l’alimentation des Français·es.
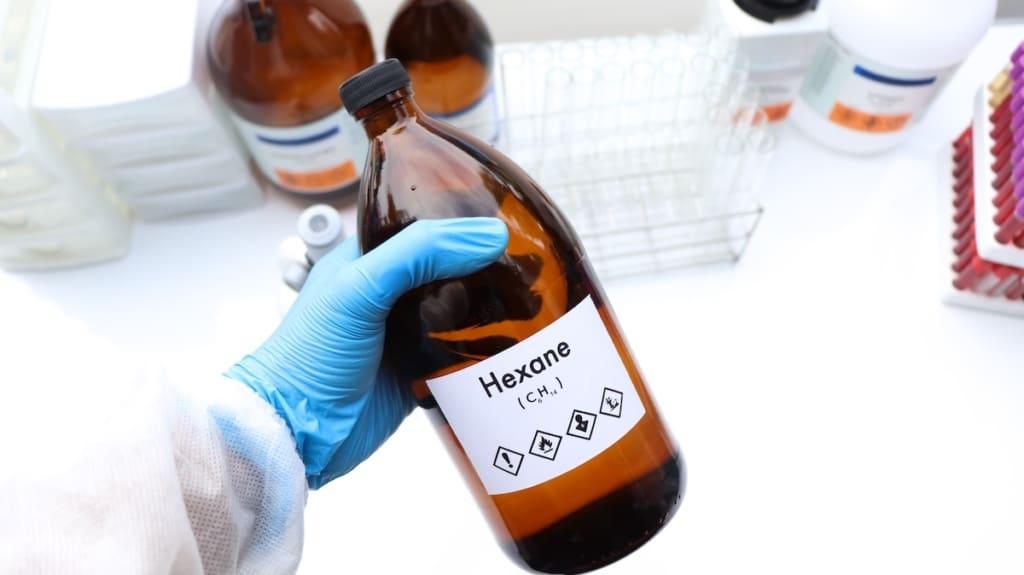
Dans une tribune publiée mardi dans Le Monde, 28 personnalités du monde de la santé (dont Serge Hercberg, Laurence Huc, Jean‑David Zeitoun) alertent sur l’usage de ce solvant dans l’agroalimentaire. À l’heure où la France traverse «une crise historique de la natalité et une progression inquiétante des troubles endocriniens [liés au système reproducteur, NDLR] tels que l’obésité infantile et l’infertilité masculine», l’hexane apparaît pour elles et eux comme «un des suspects qu’il est urgent de contrôler».
Qu’en sait‑on aujourd’hui ? Quels risques y a-t-il pour la santé ? Et comment limiter notre exposition ? On fait le point.
L’hexane, c’est quoi ?
Sa formule brute, C6H14 – pour six atomes de carbone liés à quatorze d’hydrogène – ne saurait suffire à le définir. L’hexane est un sous-produit pétrolier, totalement incolore, à l’odeur proche de celle du carburant. Hautement explosif et inflammable, les industriels de l’agroalimentaire l’ont découvert dans les années 1930, alors qu’il n’était considéré par les pétroliers que comme un déchet bon à brûler.
Il est apprécié aujourd’hui pour sa capacité à dissocier l’huile des graines – colza, tournesol, soja –, dans un processus appelé «trituration». Concrètement, les fabricants commencent par presser mécaniquement les oléagineux. Cette première étape permet d’extraire une grande partie de l’huile. Mais il en reste toujours un peu, piégée dans les résidus solides appelés tourteaux… C’est là que l’hexane entre en jeu : immergés dans ce solvant chauffé autour de 60 degrés celsius (°C), les tourteaux finissent par libérer les derniers pourcentages d’huile qu’ils contiennent.
Solvant à l’efficacité redoutable, l’hexane permet ainsi aux industriels de récupérer jusqu’à 97% de l’huile contenue dans les graines, contre 89% avec la seule pression mécanique.
Où le trouve-t-on ?
Toutes les huiles triturées à l’hexane contiennent un peu de cette molécule. Mais elles ne sont pas la seule voie d’exposition : une fois séparés de l’huile, les tourteaux sont utilisés dans l’élevage pour nourrir les bêtes. Ils se retrouvent in fine dans les produits d’origine animale consommés par les humains.
En mai, une étude de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) a révélé que des résidus d’hexane étaient présents dans 25 produits d’origine animale sur 54 testés, du beurre aux œufs en passant par le poulet. Un constat confirmé plus récemment par Greenpeace, qui a passé au crible 56 produits alimentaires du quotidien, tels que des huiles, les beurres, plusieurs briques de lait – y compris infantile – ainsi que des cuisses de poulet.
Bouteille Lactel, huile de Tournesol Lesieur, motte de beurre Président… «On a regardé quels produits étaient les plus consommés par les Français», résume Sandy Olivar Calvo, chargée de campagne agriculture et alimentation chez Greenpeace, jointe par Vert.

Résultat : de l’hexane a été détecté dans 36 des produits, et ce, de manière quasi-systématique dans les huiles, le beurre et les laits, y compris infantiles. À titre d’exemple, le beurre le plus contaminé est le «beurre tendre demi-sel» de la marque Elle&Vire avec 0,06 milligramme par kilo (mg/kg), les autres mottes avoisinant plutôt les 0,3mg/kg (la motte de beurre «Les croisés» en contient 0,02mg/kg ; le «beurre gastronomique demi-sel Président», 0,03 mg/kg). Du côté des huiles : les bouteilles des deux marques testées (Lesieur et Carrefour) ont toutes été marquées comme positives à l’hexane, la plus contaminée d’entre elles étant l’huile Isio 4 de Lesieur, avec une concentration de 0,08 mg/kg.
Quels risques pour la santé ?
L’hexane est avant tout un neurotoxique : il cible le système nerveux. Dès les années 1960-1970, des cas de maladies professionnelles ont été documentés chez des ouvrier·es exposé·es dans les industries du cuir et de la chaussure. En 1964, des travailleurs et travailleuses d’ateliers de fabrication de sandales au Japon ont présenté des symptômes alarmants. Plusieurs d’entre elles et eux ont d’abord ressenti un engourdissement «des pieds et des mains», suivi d’«une faiblesse dans les jambes et les pieds, décrit une étude américaine. Dans les cas graves, une paralysie s’est développée.»
Dans l’organisme, l’hexane est métabolisé par le foie en «2,5-hexanedione», un composé encore plus toxique qui empêche le fonctionnement normal des nerfs, en rendant difficile ou impossible la transmission nerveuse. Le 30 septembre 2024, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a officiellement classé l’hexane comme «neurotoxique avéré».
Et les risques ne s’arrêtent pas là. L’hexane est également suspecté d’altérer la fertilité en perturbant la fabrication des spermatozoïdes chez les hommes et le développement des ovocytes chez les femmes. En 2014, en France, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a publié en ce sens un ensemble d’avis et de rapports dans lesquels elle identifie l’hexane parmi les substances susceptibles d’affecter la reproduction.
Ces effets ont pour la plupart été observés dans des conditions expérimentales contrôlées – souvent in vitro, sur des cellules humaines et dans des contextes d’exposition aiguë. La question cruciale reste donc de savoir si l’hexane présente un danger à faibles doses, comme celles que l’on peut retrouver dans l’alimentation, et surtout dans le cadre d’une exposition chronique, c’est-à-dire régulière et prolongée.
C’est là que le bât blesse : en 2013, l’Anses a bien établi une valeur toxicologique de référence (VTR) pour l’exposition à l’hexane par inhalation – un seuil au-delà duquel un risque sanitaire est avéré. Mais, «à l’heure actuelle, ni l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa), ni l’Anses ne disposent de VTR pour l’exposition à l’hexane par voie orale», précise le ministère de l’agriculture.
En l’absence de telles données, «c’est le principe de précaution qui devrait primer», plaide Guillaume Coudray, qui souligne qu’aucune étude n’a, à ce jour, permis de conclure que l’hexane est sûr, même à faible dose. Et d’ajouter : «Si la question se posait aujourd’hui d’autoriser ou non l’usage de ce solvant, il est évident qu’il serait interdit, étant donné les effets déjà démontrés par les études.»
Quelle est la réglementation en vigueur ?
Aujourd’hui, si aucune limite maximale d’exposition n’a pu être établie par la science, la législation européenne fixe tout de même une «limite maximale de résidus» (LMR) à 1 mg/kg dans les denrées alimentaires – une norme que les industriels respecteraient globalement, selon Greenpeace.
Seulement, ce seuil a été fixé par le Scientific Committee on Food, prédécesseur de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, et s’appuie sur des données fournies par l’industrie elle-même et datant de… 1996. Un cadre obsolète, donc, qui explique pourquoi, dans un rapport publié en 2024, l’Efsa conclut qu’«une réévaluation de la sécurité de l’utilisation de l’hexane technique comme solvant d’extraction dans la production de denrées alimentaires et d’ingrédients alimentaires» est «nécessaire».
Une nouvelle évaluation des risques est donc en cours, avec une publication prévue pour 2027. En attendant, beaucoup réclament son interdiction, à l’image de Greenpeace et des 71 000 signataires d’une pétition lancée il y a quelques jours par l’ONG. En France, une proposition de loi pour le bannir de la chaîne alimentaire a été déposée en mars dernier par le député (MoDem) du Loiret Richard Ramos.
Greenpeace rappelle par ailleurs que «les industriels pourraient tout à fait se passer d’hexane» et se contenter de la pression mécanique, qui, comme le rappelle l’Efsa, concerne encore «la moitié de l’huile de tournesol et de l’huile d’arachide» vendues sur le marché.
Comment s’en protéger ?
L’un des problèmes de l’hexane est qu’il est considéré comme un «auxiliaire technologique» – une substance non consommée qui aide à la transformation chimique d’un produit –, et non comme un ingrédient à part entière. Donc, il échappe à toute obligation d’étiquetage, ce qui empêche les consommateurs et consommatrices de l’identifier dans les produits qu’ils ou elles achètent.
Sandy Olivar Calvo, membre de Greenpeace, partage quelques recommandations : «Pour les produits d’origine animale, il est quasiment impossible de se protéger. En revanche, pour les huiles, on peut vérifier sur l’étiquette si elles sont pressées mécaniquement, à froid. Cela signifie qu’aucun solvant pétrochimique n’a été utilisé.»
Elle conseille également de privilégier l’agriculture biologique, qui interdit l’usage d’hexane : «C’est une manière concrète de se protéger.»
À lire aussi
-
Pommes, oranges, tomates… Quels sont les aliments les plus contaminés aux pesticides et ceux qui en contiennent le moins ?
Roulement de topinambour. Notre nourriture est contaminée par au moins 183 types de résidus de pesticides. Une pollution stable, mais dont l’effet cocktail – le mélange de ces produits – est peu documenté. Tous les aliments ne sont pas concernés au même niveau. On vous aide à y voir plus clair. -
Cadmium et PFAS dans l’alimentation : qu’est-ce qu’on peut encore manger, et que faut-il éviter ?
À pile ou PFAS. De récentes alertes ont mis en lumière la présence de produits toxiques, les PFAS et le cadmium, dans un nombre important de denrées alimentaires que nous consommons chaque jour. Alors, que peut-on encore manger ? Vert vous aide à y voir plus clair.


