«Les écologistes», des «khmers verts» qui veulent interdire le comté ? Tel est le dernier fantasme du très droitier Figaro Magazine. Dans un article paru le 10 mai, le journal a fait tout un fromage des propos tenus deux semaines plus tôt par le naturaliste et militant animaliste Pierre Rigaux, sur France Inter. Dans une chronique de l’émission La Terre au carré, ce dernier a déploré l’impact écologique du célèbre produit jurassien et s’est interrogé sur l’intérêt de continuer à en manger… sans pour autant demander son interdiction.
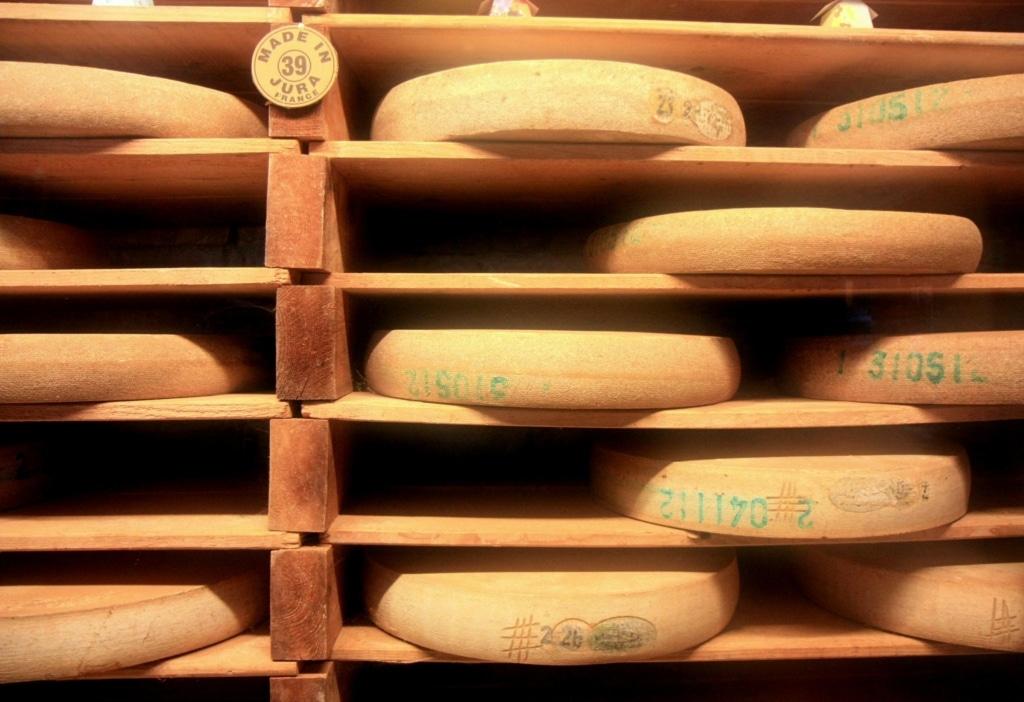
Qu’importe, la polémique a rapidement pris de l’ampleur, s’invitant dans la plupart des médias réactionnaires (JDD, Europe 1, CNews…) ainsi qu’au JT de 13h de TF1. Un slogan #TouchePasAuComté a même été lancé sur les réseaux sociaux, repris par la ministre de l’agriculture Annie Genevard (une Franc-comtoise pur jus) et le préfet du Jura. À tel point que le parti Les Écologistes a publié lundi un communiqué démentant vouloir interdire le fameux fromage et rappelant son attachement à la filière.
Au cœur du problème : le comté en partie responsable de la contamination des rivières jurassiennes
Derrière la polémique se cache une réalité connue de longue date en Franche-Comté : «Les rivières étaient déjà contaminées dans les années 1960, et leur état s’est notoirement dégradé depuis le début des années 2000», analyse François Degiorgi, enseignant-chercheur en hydroécologie au laboratoire Chrono-Environnement de Besançon (Doubs) et co-auteur d’une étude de référence sur la santé des rivières comtoises, publiée en 2020.
«Certaines pratiques qui vont vers l’intensification de la production des fromages comtois [comté, mais aussi morbier, mont d’or, bleu de Gex, etc., NDLR] sont en grande partie responsables de la dégradation des rivières, résume le scientifique. C’est notamment le cas des épandages trop importants de lisier et d’engrais de synthèse (riches en azote, un élément chimique qui favorise la pousse de l’herbe) et du retournement excessif de la terre : comme le sous-sol d’une grande partie des bassins versants du massif du Jura est poreux, lorsque ces amendements sont apportés en excès sur ces sols vulnérables ou déstabilisés, ils sont rapidement transférés dans les milieux aquatiques.»
Une fois dans l’eau, ces substances sont absorbées par certaines algues : «Elles vont croître, colmater les fonds et consommer de l’oxygène en se décomposant, ce qui mène à la disparition des insectes aquatiques [également impactés par les pesticides, NDLR] mais aussi des poissons qui s’en nourrissent», détaille Patrick Giraudoux, professeur émérite d’écologie à l’université de Franche-Comté. Ce dernier rappelle qu’entre 50 et 80% des salmonidés (truites, ombres…) ont disparu depuis la fin des années 1990 dans la Loue, rivière emblématique de la région.
Au-delà des pratiques d’élevage, la transformation du lait pour fabriquer le comté peut aussi avoir un impact : ces dernières années, plusieurs fromageries ont été condamnées pour des rejets polluants dans les rivières. Pesticides, médicaments humains et vétérinaires, hydrocarbures… d’autres contaminations – pas toujours liées à l’agriculture – aggravent l’état des cours d’eau locaux.
«L’élevage est responsable des excès de nutriments dans les rivières comtoises, mais le réchauffement climatique joue aussi un rôle non négligeable et pourrait masquer une partie des efforts faits par les éleveurs ces dernières années», précise Jean-Baptiste Charlier, hydrogéologue au Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et coordinateur d’un projet de recherche sur la contamination des cours d’eau du massif jurassien.
Haies, biodiversité, bien-être animal… d’autres pratiques agricoles en question
Autres problèmes écologiques liés à la production du comté : l’arrachage de haies et la destruction des rochers dans les prairies avec des «casse-cailloux». Ces pratiques, qui visent à faciliter l’activité paysanne, sont citées par Pierre Rigaux dans sa chronique sur France inter, mais aussi par le Comité Interprofessionnel du Gruyère de Comté (le CIGC, qui représente la filière) sur son site web, où il rappelle qu’elles sont «un non-sens agronomique» et écologique.
Plus généralement, «les prairies sont très peu diversifiées, ce qui pose un vrai problème pour la biodiversité, mais aussi pour le goût du fromage», ajoute Patrick Giraudoux, qui a été responsable de la Zone atelier de l’arc jurassien. Les fauches précoces et les épandages nuisent par exemple aux populations d’insectes et à la diversité des fleurs.

La production du comté soulève aussi des problématiques plus larges, propres à l’ensemble de la filière de l’élevage : la souffrance animale (les vaches pouvant être écornées ou envoyées à l’abattoir une fois qu’elles ne sont plus productives) et l’empreinte carbone. Selon l’Agence de la transition écologique, la production d’un kilogramme de fromage à pâte dure comme le comté génère 6,28 kilogrammes (kg) de CO2 équivalent (CO2e, unité de mesure pour comparer les différents gaz à effet de serre), légèrement moins que la feta (6,31 kgCO2e), mais plus que les fromages à pâte molle (5,14 kgCO2e) ou encore la mozzarella (4,71 kgCO2e).
«La focalisation du débat actuel sur le comté nous éloigne peut-être du véritable problème…»
«Le comté n’est pas un mauvais produit, c’est la surproduction qui pose problème», nuance de son côté l’association SOS Loue et rivières comtoises, qui se bat depuis des années contre les différentes pollutions des cours d’eaux jurassiens. Le collectif souligne que la production de lait (donc la quantité d’herbe pour nourrir les vaches) est en constante augmentation depuis plusieurs années.
De son côté, la filière met en avant des progrès dans son exigeant cahier des charges : interdiction des organismes génétiquement modifiés, plafonnement de la production de lait, réduction des épandages d’azote… «Ils essayent d’aller dans le bon sens, encourage Patrick Giraudoux, mais ça va prendre du temps pour en trouver la trace dans les rivières.»
Ces efforts ont aussi été salués dans un rapport de 2021 réalisé par le Bureau d’analyse sociétale pour une information citoyenne (Basic) pour Greenpeace et WWF. Tout en rappelant les limites écologiques de certaines pratiques d’élevage, celui-ci souligne que «les impacts positifs les plus nets de l’AOP comté sont sur le plan socio-économique» : fermes de taille limitée, revenu décent pour les agriculteur·ices, promotion d’un savoir-faire local…
«Finalement, la focalisation du débat actuel sur le comté nous éloigne peut-être du véritable problème qui est la tendance des productions alimentaires à la massification de la production et à leur disponibilité toute l’année et en grandes quantités», estime aujourd’hui le Basic, dans une synthèse publiée sur LinkedIn. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute ?
À lire aussi
-
Ulysse Thevenon, journaliste d’investigation : «Éleveurs et écologistes peuvent avoir des combats communs»
Éleveurs de vérité. Dans le livre «Le sens du bétail», le journaliste indépendant lève le voile sur un système industriel qui broie les éleveur·ses autant que leurs bêtes. Une enquête choc sur les dessous de notre assiette, qui s’appuie sur les témoignages d’une centaine d’agriculteur·ices. -
Serge Zaka, agroclimatologue : «Le problème le plus urgent pour l’agriculture, c’est le manque de froid»
À fleur de chapeau. L’agroclimatologue et figure des réseaux sociaux Serge Zaka pointe les dangers du changement climatique sur les cultures, dans son ouvrage Orages sur le climat, paru le 5 mars. Il explique pourquoi tout le monde devrait parler d’agroclimatologie afin de mieux anticiper ces risques.


