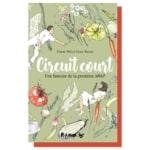Dans une nuée de poussière, l’arracheuse parcourt le champ de lin de long en large, grignotant implacablement à chacun de ses passages le rectangle des tiges qui se tiennent encore debout. D’ici à la fin de la journée, la totalité des huit hectares de la parcelle auront été déracinés et les tiges disposées derrière la machine en d’hypnotiques alignements. Abandonnées à même le sol, les tiges ne seront ramassées qu’environ un mois plus tard, après qu’un champignon se sera développé et aura dégradé la partie pailleuse de la plante, libérant la fibre enfin exploitable. Un processus nommé «rouissage».
Après élimination des graines et de la partie ligneuse de la tige, les fibres longues (la «filasse») sont séparées des fibres courtes (les «étoupes») et peignées. Puis, elles sont vendues à des filateurs qui produiront du fil de lin pur ou mélangé avec d’autres fibres comme la laine ou le coton. Légers et respirants, les vêtements en lin ont l’avantage de ne pas retenir la transpiration.
Autre utilisation qui se développe ces dernières années : la fabrication de matériaux composites en remplacement du plastique et de la fibre de verre. Plus légère que cette dernière, mais tout aussi résistante, la fibre de lin peut être utilisée pour la construction de coques de navires, de meubles ou comme isolant phonique dans les habitations.

Arrivant depuis l’autre bout du champ, la silhouette de Mathieu Grenier, avec ses lunettes rondes et sa barbe de dix jours, se dessine sous le soleil de cette fin juillet. En 2010, l’agriculteur et sa femme Sophie ont repris la ferme des parents de cette dernière à proximité de Cany-Barville (Seine-Maritime). Une ferme que le couple a immédiatement convertie à l’agriculture biologique, où l’on pratique la polyculture : on y élève des vaches laitières et l’on y fait pousser, en plus du lin textile, du blé, de la luzerne et de l’herbe fourragère qui servent à nourrir les bêtes.
À peine plus de 1% de la surface de lin en agriculture biologique
«La principale raison de notre passage au bio, c’était la conscience écologique par rapport aux pollutions par les produits chimiques», explique celui qui est également porte-parole local du syndicat Confédération paysanne. Contraint de hausser le ton pour couvrir le vrombissement de l’arracheuse ‒ propriété de sa coopérative ‒ qui s’approche, il précise : «certaines personnes disent “l’écologie, c’est bien gentil, mais il faut quand même produire“. C’est une erreur de penser comme ça, déjà parce qu’en bio, on produit vraiment, mais surtout, on répond au problème de la pollution par les phytos».
Quentin Bordier est ingénieur agronome et membre de l’association Lin et chanvre bio, qui fait la promotion de ce mode d’agriculture à l’échelle nationale à travers des formations et l’animation d’un réseau regroupant paysans bio et transformateurs. Il détaille à Vert les atouts agronomiques du lin : «C’est une culture qui a des besoins limités en azote [qui se passe assez facilement d’engrais, NDLR] et qui donc correspond bien à l’agriculture biologique».

Par ailleurs, hors sécheresse exceptionnelle, cette plante ne nécessite aucune irrigation lorsqu’elle est cultivée dans un climat adapté, comme celui du nord-ouest de l’Europe. Selon FranceAgriMer, la consommation du lin en eau serait 20 fois inférieure à celle du coton. Une propriété intéressante à l’heure du changement climatique et alors que l’irrigation a augmenté de 14% en France depuis 2010, d’après France nature environnement.
Un chiffre qui cache une forte disparité territoriale : en Normandie et dans les Hauts-de-France, les deux grandes régions françaises de production de lin, l’irrigation a progressé sur cette même période de 26,3 et 77,7 %.

Bien que la France soit le premier producteur mondial de lin, la filière biologique y est pourtant encore à la traîne. Sur les 131 000 hectares de lin cultivés en France en 2023 – soit 87% de la production européenne –, seuls 1 462 le sont en bio : à peine plus de 1%. Une situation que déplore Mathieu Grenier, alors que de nombreux captages d’eau potable dans sa région dépassent largement les normes pour les pesticides.
Une filière textile qui tente de se relocaliser
L’écart de rendement entre lin biologique et conventionnel est pourtant faible : «sur les céréales, on fait moitié moins par rapport à du conventionnel alors qu’en lin, on est sur des rendements qui ne sont que 20 à 30% inférieurs. Et il y a des années où on fait pratiquement les mêmes» confie Mathieu Grenier. Le prix plus élevé du lin biologique contribuerait à rendre ce type d’agriculture tout aussi intéressant que le conventionnel.
Les choses sont peut-être en train de changer, alors que la production de lin biologique est passée d’une cinquantaine d’hectares cultivés en 2014 à 1 462, donc, en 2023.

En 2019, différents acteurs de la filière – dont Lin et chanvre bio – ont lancé le projet LinPossible dont l’ambition est de recréer des filières textiles 100% françaises. Depuis les années 1990 et la délocalisation de nombreuses usines textiles vers l’Asie, une écrasante majorité du lin français est exporté vers la Chine pour y être filé et utilisé dans la confection de vêtements. Ces derniers seront pour une grande part réexpédiés vers l’Europe. S’il existe en France quelques ateliers de confection de vêtements, surtout tournés vers le luxe, il n’y avait plus aucune filature depuis 2005, année du départ de l’entreprise Safilin vers la Pologne.
Pourtant, les choses semblent là aussi évoluer. Deux nouvelles filatures de lin ont vu le jour depuis 2020, et l’entreprise Safilin a rouvert une petite unité de production à Béthune, dans le Pas-de-Calais.
«Que l’agriculture soit possible en bio, c’est une chose, mais ensuite, il faut qu’elle puisse vivre avec tous les acteurs de la filière – teilleurs, filateurs… – et être vendu en tant que lin bio», précise Quentin Bordier. Pour atteindre cet objectif, l’association s’appuie sur le label GOTS (Global Organic Textile Standard), une certification internationale qui permet de garantir la traçabilité d’un tissu biologique, depuis le champ jusqu’au produit fini. À l’heure actuelle, 11 usines de teillage sur les 22 que compte le pays, ainsi que la filature Safilin de Béthune, sont certifiées par ce label.
Cet article est issu d’«Eau secours» : notre série d’enquêtes sur l’eau pour faire émerger les vraies bonnes solutions dans un monde qui s’assèche. Mégabassines, régies de l’eau, technosolutionnisme… Pendant tout l’été 2024, nous explorons les sujets les plus brûlants liés à notre bien le plus précieux. Cette série est financée en grande partie par les lectrices et lecteurs de Vert. Pour nous aider à produire du contenu toujours meilleur, soutenez Vert.
À lire aussi
-
«Les champs des possibles» : on vous présente le poster de Vert sur l’agriculture
Posterre. Quels sont les aliments qui ne plombent pas trop notre empreinte carbone ? Quelle quantité d'eau consomment les champs de maïs ? Et, surtout, le monde agricole peut-il sauver la planète ? Découvrez le nouveau poster de Vert sur l'agriculture pour tout savoir de ce vaste sujet. -
«Circuit court» : et le rêve d’une agriculture nourricière et relationnelle devint réalité
Circuicui. La nouvelle bédé de Claire Malary et Tristan Thil retrace l’aventure de la création de la première association pour le maintien de l'agriculture paysanne (Amap) en France. Légumes et folles tribulations ; tout y est !