En biologie comme en économie, on gagne à s'enrichir d'autres voix pour orienter nos choix.

Et si on écoutait mieux la nature ?
Durs de la feuille. Que ce soit à des fins scientifiques ou esthétiques, la bioacoustique nous invite à tendre une oreille attentive au vivant. De quoi nous inciter à entendre autrement les alertes émises par la biosphère ?
Le 8 février dernier, 17 chercheur·ses de neuf pays, dont la France, ont proposé de créer une bibliothèque mondiale de la biophonie sous-marine (Glubs). « Alors que la biodiversité mondiale est en déclin et que le paysage sonore sous-marin est altéré par les activités anthropiques, nous avons besoin de documenter, de quantifier et de comprendre les sons biologiques et leurs sources – avant, peut-être, qu’elles ne disparaissent », ont déclaré les scientifiques regroupé·es au sein du Programme international de recherche de l’océan silencieux (IQOE).
Dans leur proposition, elles et ils souhaitent rassembler la totalité des enregistrements sous-marins, compilés dans diverses banques sonores telles que la sonothèque du Muséum national d’histoire naturelle, au sein d’une plateforme ouverte accessible en ligne. Celle-ci permettrait d’inventorier avec plus de précision les sources sonores sous-marines connues et non identifiées, d’utiliser des algorithmes pour détecter et classifier les sons et de comparer les métadonnées d’enregistrements. Elle donnerait aussi naissance à une bibliothèque partagée ouverte au public, avec tout ce que cela permet d’envisager en termes de sciences participatives.

Cette information, relayée par Actu Environnement, n’a pas fait grand bruit dans l’actualité. Elle mérite pourtant qu’on s’y arrête tant ce champ de recherche est aussi méconnu que fondamental : les sons enregistrés dans la nature sont utiles pour élaborer des cartes de distribution géographique des espèces. Avec ce genre de cartographie, les scientifiques peuvent suivre la dynamique de certaines populations et mesurer leur évolution à l’aune du « brouillard acoustique » généré par les activités humaines (Vert).
Sur Terre aussi la faune et la flore sont sensibles à nos perturbations : à court terme, le bruit chasse les pollinisateurs et les insectes. À long terme, il réduit de manière quasi définitive le nombre de jeunes pousses des arbres, d’après une étude publiée en avril 2021 dans Proceedings of the Royal Society B. Pour Christian Holl, chasseur de sons passionné et musicien de la nature mis à l’honneur dans le documentaire « Carnets sonores de Guadeloupe » diffusé lundi 21 février sur la1ere.fr et France 3, « écouter la nature est la meilleure manière d‘appréhender la vie, de se rendre compte que même quand on ne voit pas, le vivant se manifeste à travers les sons qu’il peut émettre ». Équipé de micros ultra-sensibles et d’un dispositif d’enregistrement innovant qu’il trimballe depuis 30 ans dans le monde entier, cet « archéologue du son » invite par sa démarche, essentiellement esthétique, à écouter la nature dans toute sa partition. La suite à lire sur Vert

· Jeudi, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a indiqué qu'il est « peu probable » que la téléphonique 5G présente des « risques nouveaux » pour la santé. Son avis, confirme des travaux préliminaires officialisés en avril 2021 (Vert). Le gouvernement n'avait pas attendu de connaître ces résultats pour lancer en décembre 2019 le déploiement de cette cinquième génération de téléphonie mobile. Son empreinte est pourtant incompatible avec les objectifs de baisse des émissions de CO2 (Vert). AFP
· Ce vendredi, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a annoncé que l'Etat français va recapitaliser EDF à hauteur de 2,1 milliards d'euros. Le géant du nucléaire est plombé par une dette colossale - de 42,3 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 69 milliards en 2020 – et affronte un hiver compliqué par une production nucléaire en berne (Vert) et les mesures imposées par le gouvernement pour limiter la hausse des factures d'électricité. Le Monde


1 800 000 000 000 $
Chaque année, environ 1 800 milliards de dollars de subventions ont pour effets (secondaires) d'accélérer la destruction d'écosystèmes et l'extinction d'espèces. Et ce ne sont pas des « Amish » qui le déplorent mais la « B Team », une organisation internationale de grand·es patron·nes engagé·es pour la planète (et dont le bilan en la matière est d’ailleurs peu reluisant). Selon leur rapport, paru jeudi, les secteurs des énergies fossiles, de l'agriculture et de l'eau reçoivent plus de 80% de toutes les subventions néfastes pour l'environnement. « Pourquoi la réforme de ces subventions importe à des champions du business ? », interroge la B Team dans un communiqué. « C'est assez simple. Une planète en bonne santé rend la prospérité possible. Cela permet au business de s'épanouir. » Si la nécessaire protection des hommes et des écosystèmes ne suffisait pas à convaincre les responsables politiques d’agir, peut-être la protection du business emportera-t-elle leur conviction ?

Plaidoyer pour Une économie à nous
Les financiers à l’amende. Dans son manifeste Une économie à nous, « Changer de regard pour redéfinir les règles du jeu », l’entrepreneuse Eva Sadoun plaide pour se réapproprier l’économie afin de dépasser les croyances en une doctrine libérale immuable, inventer et mettre en pratique de nouveaux modèles centrés sur la justice sociale et climatique.
Comment rester sous 1,5°C de réchauffement si l’on ne modifie pas les règles économiques qui nous régissent ? Si l’on n’instaure pas de nouveaux indicateurs de mesure du succès d’un pays - tels que le produit intérieur brut (PIB) – ou de celui des entreprises ? Si l’on ne remet pas profondément en question notre « système de domination » qui sous-tend une « économie de la violence » ? Dans les pas de Virginia Woolf qui s’interrogeait sur les conditions favorables à l’écriture des femmes dans son ouvrage Une chambre à soi, Eva Sadoun se penche sur les préalables à un changement de modèle économique.
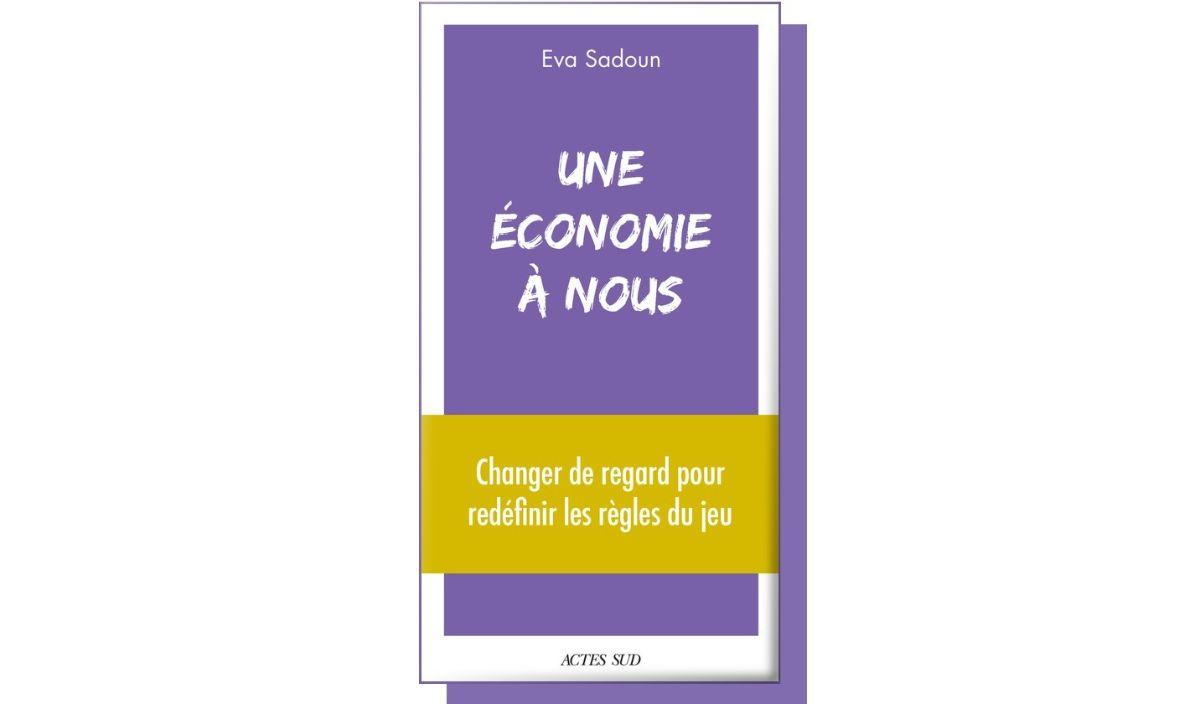
Partant du constat que le capital a « une classe » – les plus fortunés – et « un genre » – les hommes –, l’entrepreneuse enjoint à se saisir de cette discipline pour faire émerger des propositions alternatives. Elle rappelle que l’entreprise n’est pas « neutre » ni l’économie « mathématique » mais que celles-ci sont le fruit de décisions individuelles et collectives.
Si l’autrice se défend d’appartenir à un courant de pensée en particulier et renvoie dos-à-dos « la décroissance des écologistes » et « l’innovation des libéraux », elle reprend en réalité nombre de constats et de postulats des tenant·es de la sobriété. Pour elle, « il est possible d’avoir un discours radical en matière de justice sociale et climatique sans stigmatiser le monde de l’entreprise ». Nouvelles formes de représentation, intervention plus forte de l’Etat, finance démocratique et nouveau rôle des actionnaires : ce petit ouvrage bien agencé remet sur la table des propositions de changement en même temps qu’il démystifie un domaine encore trop réservé à quelques-uns.
Eva Sadoun, Une économie à nous, « Changer de regard pour redéfinir les règles du jeu », Actes Sud, février 2022, 160 p., 12€

Climat : quand les lobbies s'en prennent à la science
Lobbytomie. Il fut un temps, nous raconte le réalisateur danois Mads Ellesoe, où les responsables politiques étaient déterminé·es à agir pour réduire les émissions de CO2. C’était en 1988 et la création du groupe international d’experts intergouvernemental pour le climat (GIEC). Et puis les compagnies pétrolières ont commencé leur travail de sape, en finançant des think tanks et des pseudo-expert·es, qui ont méthodiquement semé le doute sur ce qui faisait alors l’objet d’un consensus scientifique. Diffusé sur Arte, le documentaire « Lobby Climatosceptique » remonte le fil de cette escroquerie intellectuelle en interrogeant, notamment, ses acteurs clés. Frissons garantis.
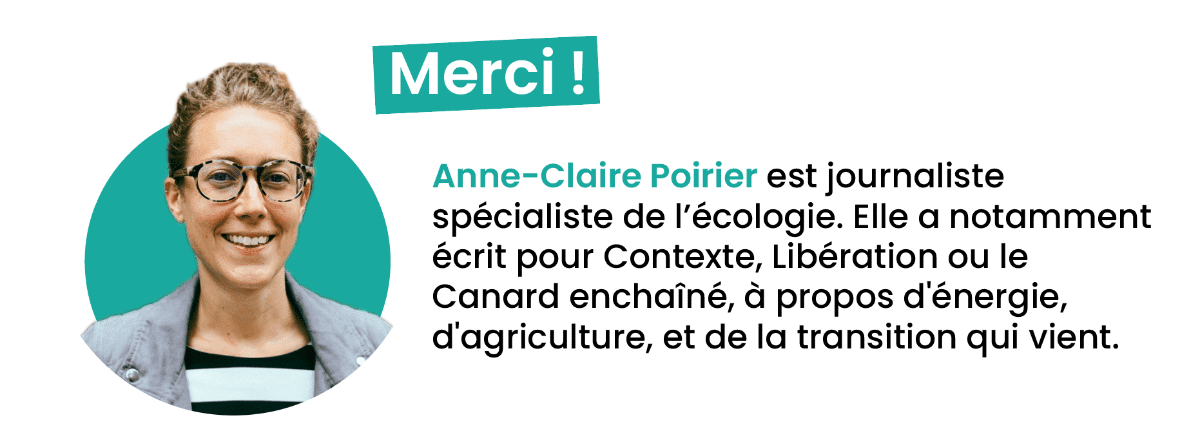
+ Anne-Sophie Novel, Justine Prados et Juliette Quef ont contribué à ce numéro

