À la vue des berges déblayées du Rhin alsacien, Guillian Brousse, cheffe de projet EDF, est emballée. « Les travaux ont déjà démarré, nous avons sorti les batardeaux que nous avons amenés de l’autre côté de l’aménagement. » Ce qui semble n’être qu’un détail technique marque le début d’un chantier de trois ans, particulièrement attendu, sur les barrages de Rhinau et Marckolsheim (Bas-Rhin). L’objectif est honorable : il s’agit d’ouvrir la voie vers la Suisse aux poissons migrateurs, en construisant deux immenses passes-à-poissons, « parmi les plus grandes d’Europe », insiste Guillian Brousse. Chacune comportera un kilomètre de bassins en enfilade et offrira un débit suffisamment « attractif » pour que les poissons, orientés par les courants, ne lui préfèrent celui généré par les turbines. EDF, très enclin à communiquer, assure que jusqu’à 150 emplois seront créés par ces chantiers.
Cet enthousiasme ne doit pas faire oublier que tout ceci arrive bien tard. Le retour du saumon à Bâle était initialement promis pour l’an 2000, puis pour 2020. Les passes-à-poissons de Rhinau et Marckolsheim seront respectivement livrées, si les délais sont tenus, en 2025 et 2026.
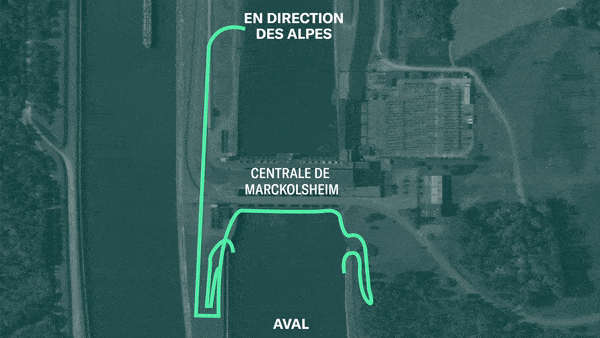
Le saumon, fer de lance d’un combat écologique
Espèce emblématique de la région bâloise, le saumon a disparu définitivement des eaux suisses dans les années 1950, du fait des nombreux barrages construits sur le Rhin, pour produire toujours plus d’électricité. Mais en 1986, après l’incendie d’un entrepôt de produits chimiques du groupe Sandoz, près de Bâle, qui a tué ce qu’il restait de biodiversité dans le fleuve, les États rhénans prennent conscience de l’enjeu écologique. Ces derniers s’organisent alors sous la houlette d’une nouvelle organisation, la Commission internationale pour la protection du Rhin (CIPR), créée pour coordonner les efforts visant à dépolluer, revitaliser le Rhin et ramener les poissons en Suisse
Le saumon atlantique devient le symbole de ce combat écologique. Cette espèce étant très sensible à la qualité de son environnement, son retour indiquerait le succès de la restauration de tout un écosystème. La date butoir est prévue pour l’an 2000, soit 13 ans plus tard. « C’était ambitieux, mais c’était nécessaire pour continuer à pousser dans ce sens », reconnaît Marc Daniel Heintz, secrétaire exécutif de la CIPR.
En 2000, un deuxième accord plus précis est signé : Saumon 2020. Les États rhénans s’engagent à rétablir la continuité écologique du fleuve, de la mer du Nord au lac de Bâle, ce qui implique la libre circulation des espèces migratrices sans intervention humaine. Mais une nouvelle fois, les promesses n’ont pas été tenues. À la veille de l’échéance, Rhinau, Marckolsheim (Bas-Rhin) et Vogelgrun (Haut-Rhin), trois barrages français, bloquaient encore le chemin vers la Suisse. « Nous avons essayé de faire pression sur les différents pays, en leur demandant de mettre la pression sur la France, se rappelle Christian Hössli, militant WWF en Suisse, investi dans la campagne de lobbying Salmon Comeback (le retour du saumon). C’est tout de même bête qu’un seul État bloque le processus. »
En effet, fin 2019, sous la pression de ses voisins, Elisabeth Borne, alors ministre de la transition écologique depuis quelques mois, a dû trouver en urgence des solutions à proposer à la conférence de clôture du programme, prévue pour février 2020 à Amsterdam. Des dates ont donc été arrêtées pour la construction de deux passes-à-poissons à Rhinau et Marckolsheim, et un nouvel accord a été signé, lors de cette conférence pour établir la nouvelle échéance à 2030. Mais pour Vogelgrun, la France ne s’est engagée qu’à « étudier la meilleure solution pour le passage dans le vieux Rhin [à son niveau] », laissant planer le doute sur sa capacité, cette fois encore, à ouvrir le Rhin supérieur, dans les temps.
Vogelgrun, le gigantesque grain de sable dans l’engrenage
Le doute est d’autant plus permis que le barrage de Vogelgrun est un casse-tête d’ingénieur. À sa hauteur, le Rhin se sépare en deux branches. D’un côté, le Grand canal dispose d’un courant fort, intéressant pour la production d’énergie hydroélectrique, et qui attire les poissons migrateurs ; de l’autre, le vieux Rhin a un débit plus faible, mais qui serait plus favorable à la vie aquatique. « L’objectif c’est de faire en sorte que les poissons qui se présentent devant la centrale de Vogelgrun puissent rejoindre le vieux Rhin, situé à quelques centaines de mètres sur l’autre embranchement, explique Régis Thévenet, directeur chargé de l’environnement chez EDF Hydro-Est. Ça amène un niveau de complexité qui nécessite encore de mener un certain nombre d’études ».

Faut-il passer au-dessus ou en dessous de l’île qui sépare les deux bras du fleuve ? « Tout le monde n’est pas d’accord. On a sollicité des ingénieurs du monde entier et on ne sait pas faire de manière sécurisée, explique Jean-Franck Lacerenza, directeur de l’association alsacienne Saumon-Rhin. Si c’est pour faire un tunnel de 300 mètres sans lumière, où les poissons bloquent au bout de cinq mètres, on aura engagé 160 millions d’euros pour rien ». Les estimations de la facture se rapprochent toutes de 100 millions d’euros au minimum. Avant 2030, reste donc à s’assurer qu’une des options fonctionne, lancer les travaux et pour cela… débloquer des fonds publics faramineux.
Des passes à poissons aux budgets exponentiels
Au fil du temps, le coût des installations n’a fait qu’augmenter. En 2000, la première passe-à-poissons franco-allemande ouvrait, à Iffezheim, au sud de Karlsruhe (Allemagne), pour un montant de neuf millions d’euros. « Depuis les années 2000, EDF a investi avec l’Agence de l’eau 55 millions d’euros pour la réalisation de six ouvrages de franchissement », résume Régis Thévenet.

Rien à voir, donc, avec les budgets à aligner pour les trois derniers barrages. Pour Rhinau et Marckolsheim, la facture s’élève à 80 millions d’euros. Un montant débloqué dans le cadre du programme France Relance, déployé à la suite de la crise sanitaire.
L’argument financier pour expliquer les retards a eu tendance à agacer les voisins néerlandais. Les Pays-Bas, eux, ont dû dépenser 130 millions d’euros pour ouvrir, en 2018, les écluses d’Haringvliet, situé à l’embouchure du Rhin sur la mer du Nord. « Ils ont dû relocaliser leur production d’eau potable, s’assurer que l’entrée de l’eau salée n’allait pas être trop néfaste. Ça a entraîné une controverse politique », se remémore Marc Daniel Heintz de la CIPR. Après 18 ans d’un chantier mené à bien pour tenir les engagements néerlandais, il paraît malvenu de la part de la France de ne pas tenir les siens. D’autant que l’Hexagone, comme les Pays-Bas, doit respecter la Directive-cadre de l’Union européenne sur l’eau, selon laquelle la continuité écologique des fleuves doit être rétablie dès 2027.
Trop de temps à louvoyer
Difficile, toutefois, de taxer la France d’immobilisme. Depuis 2015, 193 ouvrages ont fait l’objet de travaux et 609 kilomètres de cours d’eau du bassin rhénan ont été revitalisés, offrant autant d’habitats et de frayères potentielles (zones où les poissons déposent leurs œufs) aux saumons arrivant jusqu’à Gerstheim. L’État s’est donc occupé de ses rivières, comme l’Ill et la Bruche. Plutôt que des passes à poisson, il suggère à plusieurs reprises de mettre en place une barge de transport (sorte de « passe mobile ») pour acheminer les poissons migrateurs à l’amont des barrages. « La France, appuyée de ses scientifiques spécialisés, considérait que cette solution serait beaucoup plus efficace, moins coûteuse et plus rapide, [que c’était la] seule solution pour respecter l’échéance de 2020 », précise le ministère de la Transition écologique. Cette méthode nécessitant une intervention humaine, elle a été rejetée par la CIPR.
Et pendant que la France tergiverse, les rivières suisses patientent pour retrouver un écosystème équilibré. Des espèces invasives se sont incrustées, profitant de l’absence du saumon. Son retour « serait bénéfique parce que nous reviendrions à une répartition plus naturelle des espèces, explique la scientifique allemande Marion Martens. Nous avons maintenant trop de petits poissons en provenance de la région du Danube. »

Après 35 ans d’efforts collectifs pour réintroduire l’espèce dans le bassin rhénan, le bilan est en demi-teinte et d’autres problèmes sont en attente. La dévalaison, d’abord, soit la descente des jeunes saumons vers la mer : pour l’heure, ils sont obligés de passer à travers les turbines des centrales. « Certains sont tués, beaucoup survivent au passage des turbines, mais sont désorientés, blessés […] après être passés à la machine à laver », les laissant vulnérables aux prédateurs, comme les cormorans, explique Marion Martens.
L’autre enjeu majeur est le dérèglement climatique, car le saumon aime une eau fraiche. « En ouvrant les barrages, on ne va pas résoudre le réchauffement climatique, analyse Jean-Franck Lacerenza. Mais on va permettre aux poissons de mieux s’acclimater. Ils ne vont pas rester bloqués à des endroits où l’eau se réchauffe trop vite ». Cet été, le niveau du fleuve a baissé de près de 40 centimètres en Allemagne, réchauffant les profondeurs. Il serait de bon thon de s’y mettre.
Cet article a été réalisé à avec le soutien du journalismfund.eu.
À lire aussi
-
Les immenses « fermes à saumons » débarquent en France
Pour alimenter un marché en plein essor, pas moins de trois usines d’élevage terrestre de saumons devraient bientôt voir le jour en France. Des installations industrielles qui menacent d'entraîner pollutions, atteintes à la biodiversité et surconsommation d’eau, et nuisent au bien-être des poissons. -
2022 bonnes nouvelles (ou presque) pour l’écologie en 2022
2022 a connu son lot de nouvelles peu encourageantes, voire franchement inquiétantes, mais il y eut tout de même quelques raisons de se réjouir. Voici plus de 80 bonnes nouvelles pour se quitter en bons termes avec cette année qui s'achève.


