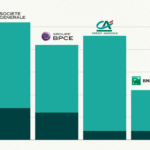Pasco a le regard fatigué. Le soleil se lève au-dessus de Nantes (Loire-Atlantique) pendant que le trentenaire attend patiemment son train. Ce jour-là, il a dû se lever tôt, parce qu’il a rendez-vous au moulin d’Angreviers, posé sur la Sèvre nantaise, à quelques kilomètres de là. Cette rivière est le dernier affluent d’importance de la Loire avant l’océan Atlantique.
«On a eu une forte crue la semaine dernière, ça a inondé le bâtiment. Donc, je vais aller donner un coup de main pour le nettoyage», explique Pasco, entre deux bâillements. Après une vingtaine de minutes de TER et un peu de marche, il rejoint trois autres «moulinistes». Coups de pelle. Coups de raclette. À la mi-journée, le sol est nettoyé.

Chacun·e de ces volontaires a pris un peu de temps sur sa journée pour venir régler le problème de toute une communauté, dont ils ne sont qu’un échantillon ce matin-là. Toutes et tous sont membres d’Énergie de Nantes, une association née en 2019 et propriétaire du rez-de-chaussée du moulin d’Angreviers depuis 2022.
Une chute d’eau rapide, une turbine, un alternateur… dans cette bâtisse vieille de plusieurs siècles, elles et ils ont trouvé tout le nécessaire pour produire de l’électricité d’origine hydraulique, une forme d’énergie renouvelable. Le pari semble fonctionner : en mars 2024, Énergie de Nantes est devenu le premier producteur et fournisseur d’électricité associatif de France. Aujourd’hui, près de 260 bâtiments à Nantes et aux alentours, de particuliers et de professionnels, sont approvisionnés par l’association.
Reprendre la main sur l’énergie
Avant d’intégrer Énergie de Nantes, Pasco n’y connaissait pas grand-chose. «Moi, mon truc c’est plutôt l’informatique, à l’origine», souligne le jeune homme qui, après plusieurs années d’études dans ce secteur, est en recherche d’emploi.
Entre la production, le transport et la distribution, pas évident de comprendre le marché du kilowatt-heure. Pasco était tout de même convaincu d’une chose : il n’est pas normal de se sentir dépassé par une ressource que l’on utilise tous les jours.

Selon Pierre Wokuri, chercheur en sciences politiques au laboratoire Arènes (Rennes, Ille-et-Vilaine) et auteur d’Une énergie verte et démocratique ?, le sujet n’a rien de sorcier. Il l’assure, si elle est perçue comme un concept obscur, c’est parce que tout un mécanisme vise à dépolitiser l’énergie : «Un ensemble d’acteurs, comme les ingénieurs des grands corps de l’État, ont intérêt à ce qu’elle soit perçue comme un enjeu technique. Cela leur permet de garder le contrôle sur le débat.»
«Notre but, c’est de se réapproprier ce sujet. On est tous et toutes concernés par nos moyens de subsistance. Se chauffer et s’éclairer, ça en fait partie», estime Régis. Lui, fait partie de l’association depuis sa création : il a participé à l’élaboration d’une enquête qui a donné naissance à Énergie de Nantes en 2019. Réalisée par un petit groupe pendant près de neuf mois, elle a permis de déterminer quels leviers d’action employer pour répondre la question suivante : «Comment agir à l’échelle locale pour une énergie plus verte et populaire ?»
Pour reprendre la main sur l’énergie, l’association nantaise mise sur l’entraide. Certain·es s’y connaissent, d’autre moins, mais tout le monde apprend des autres à l’occasion d’assemblées générales et de chantiers participatifs. «Je ne sais pas tout, mais comme je suis une ancienne électricienne, j’ai pu apporter des savoirs sur des aspects techniques», raconte Bertille, adhérente active depuis deux ans.

Au quotidien, les moulinistes se rendent deux à trois fois par semaine au moulin d’Angreviers pour s’assurer du bon fonctionnement des équipements. Leur plus gros travail est de nettoyer le filtre qui garantit l’arrivée d’une eau propre, et d’enlever les quelques feuilles mortes qui s’y collent. «C’est en faisant qu’on apprend», lance Pasco.
Pour Pierre Wokuri, ce type d’implication citoyenne «conduit les personnes à mieux comprendre le fonctionnement des énergies renouvelables, et donc à être moins réticentes à leur égard». Il assure que cela permet d’éviter le phénomène «Nimby», pour Not in my backyard, en anglais – que l’on peut traduire par «pas dans mon jardin». Cette expression désigne l’attitude d’une personne qui refuse l’implantation dans son environnement d’une infrastructure d’intérêt général dont elle pourrait subir des nuisances.
Or, d’après l’Agence de la transition écologique (Ademe), il est vital de faire comprendre l’importance de ces énergies, et de rendre acceptable leur implantation locale, pour que la France puisse atteindre ses objectifs climatiques : réduire les émissions nationales de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030.
En 2024, la production d’électricité en France est essentiellement nucléaire (67%), selon les derniers chiffres du gestionnaire du réseau RTE. La part des énergies renouvelables (éolien, hydraulique, solaire et biomasse) se monte à 28% du mix électrique. À terme, ces sources d’électricité décarbonée doivent remplacer les énergies fossiles, qui représentent encore près de 60% de toute l’énergie consommée en France.
«En résolvant nos problèmes de surconsommation, on résout aussi les problèmes de crise écologique»
Pour les membres d’Énergie de Nantes, se cantonner à produire et à fournir de l’énergie renouvelable ne suffira pas pour mener à bien la transition écologique. Pour qu’elle soit réussie, elles et ils estiment que le mouvement doit s’accompagner d’une lutte contre la précarité énergétique.
«C’est lié : les personnes les plus précaires vivent souvent dans des passoires thermiques, donc elles consomment plus d’énergie, et leur impact sur l’environnement est mauvais», raconte l’un des moulinistes. D’après la Fondation Abbé Pierre, douze millions de Français·es ont souffert du froid dans leur logement en 2024.

En plus de faire exploser les factures d’électricité, ces logements énergivores (repérables par un diagnostic de performance énergétique (DPE) classé F ou G) sont néfastes pour le climat, puisqu’ils émettent au moins 100 kilogrammes d’équivalent CO2 par mètre carré et par an.
Ainsi, pour l’association, avant toute production d’énergie renouvelable, il est nécessaire de procéder à une rénovation thermique de l’ensemble des bâtiments. «En résolvant nos problèmes de surconsommation, on résout aussi les problèmes de crise écologique», juge Stéffie, la co-présidente d’Énergie de Nantes.
«L’argent est mis dans un pot commun et on décide tous ensemble de ce qu’on en fait»
Pour ce faire, l’association garde un œil sur ses souscripteurs et souscriptrices qui affichent une trop forte consommation d’énergie. «On va chez eux, on prend des caméras thermiques, puis on tente de comprendre d’où vient le problème et comment on peut le résoudre», détaille Stéffie.
En attendant qu’une solution soit trouvée, elle assure qu’Énergie de Nantes essaye de ne pas trop augmenter leur facture. «Comme c’est un projet collectif, l’argent est mis dans un pot commun et on décide tous ensemble de ce qu’on en fait. Ainsi, on équilibre en fonction de qui peut payer combien et quand», détaille Régis, en précisant «ne pas faire de la charité, mais juste de l’entraide.»
Concrètement, l’association fixe et revoit ses tarifs tous les deux mois lors de ses assemblées générales. Tous·tes les souscripteur·ices sont invité·es, puisqu’en se fournissant chez Énergie de Nantes, elles et ils en deviennent automatiquement adhérent·es. «Ainsi, les prix sont votés par les utilisateurs avec une seule chose en tête : l’association ne doit pas faire de bénéfices, mais couvrir ses frais de fonctionnement, dont la principale dépense est la location d’un bureau de réception à Nantes», relève le co-fondateur.
Se fournir chez Énergie de Nantes coûte un peu moins cher que d’aller chez EDF, le premier producteur et fournisseur d’électricité en France. On note une différence de près de 15 euros par mois pour une famille avec deux enfants qui consommerait 692 kilowatt-heure (kWh) avec une puissance souscrite de neuf kilovoltampères (kVA).

Pour atteindre l’équilibre financier, l’association espère fournir mille foyers d’ici fin 2025. «Après, notre défi sera de suivre en termes de production. Pour l’heure, nous sommes dépendants du moulin d’Angreviers, qui a tendance à tomber en panne. Pour y remédier, nous collaborons avec Zéphir, un producteur local d’énergie éolienne. L’objectif, sur le long terme, est d’être totalement indépendant», précise Régis.
Pour lui, le modèle d’Énergie de Nantes est imitable partout où existent des moulins hydrauliques. «Rien que sur les bords de la Sèvre nantaise, on compte près de 150 moulins. Dans un monde idéal, s’ils étaient tous remis en marche, on pourrait alimenter l’ensemble du département en énergie renouvelable et locale», se met-il à espérer.
Pour Pierre Wokuri, une telle révolution énergétique ne peut se faire que si des politiques publiques ambitieuses sont mises en oeuvre : «Pour que ça marche, ce genre de projet coopératif doit être reconnu comme un acteur spécifique, comme peut l’être l’agriculture bio dans le cadre des politiques agricoles».
Énergie de Nantes discute avec Nantes Métropole pour alimenter certains bâtiments de l’intercommunalité, dans le cadre d’un appel à projet. «Un premier pas pour peser sur les politiques locales», se réjouit Régis. De quoi apporter de l’eau au moulin des adeptes de l’électricité associative ?
À lire aussi
-
Pourra-t-on toujours produire de l’électricité dans une France à sec ?
De l’eau dans le gaz. Plus de 80% de l’électricité produite en France dépend directement des généreuses ressources en eau du pays. Avec le changement climatique qui s’aggrave, la multiplication des sécheresses crée de nouvelles vulnérabilités à prendre en compte. -
Les banques européennes financent toujours beaucoup plus les énergies fossiles que les alternatives
Trop fossile ! Les banques européennes continuent de soutenir massivement les nouveaux projets pétroliers et gaziers, révèle l’ONG Reclaim Finance. Les investissements dans les renouvelables demeurent, eux, très minoritaires.