Le 16 octobre dernier, 32 volontaires venu·es d’Europe et des États-Unis afin de prêter main-forte aux paysan·nes palestinien·nes pour la récolte des olives ont été embarqué·es par la police israélienne à Burin, un petit village près de Naplouse, au nord du territoire palestinien de Cisjordanie. Parmi elles et eux, une moitié de Français·es, des Américain·es, des Anglais, deux Espagnols et un Irlandais. Elles et ils intervenaient auprès de l’Union des comités du travail agricole (UAWC), une organisation agricole palestinienne classée «terroriste» par Israël en 2021, mais pas par l’Union européenne.
Six agriculteur·ices du syndicat agricole français Confédération paysanne, âgé·es de 25 à 38 ans, participaient à cette opération de solidarité internationale qui existe depuis les années 2000. Notre journaliste Marius Jouanny couvrait cette action, dont le but était d’apporter de l’aide et «faire bouclier humain pour éviter que les colons et l’armée entravent la récolte des olives», décrit la porte-parole de la Confédération paysanne, Fanny Métrat. Alors que la colonisation progresse en Cisjordanie, il est devenu de plus en plus difficile pour les Palestinien·nes d’accéder à leurs champs et de collecter leurs olives, gage de la subsistance de familles entières. Plus encore depuis les attaques terroristes du Hamas, le 7 octobre 2023, et l’intense répression d’Israël qui a suivi.

Pendant dix jours, Marius Jouanny a pu suivre les volontaires, documenter l’entraide agricole et participer aux récoltes : «Quand ça chauffait avec les colons ou l’armée, je mettais mon brassard presse pour me distinguer et voir si je pouvais prendre des photos, raconte le journaliste. Parfois je photographiais, parfois j’interviewais les paysans. J’avais un autre statut dans le groupe, mais j’aidais aussi aux récoltes.»
32 volontaires arrêtés, cinq jours de détention
Après dix jours de travaux agricoles dans la région, au cours desquels «il y a eu des moments tendus, mais le sentiment joyeux a prédominé», arrive le 16 octobre. Chassé·es par l’armée du village de Huwara plus tôt dans la journée, les volontaires se replient à Burin, à quelques kilomètres de là. «On a commencé à récolter dans un champ, mais l’armée est revenue très vite», témoigne Marius Jouanny.
Quelques heures plus tard, les 32 volontaires sont arrêté·es, déplacé·es de postes de police en postes-frontière, et des douanes de l’aéroport de Tel-Aviv à la prison de Givon. «Une errance de 24 heures», raconte-t-il, avant quatre jours derrière les barreaux. Contrairement aux sordides conditions de détention des Palestinien·nes, celles des volontaires agricoles étaient «largement privilégiées», tient à souligner le journaliste.
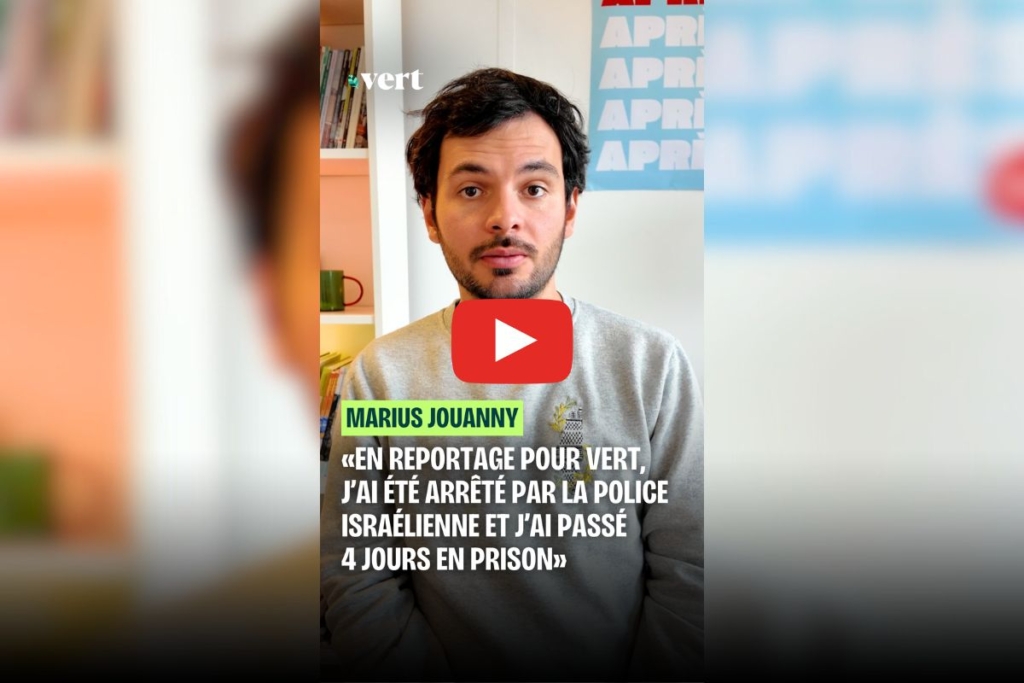
Le motif officiel de leur arrestation ? Pénétration dans une «zone militaire» (le champ du paysan en question, qui semble avoir été classé ainsi la veille), résistance à l’armée et appartenance à une organisation terroriste – l’UAWC, l’organisation palestinienne de développement agricole.
«L’action résolue visant à expulser les anarchistes envoie un message clair selon lequel il y aura une tolérance zéro envers toute violation de la souveraineté de l’État, l’incitation au terrorisme et son soutien», a déclaré le ministre de la justice Yariv Levin auprès de la chaîne israélienne d’information en continu I24 news.
Le pays le plus dangereux au monde pour les journalistes
«J’avais dit que j’étais journaliste, mais ça ne changeait rien, assure Marius Jouanny. Au moment de l’arrestation, j’avais mon brassard. À la police, j’ai fait scanner mon ordre de mission, ma carte de presse.» Pire : «Au poste frontière, j’ai senti que ça les faisait rire que je dise que j’étais journaliste.»
Contacté par Vert, le responsable Moyen-Orient de l’ONG de défense de la presse Reporters sans frontières, Jonathan Dagher, condamne vivement l’arrestation de notre journaliste. «Nous dénonçons l’arrestation et la détention de Marius Jouanny alors qu’il couvrait la récolte en Cisjordanie et qu’il s’était clairement identifié comme journaliste. C’est une entrave claire au droit à l’information.»
Une arrestation qui, pour autant, est loin de le surprendre. «La Palestine est aujourd’hui le pays le plus dangereux au monde pour les journalistes, avec des disparitions forcées et des assassinats ciblés», rappelle-t-il. Et d’ajouter que, depuis octobre 2023, près de 220 journalistes ont été tué·es à Gaza, «dont 62 pour lesquels nous avons des éléments prouvant un ciblage en raison de leur qualité de journaliste».
«Les journalistes environnementaux sont parmi les plus entravés»
«Le but principal, explique encore Jonathan Dagher, est d’isoler la Palestine en muselant les journalistes qui transmettent l’information, les photos et les images, pour imposer une autre narration – la version israélienne. Le fait que Marius Jouanny couvrait un sujet environnemental aggrave encore son expulsion, car ces questions sont rarement traitées et les journalistes environnementaux sont parmi les plus entravés.»
Le procès des 32 volontaires, dont Marius Jouanny, doit avoir lieu mi-novembre en Israël. Il devrait confirmer, pour chacun·e, l’interdiction de séjour de 99 ans dans le pays qu’ont rapportée les médias israéliens. «En tant que journaliste, ça veut dire que je ne pourrai plus couvrir ce territoire, confie encore Marius Jouanny. J’ai peu d’espoir d’une levée de l’interdiction.»
À lire aussi
-
À Gaza, l’écocide s’ajoute au génocide : «Cultiver, c’est aussi un symbole de notre résilience»
Ces dernières décennies, les Gazaoui·es ont développé un solide réseau pour assurer un semblant de souveraineté alimentaire et parvenir à se nourrir pendant le siège imposé par Israël. Mais à force d’attaques à répétition sur Gaza, l’armée israélienne provoque un écocide qui conduit à la famine de la population. -
Destruction de l’environnement et du patrimoine à Gaza : «un futuricide», selon la chercheuse Stéphanie Latte Abdallah
Historienne et anthropologue, directrice de recherche au CNRS, Stéphanie Latte Abdallah est spécialiste du Moyen-Orient. Elle explique à Vert pourquoi l’écologie palestienne, qu’elle qualifie d’«existentielle», est une forme de résistance à la destruction d’une terre et du peuple qui y vit.


