En quoi consiste cette journée ?
Cette année, la programmation est à la frontière de la science et de l’art, en lien avec l’université parisienne de la Sorbonne. La journée se déroule aussi en partenariat avec le Climat Libé Tour [série de conférences organisée par Libération, NDLR] à l’Académie du climat, à Paris. Il y aura une séance d’observation des nuages, une table ronde, un concours photo, une projection de films d’animation ou encore des concerts.
D’autres lieux comme la ville de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) et son Observatoire de physique du globe, la ville suisse de Meyrin, ou des institutions comme le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) à Marseille, participent aussi à cet évènement.

L’idée est de croiser les disciplines pour s’informer sur les droits des nuages. Notre premier rapport à ceux-ci est esthétique, c’est un rapport d’émerveillement. On n’a pas besoin d’avoir fait des études pour regarder les nuages, c’est un geste universel qui crée du lien.
Pourquoi avoir créé cette journée ? D’où vous est venue l’idée ?
En tant qu’écrivain, j’aime bien pousser tout le monde à se sentir légitime à écrire. J’ai lancé des dispositifs d’écriture collective du réel, avec des publics variés. Dans ce contexte-là, je me suis intéressé à la question des nuages et j’ai créé un évènement pour écrire dessus.
Lors des trois premières éditions, 4 000 personnes ont participé. Ce qui m’intéresse chaque année, c’est de voir en quoi ce geste universel et très simple de s’allonger dans l’herbe et de chercher des formes dans le ciel reste une action accessible à tout le monde. Les textes que nous écrivons sur ces formes dans le ciel constituent une pétition poétique pour demander une réflexion collective sur la création d’un droit des nuages.
Une cinquantaine de pays manipule ces derniers pour faire tomber artificiellement la pluie ou éviter la grêle. Pourtant, nous n’avons pas la preuve scientifique que cet ensemencement des nuages fonctionne.
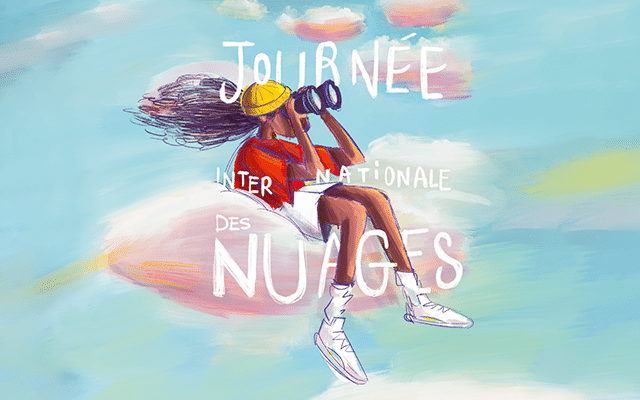
Cette utilisation pose des enjeux sanitaires en raison de recours à de l’iodure d’argent, potentiellement dangereux [un composé envoyé par des roquettes dans le ciel pour déclencher la pluie, NDLR], mais aussi des enjeux climatiques et géopolitiques. Certains pays accusent par exemple leurs voisins de leur voler les nuages, comme le Canada auprès des États-Unis dans les années 1940.
Il n’existe presque aucune loi pour réglementer cette utilisation des nuages. J’ai envisagé cette journée comme une action poético-politique pour créer une réflexion sur le droit des nuages. La seule législation à l’échelle mondiale est la convention de l’ONU de 1976 dénommée ENMOD [Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, signée par 76 pays, NDLR].
Elle provient de l’utilisation militaire des nuages par les États-Unis durant la guerre du Vietnam. Les humains ensemencent les nuages pour des raisons futiles, comme avoir un ciel bleu pour un défilé militaire en Russie, ou pour des raisons guerrières. Pendant la guerre du Vietnam, l’opération américaine Popeye a tenté d’intensifier la mousson en vue de ralentir les troupes ennemies. À la suite de cet épisode, la convention de l’ONU ENMOD a été signée. Elle dit que les nuages ne doivent pas être utilisés comme arme de guerre contre les pays signataires. La Russie l’a signée, par exemple, mais pas la France.
À quoi aboutirait cette réflexion collective à propos des droits des nuages ? Que permettraient ces droits ?
J’ai été avocat pendant plus de vingt ans et je voulais aussi avoir une approche très concrète pour faire avancer le droit des nuages. Je me suis fixé plusieurs objectifs : j’aimerais que la France signe la convention ENMOD, je souhaiterais faire rentrer les nuages dans le patrimoine mondial de l’Unesco et, dans un second temps, que les nuages aient une personnalité juridique, comme certains fleuves et certaines montagnes.
À lire aussi
Cette dernière proposition amène un deuxième niveau de réflexion. De mon côté, je m’intéresse avant tout à comment faire pour avoir des règles communes et considérer les nuages comme un bien commun. Ensuite, on pourra réfléchir à considérer les nuages comme des personnes avec des droits. Mais, pour l’instant, j’ai surtout travaillé sur la première approche. Il n’est pas normal, à mon sens, que l’on puisse ensemencer les nuages sans demander l’accord aux autres pays. Il faudrait que l’ONU fasse une convention aussi pour leur usage civil.
«Une proposition pour faire de la politique par la poésie.»
Si on devait se fixer un seul sujet en écologie, sur lequel travailler, ce ne serait peut-être pas les nuages. Je ne prétends pas que c’est le plus urgent, mais j’indique que c’est un sujet sérieux. D’ailleurs, rien qu’entre 2012 et 2017, la Chine a investi plus d’un milliard de dollars (924 millions d’euros) dans l’ensemencement des nuages.
Il y a assez peu d’études sur d’éventuels effets secondaires de cette pratique. L’un de mes buts est que l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques [un organisme qui réunit des député·es et des sénateur·ices, NDLR] s’empare du sujet pour qu’il y ait plus d’études d’impacts. J’avais discuté avec Agnès Pannier-Runacher l’année dernière sur le sujet, elle m’avait indiqué qu’elle était favorable à ce que des études soient faites pour faire évoluer la réglementation. J’ai aussi été entendu à l’Assemblée nationale et au Sénat, pour discuter avec les élus.
À lire aussi
-
Aux Émirats arabes unis, l’intelligence artificielle servira bientôt à faire tomber la pluie
IA de l’orage dans l’air. Lors du forum international sur l'amélioration des précipitations à Abou Dabi (Émirats arabes unis) en janvier, les expert·es ont mis l’intelligence artificielle à l’honneur. Grâce à cette technologie, elles et ils espèrent améliorer l’ensemencement des nuages pour faire tomber la pluie. Une pratique dont l’efficacité n’est pas prouvée. -
Rues fermées, forêts grillagées… «Le paysage est un miroir qui renvoie le reflet de notre inaction climatique, écologique et sociale»
Less béton ? Enseignant et chercheur en philosophie, Olivier Gaudin forme de futur·es paysagistes et s’interroge sur la relation que nous entretenons aux paysages. Peut-on avoir un droit de regard sur ce qui se construit en face de chez soi ? C’est l’une des questions auxquelles il répond, dans un rapport publié par la Fondation Jean-Jaurès lundi.


