Où se situe ton niveau d’écoanxiété après cet été ?
J’ai la chance de ressentir très peu d’écoanxiété !
C’est quoi ton secret ?
Le fait d’essayer de faire des choses, et d’avoir beaucoup relativisé le rôle qu’on peut avoir individuellement m’a aidé. D’être engagée dans le collectif Pour un réveil écologique et d’en avoir fait mon métier, je peux difficilement en faire plus, en tant qu’individu. De l’autre côté, on ne changera jamais le monde tout seul. Notre rôle en tant que militants écolos, c’est d’arriver à attirer le plus de monde à ces enjeux-là et construire quelque chose qui dépasse notre simple individualité.

Qu’est-ce que tu fais dans la vie ?
Je fais de la formation auprès des agents publics, des fonctionnaires, sur les enjeux climatiques et environnementaux à l’École des Ponts. L’idée, ce n’est pas seulement de faire de la sensibilisation, ou d’expliquer comment fonctionne le système physico-chimique de la Terre, mais de trouver comment chacun, en tant qu’agent public, peut faire évoluer son boulot pour tendre vers la neutralité carbone.
Dans ton livre, dont c’est le titre, tu proposes de «faire écologie ensemble», en promettant que la guerre des générations n’aurait pas lieu…
Je ne promets rien ! [rires]
… faire écologie ensemble, ça veut dire même avec les boomers en SUV ?
Cette opposition avec les boomers, il y a un stade où elle ne tient pas complètement. Déjà parce que nous, en tant que jeunes, on ne pourra pas réussir la transformation écologique tous seuls. On a une fenêtre d’opportunité trop faible pour atteindre ne seraient-ce que des postes à responsabilité.
Nos parents et nos grand-parents ont des enfants, ou des petits enfants, qui vont vivre dans ce monde-là. Donc ils n’ont pas d’intérêt à le saloper, à part pour des raisons identitaires de réactance, qui existent. Le but n’est pas de dire qu’on va convaincre tout le monde parce que tout le monde est beau et gentil. Mais de dire qu’il y a des co-bénéfices à la transformation écologique qui, pour beaucoup de gens, sont beaucoup plus importants que de réussir la transformation écologique.
«Faire écologie ensemble», ça veut dire dépasser le clivage générationnel et le clivage sociologique… Dépasser le plafond de verre qu’on a du mal à briser aujourd’hui.
Si je t’écoute bien, ça veut dire qu’il faut accepter qu’il y en a qui soient perdus pour la cause, qu’on n’arrivera pas à embarquer…
Bien sûr. Et tous nos multimillionnaires ou milliardaires qui, pour le coup, n’ont aucun intérêt à changer. Il y a des gens que tu ne pourras pas convaincre et qui seront des opposants féroces et réfractaires.
Tu veux dire qu’on ne peut pas faire écologie ensemble avec Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies, par exemple ?
Ce qui est un peu difficile, c’est que quand Patrick Pouyanné dit : «On est les plus vertueux des pétroliers», c’est dramatique, mais c’est vrai, parce que les autres sont mille fois pires. Il va falloir fortement réguler les multinationales, et ce n’est pour l’instant pas vraiment dans les plans des pays de l’Union européenne, ni ailleurs dans le monde.
«Ce qu’il faut, c’est de la régulation, qui permette à des entreprises d’émerger – celles qui font réellement des efforts, des transformations structurelles»
Comment fait-on pour que les entreprises soient capables de penser contre leurs profits immédiats, contre le système concurrentiel dans lequel elles sont ?
Je pense qu’elles ne seront jamais capables de le faire, il faut acter ça. L’autorégulation parfaite qu’elles disent toutes être en train de réaliser, ça n’existera pas. Pas pour des raisons morales : même si elles le voulaient, elles ne le feraient pas, parce qu’elles perdraient du terrain face à la concurrence.
Ce qu’il faut, c’est de la régulation, qui permette à des entreprises d’émerger – celles qui font réellement des efforts, des transformations structurelles. Et qu’une partie des autres, coule.
«Aujourd’hui, il faut vraiment le vouloir pour être écolo. C’est pas facile, c’est cher, c’est souvent plus long, pas toujours socialement valorisé»
Dans ton livre, tu expliques que les individus ont une marge de manœuvre relativement contrainte, que faire de l’écologie à l’échelle individuelle, ce n’est pas facile. C’est pour ça que tu appelles à construire «l’écologie par défaut». De quoi s’agit-il ?
Aujourd’hui, il faut vraiment le vouloir pour être écolo. C’est pas facile, c’est cher, c’est souvent plus long, pas toujours socialement valorisé… Dès que tu fais un pas de travers, on te dit : «Tu fais ça alors que tu dis toute la journée que tu es écolo».
L’idée de l’écologie par défaut, c’est d’inverser ce prisme-là, de changer les cadres légaux, institutionnels, économiques, sociaux aussi, pour que l’option par défaut soit celle qui soit la moins chère, la plus rapide, la plus socialement valorisée.
Aujourd’hui, si j’ai envie de manger végétarien à Paris, j’arrive dans un restaurant, et j’aurais peut-être un ou deux plats végétariens. Et ça, c’est parce qu’on est à Paris. Il y a plein de restaurants partout ailleurs où on n’aura aucun plat végétarien.
À lire aussi
Il y aura bien une salade verte et des frites…
Voilà, ou la fameuse omelette au sel. C’est sympa, mais bon, on aimerait bien manger autre chose.
Peut-être qu’il faut que la grande majorité des plats soient végétariens dans les restaurants, et qu’en plus, on apprenne à cuisiner végétarien dans notre vie, peut-être à l’école, qu’on s’acculture à ça et que ça devienne un automatisme.
Sur le transport, nous, on est venus en métro ici, parce qu’il y a des métros à Paris. C’est notre mode de trajet par défaut, avec le vélo. Grâce à ça, je n’ai pas besoin de voiture, ni de moto ou d’autres moyens de transport carbonés. Et ce n’est pas évident ailleurs qu’à Paris.
«L’endroit d’où je vois la transformation écologique s’impulser, c’est les pouvoirs publics, à tous les niveaux»
Si je comprends bien, s’il y a un principal levier, il est au niveau politique, parce qu’il faut changer les règles du jeu ?
L’endroit d’où je vois la transformation écologique s’impulser, c’est les pouvoirs publics, à tous les niveaux. Le dernier chapitre du bouquin interroge le rôle qu’on peut avoir en tant qu’individus, alors qu’on nous vend l’idée que c’est dans notre vie personnelle qu’on a le plus d’impact – «Ne mange pas de viande, ne prend pas ta voiture, ferme la lumière quand tu sors d’une pièce».
Je pense qu’il y a un vrai intérêt à se détacher de ça et à regarder la personne sociale que l’on est, qui a un rôle dans la société, qui vote de temps en temps, qui passe du temps au travail – dans lequel on peut créer des interstices. Il y a aussi l’engagement syndical ou juridique.
Même si mon action individuelle n’est pas suffisante – et ne le sera jamais – je ne porte pas le poids du monde sur les épaules, parce que ce sont des combats partagés, par exemple si on monte un collectif dans sa boîte, ou si on rejoint un syndicat. En plus, c’est beaucoup plus politique que si je suis simplement un «consom’acteur» et que j’achète mes légumes bio. Je ne dis pas qu’il ne faut pas acheter ses légumes bio, évidemment !
Désolé, si je souris, c’est parce que le mot «consom’acteur» me fait rire à chaque fois !
Ça me fume, vraiment [rires] ! En plus, c’est vraiment très ancré dans l’esprit des gens : les manières dont on peut avancer ne sont pas du tout claires dans l’esprit de beaucoup d’entre eux.
Tu appelles à rendre l’écologie «désirable» dans ton livre. Qu’est-ce que c’est une écologie désirable et comment on fait ?
On s’en fiche, finalement, d’atteindre la neutralité carbone. Ce sont des objectifs qui ne sont pas des fins en soi. Les fins en soi, c’est ce que tout ça va nous offrir, c’est-à-dire des conditions de vie plus ou moins agréables. Il faut pouvoir proposer un projet politique qui explique que «parce qu’on va atteindre la neutralité carbone, et qu’on va vous accompagner là-dedans, vous pourrez avoir plus de temps pour vous, pour vos amis, pour les choses que vous aimez, vous serez en bonne santé, vous serez épanouis».
Et puis il faut rendre ça cool, qu’on ait des actions militantes un peu drôles, décalées… Que les militants écolos n’aient plus seulement l’image de râleurs qui refusent la viande dans les barbecues de famille, mais que ce soit un truc un peu marrant, convivial, un truc dans lequel on ait envie d’entrer.
«On est dans une période de contrecoup médiatique et politique en réaction à la présence accrue de l’écologie dans le débat public»
En 2018, 30 000 étudiants et jeunes diplômés signaient le manifeste «pour un réveil écologique», expliquant, en gros, que ça n’a pas de sens de faire du vélotaf si c’est pour aller travailler dans une entreprise qui aggrave la crise climatique, et appelant à un changement profond de notre société. C’est ainsi qu’est né le collectif du même nom, que tu représentes. Qu’est-ce qui a changé depuis ?
J’ai l’impression qu’on parle beaucoup plus des enjeux écologiques dans les médias, même si on n’en parle pas aussi bien qu’on le voudrait, nous. D’ailleurs, la Charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique [initiée par Vert en 2022], et d’autres choses, ont aidé à ce que ça bouge.
Il y a eu une entrée en politique de cette question-là, de l’écologie transformante et de l’avènement d’une société dans laquelle on serait dans la neutralité carbone. Rien que l’émergence du terme «planification écologique» dans le débat, le fait qu’on parle d’adaptation… Je trouve que c’est déjà une victoire des écolos.
Après, il y a de plus en plus de crispations autour de ces questions-là ; on est quand même vraiment dans une période de backlash – de contrecoup médiatique et politique en réaction à la présence accrue de l’écologie dans le débat public.
Au printemps 2022, on a vu dans les médias une vague de bifurqueurs – d’étudiants issus de grandes écoles qui disaient : «Je ne vais pas bosser pour Total, je vais faire complètement autre chose». Est-ce que c’était un vrai mouvement, ou un épiphénomène ?
À l’intérieur des promos, c’est quand même plutôt un épiphénomène. Dans la mienne, les gens qui avaient une sensibilité écologique n’étaient plus tout à fait marginaux, mais on était toujours très minoritaires. Mais dans notre microcosme, j’en vois qui ont des prises de conscience un peu plus tardives après la sortie de l’école.
À ton avis, est-ce qu’il vaut mieux rester travailler chez la BNP Paribas, qui subventionne massivement les énergies fossiles, pour essayer de la faire changer à l’intérieur, ou lancer une néobanque plus écolo ?
Je pense qu’à ce stade, il faut travailler ailleurs. Quand tu es dans des monstres comme ça, la force d’inertie est colossale. Imagine : tu es diplômé en 2023 et tu commences à travailler en septembre 2023 à la BNP. Avant d’arriver à un poste qui permette d’avoir un peu de poids sur les décisions, il faut peut-être 30 ans à la BNP.
Il y a des gens qui fabriquent des alternatives – pas tout à fait extérieures au système, parce qu’ils en sont forcément dépendants -, mais qui sortent un peu des limites de ce système-là – comme les néobanques ou la Nef.
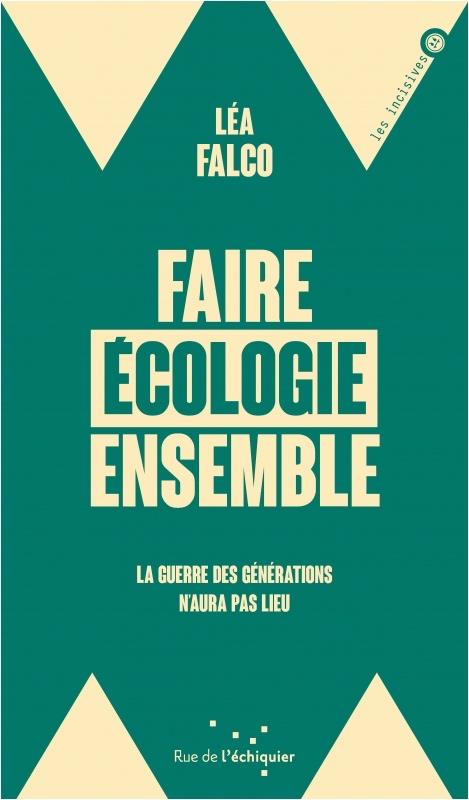
Que faites-vous maintenant à Pour un réveil écologique, cinq ans après le manifeste ?
On a deux pôles principaux. Le premier est consacré à l’enseignement supérieur. En février 2022, on a sorti un rapport avec Jean Jouzel [climatologue, NDLR], mandaté par la ministre de l’époque [Frédérique Vidal, NDLR] pour faire l’inventaire de ce qui serait une formation intéressante aux enjeux environnementaux pour les universités. A la suite de ce rapport, qui préconisait notamment qu’il y ait des formations obligatoires en deuxième année d’enseignement, la ministre a annoncé en octobre dernier que tous les étudiants de l’enseignement supérieur seraient formés aux enjeux environnementaux d’ici à 2027.
Les annonces, c’est toujours très bien, mais ensuite, il faut vérifier quels sont les moyens vraiment alloués. L’équipe enseignement du collectif travaille encore sur ces questions-là, et est en contact régulier avec tout un tas d’acteurs pour essayer de continuer à organiser ce nouveau segment de l’action publique.
Nous avons aussi une équipe «employeurs», qui a deux projets très cools. En 2018, on avait envoyé des questionnaires aux entreprises pour leur demander quelle était leur politique en matière de RSE [Responsabilité sociétale des entreprises]. Là, on essaie de faire une version actualisée, en leur demandant de nous fournir des indicateurs plus précis qui montreraient les signaux faibles en matière de changement dans leur business model.
Nous avons un autre projet qui s’appelle le Plan pour l’emploi de demain : une liste de chantiers dans lesquels on a besoin soit de compétences classiques, soit de compétences un peu différentes pour la transformation écologique, dans l’industrie, l’énergie, mais aussi des domaines auxquels on pense moins souvent, comme les secteurs du soin ou de la démocratie.
«On a un problème de diversité dans le mouvement climat»
À en croire les récits dans la plupart des médias, on dirait que la lutte contre le changement climatique, c’est l’apanage de jeunes urbains bourgeois ultra-diplômés. Qu’en est-il ?
C’est quand même plutôt assez vrai. Selon les études sur le sujet, le profil de base, c’est effectivement urbain, jeune, plutôt un peu plus féminin, plutôt de gauche, plutôt CSP+, donc ça veut dire qu’on a aussi dans le mouvement écologiste et pour le climat un problème de diversité.
Il y a des acteurs nouveaux qui émergent, comme Banlieue climat dont on parle beaucoup, ce que tout le monde trouve super bien, parce que ça montre qu’il y a des choses qui peuvent surgir hors des environnements dans lesquels on est plongé.
Mais il ne faut pas que ce soit une exception : il faut aller chercher des alliés à notre cause dans des cercles que l’on ne fréquente pas – des cercles syndicaux, des cercles de gens qui travaillent dans le secteur primaire ou tertiaire, des agriculteurs – et qu’on ait plein de nouvelles personnes qui rejoignent ce mouvement, avec qui ont co-construirait un projet.
Jusqu’à récemment, tu a été chroniqueuse chez les Grandes Gueules, sur RMC, un environnement qui a l’air relativement hostile pour des jeunes écolos urbains, CSP+.
C’était charmant ! [rires]
Pourquoi y être allée et pourquoi ça s’est terminé ?
J’étais là-bas parce que j’étais passée sur BFM un jour – c’est la même maison -, et j’avais râlé parce que la secrétaire d’État à l’époque de la jeunesse avait parlé du wokisme. Je pense qu’ils étaient intéressés parce qu’ils voyaient en moi une jeune de gauche. RMC m’a proposé de faire une émission pour les Grandes Gueules, qui en étaient à leur 18ème saison à l’époque. Un vrai vieux truc, que mon père écoutait dans la voiture quand j’étais petite.
C’est une émission qui est incroyablement écoutée. Malgré le risque d’être écrasé par la machine, contre laquelle tu ne peux pas gagner – j’y allais en sachant que de toute façon, j’allais perdre, à un contre quatre – je me suis dit que c’était intéressant de proposer aux gens qui écoutaient cette radio une vision de l’écologie différente que celle qui était dépeinte par ses opposants.
Est-ce qu’on peut faire écologie ensemble avec Pascal Praud ?
Non ! [rires]
À lire aussi
-
Camille Etienne : «Notre force est d’être cette eau qui s’infiltre par tous les recoins»
À l'occasion de son premier ouvrage, Pour un soulèvement écologique, l’activiste Camille Etienne raconte dans un entretien à Vert son travail d’activiste pour le climat, dénonce les injonctions à devoir rendre son action «désirable» et appelle au soulèvement écologique par de multiples étincelles. -
Lucie Lucas : «Je ne veux pas soigner mon éco-anxiété, car je la trouve saine»
Avec la campagne de sensibilisation «Tu flippes?», le mouvement On est prêt veut rendre visible l’éco-anxiété. Dans cet entretien à Vert, sa figure de proue et héroïne de la série Clem sur TF1, la comédienne Lucie Lucas, revient sur des peurs «saines» dans un monde malade et appelle le cinéma à prendre la mesure de l’urgence.


