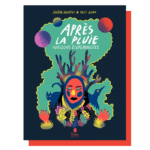Geneviève Pruvost est sociologue du travail et du genre au Centre d’étude des mouvements sociaux (EHESS). Elle a notamment publié Quotidien politique aux éditions La découverte en 2021, fruit d’une enquête de dix ans dans des lieux d’expérimentation de l’écologie pratique et de l’étude des théories du courant écoféministe allemand de la subsistance. Auprès de Vert, la chercheuse défend la prise en charge par chacun·e d’une partie des tâches du quotidien, aujourd’hui « déléguées aux machines et aux pauvres », pour faire advenir une société écologique, respectueuse du vivant.
Dans votre ouvrage Quotidien politique, vous soulignez l’étrangeté qu’il y a à ne pas savoir qui a confectionné le matelas auquel nous confions, chaque nuit, notre sommeil. Quelles sont les caractéristiques de notre rapport actuel à la matière ?
Nous sommes la civilisation qui possède le plus d’objets et nous nous interrogeons très peu sur ceux qui nous entourent : quelle est leur provenance, leur composition, leur avenir ? S’il y a toujours eu des circulations internationales dans l’Histoire, nous avons atteint un niveau d’anonymat inédit vis-à-vis des êtres humains qui produisent nos objets. Nous vivons dans un monde dépeuplé, abstrait. Nous pouvons avoir une conscience environnementale, mais si nous n’arrivons pas à suivre les matières et le cycle de vie des objets, nous manquons quelque chose. Nous n’avons aucune prise sur le processus de fabrication : c’est le contraire d’un rapport artisanal et paysan au monde.
« L’aspiration collective à s’extraire du travail de la matière est extrêmement mortifère. »
Bien sûr, tout n’est pas désirable dans le monde paysan d’autrefois. Le niveau d’interconnaissance des gens a pu être oppressant. Néanmoins, il est utile de s’interroger sur ce que l’on peut garder de ces façons de vivre. C’est ce rapport-là au monde que réactivent les néo-paysans qui s’attachent à respecter ceux qui ont fait les objets. Cela permet le « soin environnemental ». En effet, comment se soucier de la préservation de l’eau qui vient de notre robinet sans avoir jamais vu la source qui nous abreuve ?
Ce régime d’abstraction est devenu tellement répandu qu’il empêche d’avoir un regard complet sur la chaîne des problèmes. Le système capitaliste et industriel de délocalisation, de spécification et d’invisibilisation du travail de la matière donne un pouvoir gigantesque aux intermédiaires, car on ne peut pas remonter le fil du processus de fabrication. Par ailleurs, nous avons collectivement admis que les tâches du quotidien sont des « basses tâches ». Le système éducatif est projeté sur le travail intellectuel et les études longues. Or, l’aspiration collective à s’extraire du travail de la matière est extrêmement mortifère.
Pour valoriser le travail de la matière, les élèves devraient-ils apprendre les travaux manuels à l’école ?
Tout à fait ! Au collège, il existe une matière – la « techno » – qui pourrait jouer ce rôle. Mais on y apprend le fonctionnement d’un ordinateur et les élèves ne savent pas coudre un ourlet. Ce genre de travaux a été délégué à la gent féminine et ces métiers féminisés sont dévalorisés sur des critères virils. Ensuite, du côté de l’agriculture, on ne peut pas demander à 1,5% des agriculteurs de réaliser notre rêve de relocalisation de l’économie : il faut que nous assumions toutes et tous une partie de la tâche de subsistance. Les écoféministes le disent : le capitalisme veut qu’il n’y ait plus d’agriculteurs, mais des exploitants, plus d’artisans, mais des usines. Les femmes et les ouvriers à l’autre bout du monde qui assurent les tâches de subsistances sont invisibilisés et sous-payés.

Vous décrivez une société « hors-sol » qui veut échapper à la matière en sous-traitant toujours plus les tâches du quotidien. Néanmoins, vous dites aussi que nous gardons une sensibilité par l’art, les émotions. Nous ne sommes pas encore devenu·es des robots, si ?
En effet, la société moderne qui est très abstraite dans son rapport à la matière, demeure toutefois très affectueuse. Elle comprend aussi nombre d’avancées sociales. Par exemple, nous avons la possibilité de créer des familles choisies et de sortir de l’enfermement des relations de parentés, de traverser les mondes sociaux, de promouvoir le soin relationnel – le care – même s’il reste beaucoup de harcèlement et de violences malgré tout. Cependant, on peut s’interroger : est-il possible et tenable de séparer le care des humains du care des matières ? Aujourd’hui, c’est dissocié sauf dans les classes populaires qui ne peuvent pas se le permettre. Par ailleurs, nous observons de l’éco-anxiété [l’angoisse qui naît du changement climatique et de la perte de la biodiversité, NDLR] qui traduit une demande croissante de transformation des rapports de production et de consommation.
Il y a des leviers importants pour se réapproprier le travail de la matière et exercer une pression – notamment foncière – afin que les champs ne finissent plus en parkings et ne soient pas laissés au travail des machines. Il existe un décalage entre une demande sociale et des politiques publiques timides qui donnent les terres aux machines pour créer de l’emploi. Or, la matière a besoin d’un minimum de place pour se renouveler.
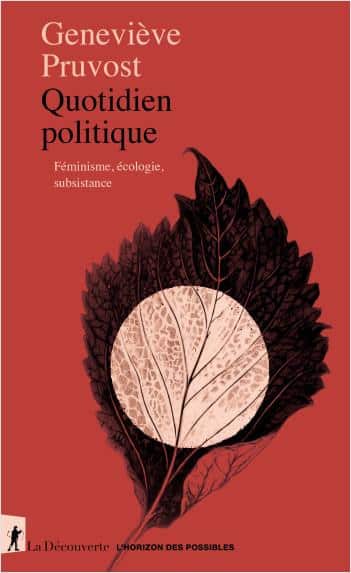
À l’opposé des publicités qui vantent les derniers services de livraison à domicile, pris en charge par des classes populaires sous-payées et ubérisées, comment réintégrer le travail de la matière à nos vies ? Cela passe-t-il par la polyactivité ?
La question de la polyvalence est essentielle. Nous devons intégrer un temps dédié à la transformation de la matière dans notre quotidien – ce que les femmes font déjà en majorité. Nous pourrions étendre à tout le monde le travail de subsistance, au lieu de chercher à étendre le travail salarié en travaillant plus. Il est primordial que chacun réintègre sa part du métier de vivre pour permettre une redistribution du travail et le respect de formes familiales très différentes. Il peut s’agir de tisser, jardiner… Sans qu’il y ait un champ d’activité déterminé, chacun pourrait accomplir des tâches communes. On ne peut pas avoir uniquement un jardin d’ornement et la monoculture pour les agriculteurs.
Penser que l’humain peut vivre dans une abondance qui coulerait de source sans travailler la matière est un leurre ; il faut se donner la peine et le labeur de ce travail. Soit nous décidons que ce sont des gens sous-payés qui font le sale boulot, soit nous nous le partageons.
En quoi réintégrer à nos vies ce travail de subsistance pourrait-il permettre de vivre dans une société plus écologique ?
Toute activité qui laisse une place au renouvellement du vivant commence à devenir une société écologique et le fait d’une façon adaptée aux groupes humains d’une part, et aux matières elles-mêmes de l’autre. L’idée n’est pas d’avoir des réserves naturelles sanctuarisées, ni de vivre dans les statistiques des bilans carbone, mais de s’adapter aux modes de vie vernaculaires [propres au pays, NDLR]. On ne fait pas d’écologie en ville comme à la campagne.
« Déléguer le travail du quotidien, c’est le déléguer aux machines et aux pauvres. »
Pour sortir de l’abstraction du monde, il faut faire les choses. La conscience prend le pas sur le travail concret et crée une dissociation profonde entre la tête et la main, entre une écologie théorique et une écologie pratique. Nous avons une approche trop segmentée du problème. Par exemple, nous allons dire : « je ne peux rien faire, partir en train plutôt qu’en avion est une goutte d’eau ». Or, déléguer le travail du quotidien, c’est le déléguer aux machines et aux pauvres.
Il existe déjà un grand nombre d’associations qui permettent de prendre en charge collectivement ces problèmes, car seul, on ne fait pas grand-chose. Il y a une grande variété de manières de s’associer qui sont présentes dans beaucoup de territoires. Il faut qu’il y en ait absolument partout pour que cela puisse toucher les gens dans leur quotidien. Je pense aux jardins partagés par exemple : ceux-ci doivent être en bas de leur immeuble.
À partir du moment où l’on met les mains dans la matière, on est happé. On y met les bras, tout le corps et toute son âme, puis on entraîne ses proches et c’est un pouvoir de conversion intime très puissant. C’est pour cela que la ZAD [la Zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes] a été massivement détruite deux fois : c’est un chantier maxi-ouvert au public et complètement déroutant qui a un pouvoir d’entraîner le reste du monde. Si l’on veut éviter d’être hors-sol, il faut s’empaysanner massivement et à toutes les échelles possibles. Je dis aux jeunes : allez en lycée agricole, car nous n’avons pas le temps. Il faut dix millions de paysans demain.
À lire aussi
-
Jeanne Burgart Goutal : « L’écoféminisme est une arme de déconstruction massive »
Jeanne Burgart Goutal est une philosophe spécialiste de l’écoféminisme. Elle enseigne la philosophie au lycée dans les quartiers nord de Marseille, et le yoga. Avec l’illustratrice Aurore Chapon, elle publie cet automne, aux éditions Tana, un roman philosophique intitulé ReSisters. Rencontre avec celle qui ne se qualifie pas d’écoféministe mais de « passeuse » d’idées. -
Après la pluie, le bon temps de l’écoféminisme
Ni les femmes, ni la Terre… Ouvrage-grotte dans lequel résonne l'écho de voix plurielles, Après la pluie se veut le manuel des écoféminismes d'aujourd'hui.