Chères toutes et chers tous,
📅 Rappel : rendez-vous CE SOIR à la Base (31 rue Bichat, Paris 10ème), pour débriefer tous·tes ensemble le dernier rapport du Giec. Parmi nos invité·es, nous aurons le plaisir de compter Christophe Cassou, climatologue et membre du groupe 1 du Giec, Elodie Nace, porte-parole d'Alternatiba et Thomas Baïetto, journaliste à France Info où fut publiée une tribune dans laquelle 1400 scientifiques demandent que le climat soit au cœur du débat présidentiel. Le détail de l'événement est à retrouver ici.
Les médias devraient être au chevet du climat, mais ils continuent de dormir et nous voilà dans de beaux draps.

Pour se défaire du gaz russe, l'Allemagne s'engage à marche forcée dans les énergies renouvelables
Énergie des espoirs. Le nouveau gouvernement allemand veut atteindre 100% d'électricité renouvelable d'ici 2035, soit avec dix ans d'avance sur son objectif initial.
Depuis l'invasion de l'Ukraine, le 24 février dernier, l'Union européenne a promis de tourner le dos à la Russie et notamment à son gaz, qui représente pourtant 40% de son approvisionnement (Vert). En Allemagne où la dépendance au gaz russe atteint plus de 50%, le nouveau gouvernement a annoncé, dimanche, des mesures spectaculaires pour se sevrer. Le pays pourrait ainsi passer de 50 à 100% d'électricité renouvelable d'ici 2035, a annoncé le ministre écologiste de l’Économie et du climat, Robert Habeck. À l'heure actuelle, le gaz représente encore 15% du mix électrique ; le charbon, presque 30%.

Cette transition permettrait à l'Allemagne de se mettre enfin en ligne avec l’objectif de l’Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, selon Robert Habeck. Les efforts pour y parvenir sont toutefois colossaux. Le gouvernement prévoit ainsi un doublement de la capacité éolienne terrestre pour atteindre 110 gigawatts installés, ainsi qu'un quadruplement des éoliennes en mer (pour atteindre 30 gigawatts) et du solaire photovoltaïque (à 200 gigawatts). Au total, cela représente la capacité théorique de 35 tranches nucléaires.
À très court terme, le gouvernement examine l'opportunité de prolonger la durée de vie des trois dernières centrales nucléaires du pays, dont la mise l'arrêt est prévue pour fin 2022. D'autre part, la construction en urgence de deux terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le nord du pays doit permettre de diversifier les pays fournisseurs. L’Allemagne continue d’être dépendante du gaz à hauteur de 50% pour son chauffage. En effet, la chaleur d'origine renouvelable - géothermie, biogaz ou solaire thermique, par exemple - est beaucoup moins mature que l'électricité renouvelable et ne représente que 11,5% de la chaleur totale consommée en Allemagne.

· Depuis lundi, les publicités pour automobiles doivent mentionner le score carbone des véhicules ainsi que des messages de prévention tels que « pensez à covoiturer » ou « pour vos trajets courts privilégiez la marche ou le vélo ». Cette nouvelle mesure est issue de la loi Climat et résilience, qui était censée reprendre « sans filtre » les propositions de la Convention citoyenne pour le climat (Vert). Or, les 150 citoyen·nes avaient proposé l'interdiction pure et simple des publicités pour les produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre.


« Les médias traditionnels encadrent et transmettent les informations sur le changement climatique. Ils ont un rôle crucial dans la perception qu'en a le public, sa compréhension et sa volonté d'agir »
Sixième rapport du Giec, tome 2
A vous les studios. Lundi, la parution du deuxième volet du dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) n'a même pas eu l'effet d'un pétard mouillé. Sur les chaînes de télé françaises, les mentions de ce rapport ont varié « entre "rien" et "quasi rien " », selon l'association Plus de climat dans les médias, qui scrute le traitement médiatique des actualités environnementales. Pas un mot aux JT de TF1, M6 et Arte, une minute sur France 2 et quelques rapides mentions dans les éditions régionales de France 3, résume Véronique Etienne, attachée de presse au CNRS et membre de l'association.
Si les grandes chaînes ont boudé pour la plupart cet imposant rapport, celui-ci, au contraire, mentionne à de nombreuses reprises le rôle « crucial » des médias, qui « peuvent avoir un impact significatif pour faire progresser la conscience climatique et la légitimité des actions engagées ». Mais dans les faits, la couverture du changement climatique est largement insuffisante, car presque exclusivement cantonnée aux catastrophes naturelles et, le plus souvent, déformée (notre analyse). Qu'à cela ne tienne ! Vous lisez un média qui, lui, ne compte pas en rester là : Vert et la Base vous invitent à discuter des conclusions de ce rapport dès ce soir avec Christophe Cassou, climatologue et auteur du Giec.

La Sécurité sociale alimentaire, une utopie bonne pour les gens et le vivant
Sécurité saucisse. Instaurer plus de justice alimentaire tout en changeant le modèle agricole pour faire face au changement climatique : c’est l’ambition des partisans d’une Sécurité sociale de l’alimentation.
Pour être en bonne santé, encore faut-il avoir accès à une alimentation digne de ce nom. Or, sur ce point, la France préfère se reposer sur l'aide alimentaire. « C'est tout l'inverse de la Sécurité sociale avec son accès universel, où le financement se fait selon ses moyens et où l'on touche une aide selon ses besoins », explique à Vert Emmanuel Marie, secrétaire général du syndicat Confédération paysanne.
Dans le même temps, des agriculteur·rices qui veulent s'extraire de l'agro-industrie et employer des pratiques plus respectueuses de l'environnement peinent à vivre de leur activité. Résultat : en 2016, 5,5 millions de personnes vivaient de l'aide alimentaire, quand 30 % des agriculteur·rices gagnaient moins de 350 euros par mois, avait révélé le réseau Civam.

En France, le collectif « Pour une Sécurité sociale de l'alimentation » porte l’idée d’inclure la sustentation dans le régime général de la « Sécu » depuis 2019. Celui-ci regroupe une dizaine d'organisations - paysannes, agronomiques ou alimentaires.
Le collectif propose de délivrer à chaque personne une carte vitale de l’alimentation, qui donnerait accès à des produits conventionnés pour un montant de 150 euros par mois et par personne. Le choix des produits concernés serait laissé « aux mangeurs et aux acteurs du système alimentaire », regroupés au sein de caisses primaires locales, pour sortir d’un « assistanat » stigmatisant et permettre à chacun·e de décider ce qu'il ou elle veut manger.
En France, plusieurs initiatives locales tendent vers ce modèle. C'est le cas du projet de la Cité vivante de l'alimentation à Lauris (Vaucluse) ou du « marché du lavoir » à Dieulefit (Drôme), où plusieurs prix sont pratiqués : un premier, qui permet juste au producteur de couvrir ses coûts, un « prix solidaire » un peu plus élevé et un « prix accessible » qui représente 65 % du premier (Reporterre).
Que proposent les candidat·es à la présidentielle sur ce sujet ? Pour le savoir, lisez la suite de cet article sur le site de Vert.

Surconsommation : sortez les mouchoirs (en papier)
Il y a le gros mot « consumérisme » et les petits objets du quotidien : gobelets, mouchoirs en papier, déodorants ou bien smartphones. Et entre les deux, des consommateurs qui ont oublié comment faire sans, comment on faisait avant, comment on fera après. L'émission Hors-Série tente de retisser ce lien avec l’aide de Jeanne Guien, autrice d'un livre sur « le consumérisme à travers ses objets ». A travers ces petites choses, leurs histoires, les croyances qui les entourent et les stratégies industrielles qui les sous-tendent, elle retrace la véritable histoire de la surconsommation.
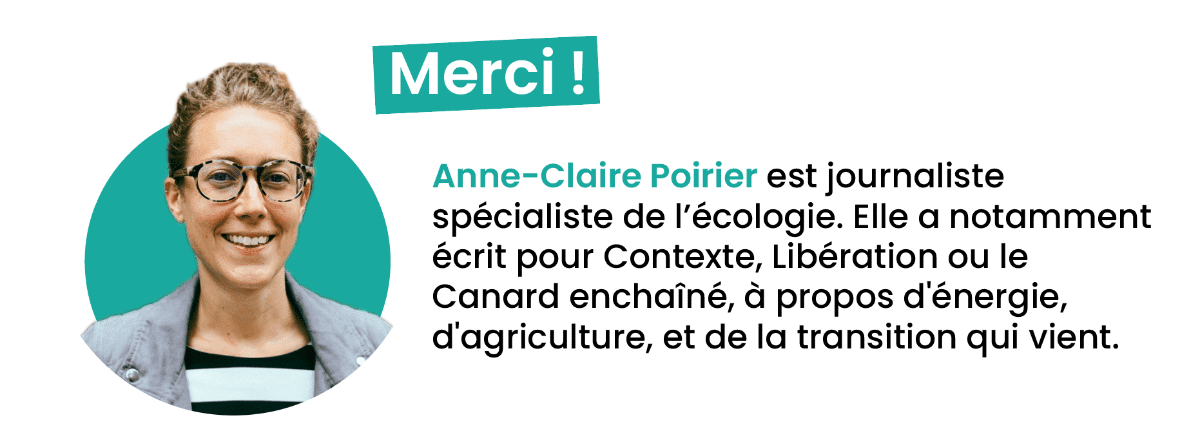
+ Mathilde Doiezie, Loup Espargilière, Mathilde Picard et Juliette Quef ont contribué à ce numéro

