Bonnes feuilles. Animateur des podcasts «Baleine sous gravillon» ou «Mécaniques du vivant», Marc Mortelmans publie le 19 avril 2024 aux éditions de l’Atelier un ouvrage pour en finir avec les idées reçues sur le vivant. Vert publie en exclusivité plusieurs extraits. Aujourd’hui, l’idée reçue 22 : «Le grand moteur de la vie, c’est la compétition».
Le vivant n’est que liens (ou interactions). Aucune espèce ne vit dans sa bulle, chacune interagit avec d’autres en permanence. L’une de ces interactions, surmédiatisée, dans les documentaires animaliers, c’est la prédation : «Je te mange ou tu me manges». Mais il y en a beaucoup d’autres ! Et pour les comprendre – et les distinguer – il faut se demander pour chaque espèce : qui lui apporte un bénéfice ? qui la prive de quelque chose ? qui existe autour d’elle de manière neutre, sans rien lui apporter ou lui prendre ? En gros : qui gagne, qui perd, et qui regarde passer les trains ?
De l’inégalité parmi les sociétés du vivant : des gagnants et des perdants
Les interactions qui suivent impliquent toutes qu’une espèce l’emporte sur l’autre.
• L’amensalisme
Une espèce fait du mal à une autre, sans en tirer de bénéfice. Exemple : j’écrase une fourmi sans le savoir. Bilan : 1 perdant (la fourmi), 0 gagnant.
• Le parasitisme
Une espèce vit aux dépens des ressources d’une autre. Exemple : les vers solitaires. Bilan : 1 perdant (l’hôte), 1 gagnant (le parasite).
• La prédation
À la différence du parasitisme, l’espèce «prédatrice» ne se contente pas de s’approprier une partie des ressources, elle prend tout, la bourse ET la vie. Exemple : les lions tuent et mangent les zèbres. Bilan : 1 gagnant (les lions), 1 perdant (les zèbres). Toute sortie est définitive. Encore que ! Trop souvent, on se concentre uniquement sur les interactions entre animaux, et on ne retient qu’un seul côté de la prédation, celui où l’une des deux parties est entièrement mangée. Mais, une fois de plus, ce serait oublier les plantes ! Les herbivores «mangent» certes l’herbe, mais ils ne la tuent pas toujours pour autant.
• La compétition
Deux espèces consomment les mêmes ressources sur le même territoire. Exemple : les loups et nos ancêtres ou bien des lions et des hyènes qui n’arrêtent pas de se bagarrer et de se piquer leurs proies. Notez qu’à l’intérieur même de l’espèce Homo sapiens la compétition est la norme, à l’école, au travail, dans le sport… Bilan : l’une ou l’autre espèce l’emporte, alternativement.
Commensalisme, mutualisme, symbiose : des gagnants, mais rarement à 50-50 !
Les relations qui suivent reposent, quant à elles, sur la coopération et l’entraide.

• Le commensalisme
C’est quand il n’y en a que pour une des deux espèces, sans que l’autre en souffre. L’étymologie de commensalisme signifie «qui partage la même table», en référence au gîte et au couvert dont bénéficient nos commensaux, nos squatteurs, le plus souvent détestés. Parmi les espèces commensales, on peut citer : les souris et les rats chez les mammifères ; les moineaux domestiques, les pigeons bisets, les goélands et les étourneaux sansonnet chez les oiseaux ; les mouches, les blattes chez les insectes. Bilan : 1 gagnant, 0 perdant, juste des pique-assiettes et des pigeons, le plus souvent inconscients de l’être et qui n’en souffrent pas.
• Le mutualisme
On l’appelle aussi «entraide». Les soins que procurent les labres nettoyeurs aux autres poissons dans les océans («Je te nettoie, tu me nourris») en sont un bel exemple. Les poissons viennent de loin et font la queue pour être nettoyés de leurs parasites et autres peaux mortes. Bilan : gagnant-gagnant ! Le monde vivant est riche d’exemples de mutualismes. Comme le titrait le numéro des 40 ans de la revue Salamandre : «L’union fait la vie 11». L’entraide est LA grande force du vivant, bien loin de la compétition, qui existe certes, mais qui n’a pas l’importance qu’on veut bien lui donner souvent. Avec le mutualisme, nous sommes bien loin de l’image de la loi de jungle, de la loi du plus fort, pourtant tellement battue et rebattue. Pablo Servigne et Gauthier Chapelle ont consacré un livre à cette question en 2017, L’Entraide, l’autre loi de la jungle.
• La symbiose
C’est le plus fort degré de mutualisme. Son nom vient du grec symbiôsis, (sýn, «avec, ensemble» et bíos, «vie»). C’est quand une espèce ne peut pas vivre sans l’autre. Voici quelques exemples : les polypes de corail et leur algue (les premiers offrent le gîte, la seconde participe au couvert en échange), les lichens formés par un champignon qui héberge une algue verte et même parfois un troisième larron, en l’occurrence une cyanobactérie, ou la mycorhize, cette alliance entre les champignons du sol et les racines des arbres, qui donne notamment les truffes. Là encore le marché est : «Passe-moi le sel, je te donne le sucre». Autrement dit : les champignons transmettent les sels minéraux du sol à l’arbre, qui en retour offre aux champignons une partie des sucres qu’il fabrique, et que le champignon est incapable de synthétiser par lui-même.
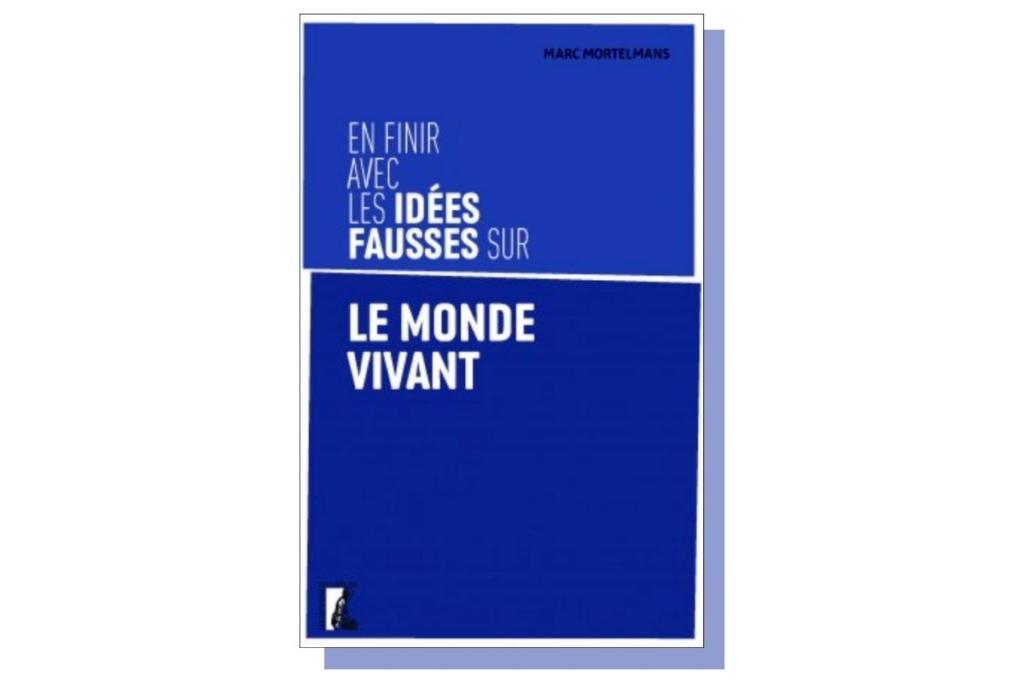
Attention, même dans ces relations mutualistes, la relation peut, à tout moment, évoluer dans un sens différent : l’un des deux partenaires peut se mettre à exploiter la situation davantage en sa faveur. Un exemple typique est celui des bourdons pollinisateurs qui percent les fleurs à leur base pour accéder au nectar (on les qualifie de «tricheurs») sans participer à la récolte du pollen puisqu’ils évitent les étamines. De même, on connaît des cas chez des lichens où le champignon prend le dessus et «dévore» l’algue ! Le mutualisme n’est donc pas forcément durable : il évolue selon les pressions de sélection.
Le botaniste et naturaliste Jean-Marie Pelt, un grand vulgarisateur autrefois vénéré du grand public et aujourd’hui critiqué par certains scientifiques, avait ainsi résumé cet équilibre entre la coopération et la compétition : «La coopération crée, la compétition trie».
Le neutralisme, un cas à part ?
Le neutralisme, c’est-à-dire quand deux espèces coexistent pacifiquement, sans interagir, a une place un peu à part. Mais ce neutralisme est très théorique puisqu’il y a toujours, a minima, une faible interaction. Le battement des ailes du papillon, ça vous dit forcément quelque chose !
«En finir avec les idées reçues sur le monde vivant», Marc Mortelmans, éditions de l’Atelier, 19 avril 2024, 344 pages, 13,50 €. Plus d’infos ici.

