Gaspard Koenig est philosophe et écrivain. Son dernier livre, Agrophilosophie (L’Observatoire), est paru en 2024. Gabriel Malek réalise une thèse en histoire contemporaine sous la direction de l’historien Jean-Baptiste Fressoz. Il vient de publier Pour une décroissance prospère (novembre 2025, Payot).

Dans cet entretien mené par la présidente de Vert Juliette Quef, qui s’est déroulé le 22 novembre à l’Agora de la décroissance prospère, à l’Académie du climat (Paris), les deux penseurs explorent les tensions entre capitalisme, décroissance et liberté individuelle.
Juliette Quef : Pourquoi le capitalisme est-il incompatible avec le respect des limites planétaires ?
Gabriel Malek. Le capitalisme repose sur trois piliers : la propriété privée des moyens de production, la concurrence et l’accumulation. C’est un système qui, par nature, nécessite la croissance pour investir et fonctionner. Sans croissance, il s’étiole.
Le capitalisme véhicule aussi des valeurs que la décroissance remet radicalement en question : l’individualisme, l’idée que chacun doit se battre contre les autres pour exister économiquement et, surtout, la marchandisation des relations humaines. Comme l’a montré Karl Polanyi [un économiste autrichien du 20ème siècle, NDLR], le capitalisme a besoin d’étendre en permanence la sphère marchande, de transformer toujours plus d’activités en marchandises, ce qui finit par dissoudre le lien social.
«La décroissance propose aussi un nouveau contrat social qui remet en cause plusieurs systèmes de domination : le patriarcat et le colonialisme.»
Au fond, c’est un mode de production dans lequel l’économie devient une fin en soi. Et dans cette logique, il est très difficile de faire primer la sobriété, les biens communs ou la protection des écosystèmes.
La décroissance, c’est exactement l’inverse : démarchandiser, réduire notre dépendance au marché, passer de la concurrence à la coopération, et aller vers une désaccumulation matérielle. C’est la base, mais cela va bien au-delà d’une simple réduction de la production.
La décroissance propose aussi un nouveau contrat social qui remet en cause plusieurs systèmes de domination : le patriarcat et le colonialisme. Or le capitalisme s’est appuyé sur ces structures et continue d’y prospérer.

On peut imaginer, en théorie, un «capitalisme durable», très régulé, qui réussirait à réduire la pression matérielle de la production. Mais après 50 ans d’efforts, force est de constater que nous n’y parvenons pas vraiment. Et même si cela fonctionnait, ce ne serait pas le changement de paradigme que la décroissance exige.
Vous partagez l’idée qu’une croissance infinie dans un monde fini est impossible. Mais vous rejetez l’idée d’une décroissance «anticapitaliste». Pourquoi ?
Gaspard Koenig. Une posture anticapitaliste très militante fait, à mon sens, du tort à la cause écologique. Elle marginalise l’écologie dans le débat public, en la rattachant systématiquement à un combat idéologique plutôt qu’à des constats matériels.
Vous l’avez rappelé : nous vivons dans un monde de matières finies. Lorsqu’on extrait de la matière première, on fabrique des objets, et on crée ce que l’on appelle de la croissance : c’est ainsi qu’on mesure la valeur ajoutée. Mais, en termes physiques, nous produisons surtout du désordre.
Prenons un exemple : le pétrole, formé sur des centaines de millions d’années par des processus géologiques. Si j’en fais un t-shirt à bas coût, je transforme un matériau hautement concentré en un produit qui deviendra rapidement un déchet, peut-être abandonné sur les rives d’un fleuve au Niger.
«Une posture anticapitaliste très militante fait, à mon sens, du tort à la cause écologique.»
Je pense en effet que l’on peut, et que l’on devra, évoluer vers des systèmes non croissants, si l’on adopte collectivement des règles limitant, voire interdisant, l’extraction de nouvelles ressources. Cela nous conduirait vers une économie plus circulaire, plus régénérative.
Ce débat n’est pas nouveau. En 1848, le philosophe britannique John Stuart Mill défendait déjà l’idée d’un état stationnaire – une économie où l’on vise d’abord la stabilité matérielle. Cette intuition a été prolongée par des économistes américains, notamment Herman Daly, qui s’est inspiré des travaux de Nicholas Georgescu-Roegen sur l’entropie [le principe de la dégradation de l’énergie, NDLR].
L’idée est simple, poser des règles qui permettent d’atteindre une économie stationnaire. Prenons le textile : si l’on savait recycler les fibres correctement, nous pourrions faire vivre plusieurs générations avec les stocks de vêtements existants, sans extraire une seule ressource supplémentaire.
À partir du moment où l’on fixe une règle claire, par exemple interdire certains intrants chimiques, on peut laisser se déployer une multiplicité d’expériences, comme le permet le marché. Chacun tente, innove, observe, ajuste et les pratiques les plus efficaces finissent par s’imposer. C’est un fonctionnement très proche des écosystèmes naturels, qui ne sont pas sobres au sens strict du terme : ils sont pleins de profusion et d’expérimentations permanentes.
Il ne s’agit donc pas de se «ratatiner» pour respecter les limites planétaires. Il s’agit de fixer un cadre strict, des limites, puis de laisser la créativité et la diversité des solutions s’exprimer.
Enfin, je pense que cette approche est aujourd’hui politiquement plus efficace. On ne peut pas attendre d’avoir «renversé le capitalisme» pour engager la transition écologique. Il faut commencer maintenant, avec les outils dont nous disposons.
Au-delà des questions de ressources et de circularité de l’économie, vous vous interrogez aussi sur le droit de propriété. Dans votre dernier ouvrage, «Agrophilosophie», vous remettez en question son caractère «inviolable et sacré». Comment en êtes-vous arrivé là ?
Gaspard Koenig. Oui, je ne suis pas parvenu à cette conclusion de gaieté de cœur. Le droit de propriété est une conquête immense. Il a été arraché par les Lumières, notamment par John Locke, qui voyait dans la propriété la condition de l’individu souverain. C’est aussi pour cela que Karl Marx critiquait d’abord la propriété privée : elle était au fondement de l’émancipation politique moderne. Et puis je parle aussi en tant qu’auteur : je vis de mes droits d’auteur. Je suis donc l’héritier de siècles de combats pour la propriété intellectuelle.
«La propriété privée est une institution précieuse mais, pour la sauver d’elle-même, il faut désormais l’encadrer.»
Mais, à l’aune des limites planétaires, un problème apparaît : le droit de propriété, tel qu’il est conçu depuis Locke, inclut le droit de détruire. C’est l’usus et l’abusus [le droit de disposer de son bien, NDLR]. Comment peut-on prétendre penser sérieusement les écosystèmes et, dans le même temps, considérer qu’un propriétaire peut faire ce qu’il veut de son hectare de terre, y compris le dégrader ? Certes, ce droit n’est plus absolu aujourd’hui, mais il reste largement intact.
Je pense que la propriété privée est une institution précieuse mais que, pour la sauver d’elle-même, il faut désormais l’encadrer. Une piste souvent évoquée consiste à reconnaître des droits à la nature, aux forêts, aux animaux. C’est intellectuellement stimulant mais j’y vois un risque bureaucratique énorme.
Une autre option, que je défends, consiste à attacher au droit de propriété des obligations écologiques. Cela existe déjà en Allemagne : être propriétaire signifie aussi ne pas amoindrir la biodiversité du lieu, voire l’améliorer. Autrement dit, s’inscrire dans le milieu naturel que l’on possède ou dont on a la responsabilité.
Comment appréhendez-vous la question de la propriété privée ?
Gabriel Malek. Pour moi, une véritable écologie ne peut pas exister sans remettre en cause la propriété privée des moyens de production. Cela implique des formes collectives, comme les coopératives, qui permettent de concilier production, innovation et respect des ressources.
C’est là que le municipalisme libertaire de Murray Bookchin est intéressant : il propose une gouvernance locale et participative, où les communautés reprennent en main la gestion des ressources et des institutions. On peut imaginer de petites innovations libérales, mais elles doivent s’inscrire dans ce cadre coopératif et démocratique, pour garantir l’accès équitable aux ressources et la durabilité des systèmes.
«Le capitalisme propose une vision de la liberté qui est en grande partie fictive.»
L’écologie ne peut se limiter à la technicité ou à l’innovation : elle doit aussi intégrer le social. Sans redistribution et sans règles, il est impossible d’avoir une écologie qui inclut les individus et leur rapport au travail.
Quelle place occupe la liberté individuelle dans la décroissance ? Où se situe la limite entre contrainte et choix démocratique ?
Gabriel Malek. La question de la liberté est essentielle. Le capitalisme propose une vision de la liberté qui est en grande partie fictive : il s’agit de pouvoir faire ses propres choix… mais toujours à l’intérieur des règles du marché. En réalité, dans ce système, on n’est pas vraiment libre : on dépend du marché pour vivre, on n’a pas de contrôle réel sur le processus de production et notre autonomie se limite à consommer. La publicité et les influences sociales orientent nos choix, ce qui réduit encore cette liberté supposée.
À l’inverse, la décroissance propose une autre conception de la liberté, que l’on peut appeler liberté d’autonomie, comme le décrit Ivan Illich [un philosophe autrichien, NDLR] : c’est la capacité pour chacun de travailler, en partie, à sa propre subsistance, et donc de réduire sa dépendance au marché. Cette liberté permet de renforcer les liens sociaux et le lien avec la nature. Elle rend l’individu réellement plus libre, moins dépendant de la consommation et de l’achat, et elle préserve l’espace matériel nécessaire pour que cette liberté puisse s’exprimer.
Il ne s’agit pas de planifier tout depuis un État central ou d’imposer des règles uniformes. La décroissance valorise la territorialisation de l’action politique : à un niveau local, les communautés peuvent discuter, décider et organiser la production et la vie collective. C’est une liberté concrète, qui se manifeste dans la coopération et la participation collective plutôt que dans une liberté abstraite, individualiste et soumise au marché.
Gaspard Koenig. Je suis particulièrement intéressé par la territorialisation. Cela rejoint l’idée des biorégions, où l’on change le paradigme habituel : au lieu de demander aux gens d’être écologiquement responsables, on leur donne d’abord un pouvoir politique local et, naturellement, ils prendront soin de leur territoire. Je trouve cela très puissant et réalisable assez rapidement.
Cependant, il faut rester conscient des enjeux de concurrence internationale et des régulations. Certains acteurs peuvent être en position de concurrence déloyale avec d’autres qui suivent des règles différentes, par exemple en matière de production ou de normes. Pour que cela fonctionne, il faut une harmonisation au niveau européen, voire international, ce qui n’existe pas encore aujourd’hui.
Si nous réussissons la transition écologique, comment vivrons-nous dans 30 ans ? Qu’est-ce qui aura changé autour de nous ?
Gaspard Koenig. J’ai récemment lu un livre qui illustre parfaitement mon idée de la transition : Ecotopia, d’Ernest Callenbach, publié dans les années 1970. Il imagine que la Californie fait sécession du reste des États-Unis et suit un journaliste venu du continent qui découvre la région 30 ou 40 ans plus tard.
Ce qui m’a frappé dans ce récit, c’est que Callenbach ne se contente pas de détailler la politique ou l’organisation sociale, mais construit tout un système de valeurs et de règles concrètes. Par exemple, les prisons sont ouvertes et il existe une règle d’or : on ne peut pas produire ce qu’on ne sait pas détruire. Chaque objet fabriqué sur le marché doit pouvoir être recyclé ou réutilisé, ce qui encourage à produire moins, mais de manière durable et réversible.
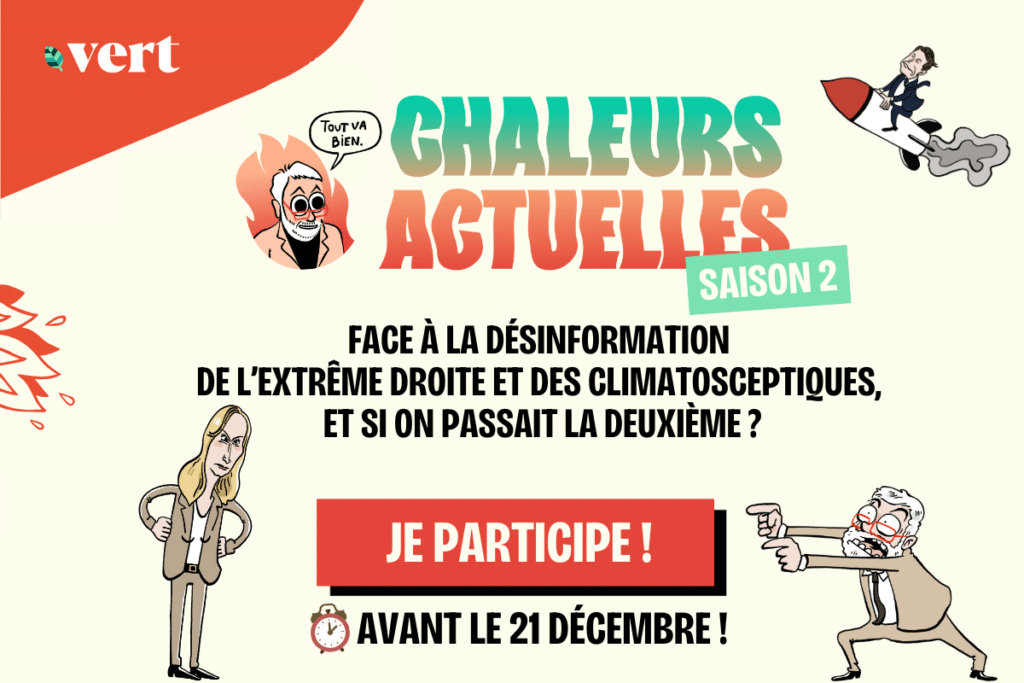
L’organisation politique est fédéraliste : les communautés locales sont autogérées et collectent elles-mêmes une partie des impôts, qu’elles transmettent ensuite à l’État pour financer des enjeux globaux comme l’énergie ou la lutte contre le carbone, qui nécessitent une coordination à grande échelle et sur le long terme. Cela fonctionne à l’inverse du modèle actuel, où tout l’impôt remonte d’abord à l’État central avant d’être redistribué aux collectivités locales.
Dans Ecotopia, la priorité est donnée à l’autonomie locale, tout en intégrant une structure globale nécessaire pour gérer certaines problématiques collectives. Le système est à la fois libre et structuré, ce qui le rend cohérent et inspirant.
Dans votre ouvrage «Pour une décroissance prospère», vous imaginez une utopie. Que raconte-t-elle ?
Gabriel Malek. Je suis parti du rapport Meadows de 1972 sur les limites de la croissance. À l’époque, Sicco Mansholt, un vice-président de la Commission européenne, avait proposé plusieurs mesures intéressantes : sortir de l’état de libre-échange, donner la priorité aux projets publics et réglementer certaines activités, tout en reconnaissant la finitude des ressources.
Dans mon livre, j’ai donc imaginé que l’Union européenne aurait bifurqué en 1972 et que l’on se retrouvait en 2025 dans une petite ville de 40 000 habitants en Gironde. Dans ce territoire, on permet une autonomie réelle aux collectivités locales, avec des budgets et des capacités de régulation qui ne dépendent pas entièrement de l’État. Les initiatives locales sont évaluées par les habitants eux-mêmes, en fonction de leur utilité sociale, dans ce que j’appelle une «bourse d’utilité sociale». Ainsi, les projets entrepreneuriaux ne sont pas soumis à une liberté illimitée de produire, mais à un contrôle social qui garantit qu’ils ne nuisent ni aux autres ni à l’environnement.
