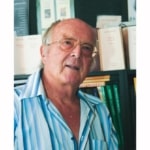Ça fait tiquer ! Prendre soin de son corps et de sa santé commence par respecter le vivant. Tel est le message de Marie-Monique Robin, la journaliste-réalisatrice spécialisée dans les questions environnementales et autrice des célèbres travaux Le monde selon Monsanto, Notre poison quotidien ou Sacrée croissance ! Dans sa nouvelle enquête, La fabrique des pandémies, elle explore l’écologie de la santé.
« Tout a commencé en janvier 2020, à la lecture d’un article de David Quammen dans le New York Times, intitulé « We made the coronavirus epidemic ». J’y découvre que la propagation de certains virus – tels Ebola, VIH, grippe aviaire, SARS, etc. est directement liée à notre manière de détruire les espaces de vie sauvage », raconte-t-elle à Vert. « J’ai profité du confinement pour interviewer 62 scientifiques (virologues, parasitologues, écologiques, vétérinaires, épidémiologistes, médecins, ethnobotanistes, etc.) qui travaillent sur les conditions d’apparition de « territoires d’émergences » des maladies infectieuses ».

Après le livre éponyme publié fin 2020 (La Découverte), le film de Marie-Monique Robin continue de mettre de la cohérence dans les désordres qui nous assaillent. La réalisatrice montre à quel point la nature n’est pas un simple décor, mais le support de ce qui nous permet de vivre. Un tour de force lié notamment à la présence, à l’écran, de l’actrice Juliette Binoche. Les deux femmes se sont rencontrées par hasard lors d’un dîner – de là est née l’idée d’embarquer la comédienne dans le chemin de connaissance proposé par la journaliste. « En prêtant sa notoriété, son talent et sa légèreté, Juliette Binoche donne à chacun•e la possibilité de s’identifier et de montrer que la protection de la biodiversité doit aujourd’hui être placée dans l’opinion au même niveau que la réduction des émissions de gaz à effet de serre », explique à Vert Marie-Monique Robin.
En leur compagnie, les spectateur•ices partent à la rencontre de 14 chercheur•ses dans huit pays différents. De la galerie de l’évolution du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) à l’Amazonie guyanaise, du Gabon à Atlanta, de la Thaïlande en passant par le Kenya ou Madagascar, on comprend que nos destins sont liés à ceux de multiples organismes vivants, à commencer par les bactéries, les virus et autres parasites – des agents pathogènes dont la prolifération est atténuée par la richesse de la biodiversité animale. « Beaucoup pensent que certaines espèces dites “nuisibles” ou que les agents pathogènes doivent être détruits en raison de leur potentiel néfaste sur l’humain, mais c’est tout le contraire qui est nécessaire », explique Marie-Monique Robin, « le risque infectieux augmente quand la biodiversité décline ».
Sa démonstration s’appuie notamment sur la notion d’« effet dilution », identifiée par Richard Ostfeld et Felicia Keesing, du « Tick project ». Depuis 30 ans, ce couple de scientifiques américains explore les liens entre la maladie de Lyme (transmise par les tiques) et les rongeurs : ils ont montré qu’aux États-Unis, la souris à pattes blanches est le réservoir de la bactérie qui infecte les tiques, puis les humain•es. Or, la fragmentation des habitats de la vie sauvage (par la déforestation, l’urbanisation croissante ou le développement du réseau routier) réduit l’espace vital des prédateurs du rongeur. Cela fait aussi disparaître d’autres familles de rongeurs, liés à des niches écologiques fragiles. La place se libère donc pour la souris à pattes blanches : elle prolifère à sa guise, ce qui augmente la probabilité qu’une tique soit infectée lors d’un repas sanguin. Conclusion : plus la biodiversité animale est riche, plus le risque qu’une tique soit infectée est dilué.
Ce phénomène, observé dans de nombreux autres écosystèmes, prouve que les activités qui bouleversent les équilibres naturels poussent les agents pathogènes, hébergés depuis la nuit des temps par des rongeurs, chauve-souris ou primates, à « sortir du bois » et infecter les populations humaines. Un effet boomerang dont les animaux ne sont pas responsables.
À lire aussi
-
« La forêt primaire, c’est le plus haut niveau de biodiversité possible »
Botaniste renommé, il a parcouru le monde depuis les canopées des plus belles forêts. Francis Hallé est à la tête d'une association qui œuvre à recréer une forêt primaire en Europe de l'Ouest. Dans un entretien accordé à Vert, il raconte les nombreux défis posés par ce réjouissant projet. -
A (re)voir : « Sacrée croissance ! » de Marie-Monique Robin
Alors que nos politiques mettent tout en œuvre pour regagner les points de PIB volés par la crise sanitaire, Arte rediffuse le documentaire de Marie-Monique Robin « Sacrée croissance ! » sorti en 2014.