Anne-Sophie Novel est journaliste (à Vert), réalisatrice et écrivaine. Fruit d’un an de recherches et d’expérimentations, son Enquête sauvage tout juste parue (La Salamandre, en partenariat avec les Colibris) explore les liens entre les humains et leur écosystème, à travers le témoignage riche et documenté de son autrice. De cette quête de perceptions et d’émotions en pleine nature, Vert dévoile les bonnes feuilles.
Chapitre 1 – Écouter
Tais-toi et marche
Il est 21 heures, la nuit vient de tomber. Il fait froid, l’air est encore très humide, et le bandeau que l’on vient de me poser sur les yeux me plonge définitivement dans le noir. La fumée du feu de bois tout proche me saute au nez. C’est le premier feu que j’ai allumé de ma vie, à partir de rien, ou plutôt d’un matériel que nous avons assemblé et fabriqué dans la journée, dans le respect des gestes ancestraux, à partir de ressources environnantes. Lui donner vie m’a procuré une émotion que je n’aurais jamais soupçonnée. Forcément, son odeur est plus symbolique que jamais.
Un frisson me parcourt. On vient me chercher, on me guide à petit pas et on me mène vers le reste du groupe : en file indienne, main dans la main, nous commençons à déambuler sur le chemin qui mène vers le col, puis dans la forêt, aidés par les « veilleurs » qui, délicatement, écartent les obstacles de nos pas. Avant de partir, nous n’avons pris qu’un bouillon, mon esprit doit « rester clair », m’a-t-on dit. Clair pour marcher les yeux bandés, c’est un concept ! Le ventre vide permet au moins de prendre cela avec légèreté. Au loin, je perçois le son d’un tambour, il se mêle au reste : la peur de glisser dans l’herbe mouillée, de trébucher dans un arbuste, de glisser sur une pierre et d’avoir les pieds définitivement trempés… Je me demande si je ne suis pas tombée sur un genre de secte New Age, mais je tiens bon et serre fort les mains des deux inconnus à mes côtés : je les connais aussi peu que la destination et l’expérience, mais je me laisse porter, je fais confiance. Je m’accroche comme jamais à la main qui m’ouvre le chemin, et je tiens tout aussi fort celle que je guide. Je n’ai pas envie d’être le maillon faible dans cette chaîne humaine qui m’évoque celle de notre interdépendance. Nous grimpons, passons non loin d’un ruisseau, sur une petite route, avant de reprendre en forêt, entre les ronces. Je me laisse porter par mes sensations, par le flot de mes questions, par le noir et l’inconnu, et je m’aperçois que cela ne m’empêche pas d’avancer. Si marcher ainsi main dans la main et à l’aveugle est une première, ce n’est pas la première marche en silence à laquelle je m’adonne depuis que j’ai commencé cette aventure. A croire que les chemins du vivant débutent avec cette façon de se mettre au diapason : il faut accepter de se taire, de ne plus rien dire, ne rien formuler ni attendre, se laisser porter et tout oublier pour tout revoir autrement. Là où avant j’entrais sans crier gare, sans cesser de bavarder, lors de balades ou de randonnées, maintenant je marque le pas, je ralentis, je baisse la voix, j’essaye d’avancer en chœur. Ce ne fut pas chose facile, je vous l’assure, et ils furent nombreux les « chut » et autres regards lancés par mes accompagnateurs pour gentiment me le faire comprendre.
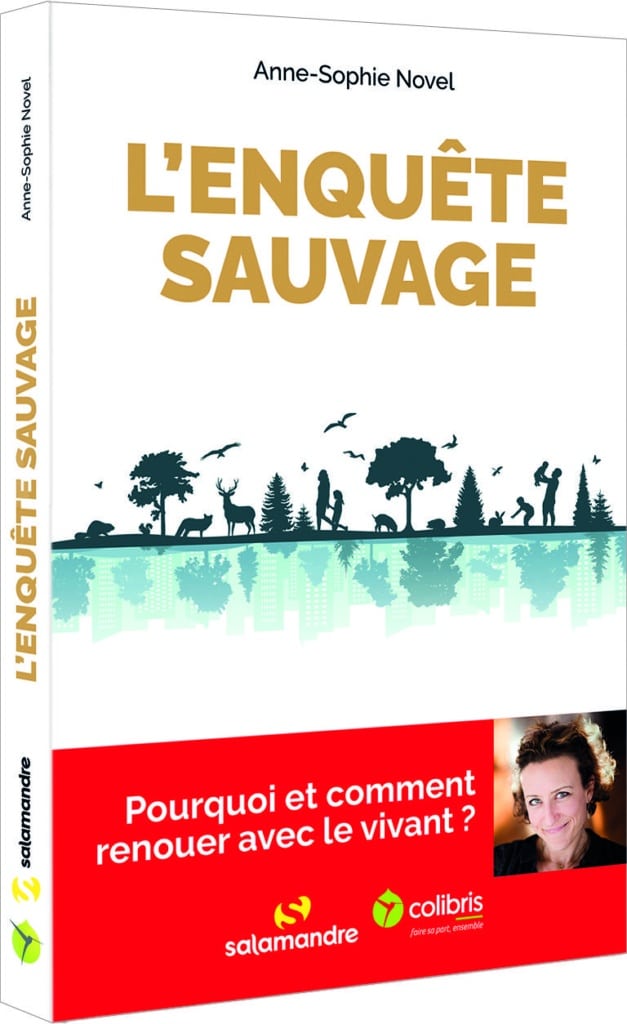
Chapitre 2 – Observer
L’affût
J’ai envie de tester cet « art fragile et raffiné consistant à se camoufler dans la nature pour attendre une bête dont rien ne garantit la venue », que décrit si bien Sylvain Tesson dans La Panthère des neiges. Dans cet ouvrage, le célèbre écrivain narre le voyage dans lequel le photographe animalier Vincent Munier l’a embarqué, au Tibet, à la rencontre des yacks, des loups, des ânes sauvages et de la rarissime panthère des neiges. Il y explique en quoi cette pratique est « anti-moderne », dans le sens où elle oblige à accepter la patience et l’incertitude : « Les bêtes surgissent sans prémisse puis s’évanouissent sans espoir qu’on les retrouve. Il faut bénir leur vision éphémère, la vénérer comme une offrande. » Nous nous y attelons donc, un soir d’automne, avec ma fille Adèle, désireuse de m’accompagner lors de ma première tentative, à 300 m de la maison, près de l’étang, en lisière de forêt. L’idée est d’assister au coucher des oiseaux et de voir d’éventuels autres animaux, sangliers ou chevreuils. Il est 17 h 30 lorsque nous nous posons près de la petite cabane en bois qui borde le plan d’eau. La nuit commence à tomber et nous arrivons à tenir, de notre point de vue tout du moins, un joli silence simplement entrecoupé par quelques chuchotements destinés à entretenir notre attention. La première observation que j’effectue alors me renvoie à des considérations purement matérielles : malgré les différentes couches de vêtements que nous portons et le plaid que nous avons emmené, le froid et l’humidité tombent vite et me glacent les pieds. La prochaine fois, j’anticiperai mieux : il n’y a pas de mauvais temps, il n’y a que de mauvais équipements. Seconde observation : il me faut surmonter la bande sonore générée par la circulation automobile. Se poser ainsi dans un tel environnement a un effet apaisant certain mais il faut s’accoutumer à cette pollution pour mieux en faire abstraction ; cela me demande un effort de perception. Nous ne sommes ni Tesson ni Munier et n’avons pas tous les moyens d’aller nous poster dans des espaces sauvages lointains. Je cherche à saisir le sauvage près de chez moi, et je crois bien qu’accepter cette bande-son est notre seule façon de passer outre. Toujours embrasser ce qu’on ne peut éviter.
Une fois l’obscurité installée, je constate que nous nous y sommes bien accoutumées : ce lieu que nous connaissons parfaitement prend une autre dimension. Un premier quartier de lune nous propose sa lumière blanche. Les arbres ressemblent à des estampes japonaises, ils peuvent aussi se faire menaçants selon les imaginaires, on les observe autrement. Où sont les revenants, les vampires, les assassins qui profitent de la nuit pour sortir du bois ? Je réalise alors que ma créativité marche à plein régime. Adèle ne dit rien, elle est comme dans son élément, et je décide de me taire pour ne pas lui partager les craintes de sa froussarde de mère. Heureusement, nous sommes deux, me dis-je… Qu’a-t-on observé ? Le héron, un habitué de l’étang, s’est envolé à notre arrivée, on l’a surpris, il est revenu une demi-heure plus tard. Nous avons entendu les oiseaux se coucher, chanter les uns après les autres, progressivement tout s’est apaisé. De loin, nous avons perçu trois vols de grues dans leur périple migratoire vers le sud. Un poisson, ou une grosse grenouille, m’a fait sursauter vers la fin de notre session. J’en ai conclu, comme Tesson, que l’affût est une « foi modeste » qui oblige à accueillir ce qui se présente. Il faut attendre, faire le guet et saisir l’inattendu sans autre exigence. Sur le court chemin du retour à la maison, mon Adèle me partage spontanément l’un de ses ressentis : « C’est comme si je ne savais plus marcher, j’ai l’impression de devoir retrouver mon équilibre. » C’est vrai que cette première séance d’affût a brouillé les pistes de notre perception. Cette perte d’équilibre de ma fille me fait penser que cette expérience nous a bizarrement fait entrer dans un espace flou et méconnu. Je réalise, plus que jamais, que nos yeux ne savent plus vraiment déceler ni discerner. Peut-être n’avons-nous pas vu certaines bêtes à nos côtés ? Peut-être étions-nous d’ailleurs perçues et mieux saisies par d’autres que nous ?
Une chose est sûre, en tout cas : notre manque habituel d’attention et de patience peut nous faire « explorer le monde et passer à côté du vivant », comme le remarque encore Tesson avant de conclure que « le jardin de l’homme est peuplé de présences [qui] ne nous veulent pas de mal [mais qui] nous tiennent à l’œil ». Aussi cette notion de « présence » me parle-t-elle profondément, tant elle traduit justement ce qui a poussé en moi après quelques affûts : la conscience de ne jamais être seule et de me sentir, chaque jour, plus riche de ces interactions avec ces altérités autour de nous. Il ne s’agit pas là d’un délire mystique, mais plutôt d’une forme d’assurance : à force de regarder, même si on ne voit pas, ou mal, on se dote d’une sensibilité nouvelle, d’une ouverture au monde. L’affût, c’est une invitation à aiguiser et affiner encore et encore son regard sur le monde. Et notre chance est que nous pouvons tous le pratiquer, partout où nous vivons – ou presque –, tant la vie abonde autour de nous.
Chapitre 3 – Ressentir
Tout larguer
Penser avec mon « corps terreux », voilà qui me parle. Mettre le mental sur pause, lâcher prise, le temps d’expérimenter et de ressentir pleinement, sans jugement. C’est avec cette posture que Geoffroy Delorme, alors âgé d’une vingtaine d’années, décide de partir vivre sans tente ni sac de couchage dans le massif forestier qui borde la maison parentale, à Bord-Louviers, dans l’Eure. Celui qui, depuis petit, se méfie du monde des humains commence par une expérience de deux semaines avant de prolonger ses séjours. Au total, il y passera sept ans. « Il y a au fond de moi un instinct de liberté qui me pousse à m’échapper dès que j’en ai l’occasion. Et la seule règle qui me semble digne d’être respectée est celle de la nature », confie-t-il dans L’Homme-chevreuil, un livre qui narre sa vie avec ceux qu’il considère désormais comme sa vraie famille : Daguet, Etoile, Sipointe, Chévi, Magalie, Prunelle, Espoir et tous les autres ongulés dont il copie les modes de vie au point de devenir l’un des leurs, selon lui. Pour vivre, et survivre, Geoffroy Delorme doit choisir avec soin ses vêtements et quelques indispensables ustensiles – un sac à dos pour conserver un peu de bois sec, des sacs hermétiques, une gamelle, des allumettes, un couteau, etc. S’il dispose de connaissances botaniques qui lui permettent de se nourrir de ce qu’il trouve en forêt (achillée millefeuille, plantain, oseille, sève de bouleau, glands, mais aussi fruits laissés par les chasseurs pour engraisser les sangliers), il apprend à filtrer l’eau de pluie à l’aide d’une chaussette, à dormir par cycles courts pour se prémunir de l’hypothermie, et à se laver les dents avec un mélange d’eau et de cendres. Son récit raconte non seulement son adaptation à une vie sauvage à l’état pur, ou presque, mais aussi la vie d’une forêt dans laquelle viennent régulièrement des chasseurs ou des abatteuses. On ressent pleinement, avec la force de son témoignage, les agressions et menaces que les humains font peser sur leur environnement.

Intriguée par son expérience parfois décriée, je décide d’aller à sa rencontre (…) Sur le chemin pour rejoindre son ancien « territoire », il commence par me montrer la distance séparant la maison de ses parents, à Léry, de la lisière de la forêt de Bord-Louviers. « Il n’y avait pas de route à l’époque », me précise-t-il, alors que la commune connaît un développement galopant de ses infrastructures depuis quelques années. « Je n’avais qu’à marcher à travers champs quand je venais chercher quelques affaires. A l’odeur, je savais que c’était différent : je sortais de la forêt protectrice et enveloppante, je quittais le cocon, la “maman”. Ici, l’odeur des hêtres est remplacée par celle de la terre retournée et des graminées. C’est perturbant de sortir de la forêt avec ces nouvelles sensations olfactives, on se sent vulnérable », me détaille-t-il. A l’écouter, je me dis qu’il y a vraiment du chevreuil en lui. Nous longeons le cimetière avant de nous engager sur le chemin menant au cœur de la forêt : Geoffroy m’explique qu’il venait y chercher de l’eau à l’époque et qu’il n’hésitait pas à y prélever des feuilles des tilleuls surplombant l’entrée pour se nourrir. Nous nous dirigeons ensuite vers « la Crutte », l’espace où « le Chevreuil » (comme il se prénomme parfois lui-même) avait établi le centre de son territoire, quand je mesure rapidement que la forêt qu’il décrit dans son ouvrage n’est plus celle dans laquelle il vivait à l’époque. Désormais clôturé à de nombreux endroits pour protéger les cultures, le massif forestier de 500 ha qui, en lisière, paraît intact est en réalité très exploité : des coupes à blanc ont été réalisées sur de nombreuses parcelles, et si des panneaux d’affichage indiquent que la régénération naturelle est en cours, le bois n’a plus la même allure ! « C’est l’une des raisons majeures de mon départ : après une coupe rase, la forêt devient invivable, témoigne Geoffroy. Il n’y a plus ni plante, ni racine, ni champignon. Là où la forêt était sombre et fraîche, elle devient chaude et sèche. Elle est également trop calme, et je n’y vois plus qu’un site industriel. » Avec le temps, la végétation repousse, certes : « Ça devient un snack-bar pour les chevreuils, ils s’y baladent, se reproduisent beaucoup, n’ont pas de concurrence, mais il est impossible de s’y abriter. En perturbant la forêt, on les pousse à se déplacer constamment alors qu’ils sont sédentaires à la base. »
En longeant cette parcelle dénaturée, nous en venons à la manière dont il a sensiblement pris le pli sauvage. « La vue ne sert qu’à confirmer ce que l’on a déjà perçu, c’est l’odorat le sens premier. Les fougères, par exemple, n’ont pas la même odeur la nuit et ces repères olfactifs sont indispensables pour se repérer dans l’obscurité », m’explique-t-il. D’après lui, les chevreuils opèrent de véritables cartes d’identité olfactives : « Nos modes de vie, notre état de stress et notre humeur jouent sur notre odeur. En forêt, chaque promeneur a une odeur différente : depuis les buissons où ils se cachent, les chevreuils savent les repérer et compléter le puzzle olfactif de chaque individu au fur et à mesure. » Un réflexe utile pour estimer la dangerosité de celui ou celle qui arrive.
Chapitre 4 – S’ensauvager
Prendre goût
On prend vite goût à cette vie reliée et sensible. Si elle n’a pas les atours du confort moderne auquel il est si facile de s’habituer, elle offre une richesse de sens qui donne une certaine mesure du bonheur. A côtoyer autrement l’animal, le végétal et le sauvage, on se relie autrement au fil de la vie, on cesse de se soustraire à la toile du vivant, avec un sentiment de plénitude sans doute plus vaste, intérieurement. Il me semble que ce sentiment d’appartenance va de pair avec une sensation d’accomplissement plus robuste qu’une réussite sociale, qui pousse à acquérir et posséder tant de choses qui creusent le fossé avec le reste du monde vivant.
Chapitre 6 – Cohabiter
Rêve d’une vie légère
Les médias ne stigmatisent plus comme avant ce type de vie rurale, authentique et bucolique. Même Laurent Delahousse, sur France 2, diffuse maintenant de longs reportages mettant en avant la désobéissance fertile, telle que promue par Jonathan Attias installé en Corrèze, à Chasteaux, dans un village de cabanes joliment baptisé « le Lavandou ». Ce jeune homme, dont je connais les actions depuis plusieurs années, a fait le choix de s’y installer il y a deux ans, avec sa femme Caroline et ses enfants. Ancien producteur audiovisuel, il promeut désormais cette vie simple où l’accomplissement passe par la culture de la permanence. Pour Jonathan, l’essentiel est de régénérer, d’agir en conscience sans attendre que les lois ne changent et d’« aggrader » (au lieu de dégrader) son environnement : « En étant gardien de la terre, on s’inclut dans l’écosystème, on ne s’en extrait pas, car notre ingéniosité est mise au service d’une empreinte vertueuse. » Seul hic, souligné dans le reportage et dans d’autres articles, leur installation est dans une zone préservée, ce qui, au niveau local, crée quelques soucis. Comme l’exprime Caroline, « il y a des lois qui permettent de polluer la plupart des cours d’eau, mais elles ne nous permettent pas de construire un habitat léger sur notre propre terrain. Si ces lois ne permettent pas à ceux qui le veulent de s’extraire de la machine infernale pour retrouver un mode de vie harmonieux, alors oui, on désobéira ». Et Jonathan d’ajouter à son tour : « Si les lois ne nous permettent pas de vivre et de nous intégrer dans la Nature, alors dépassons ces lois ; aussi, n’attendons pas que les lois changent pour changer nos vies. Cette vision peut sembler radicale pour certain·e·s ; mais la radicalité nous semble appropriée dans la mesure où nous voulons justement revenir à la racine des problèmes relatifs à nos sociétés et changer un système de lois mortifères, pour résoudre une équation visant à pérenniser la vie sur Terre. »
Si envisager ce mode de vie et cette radicalité n’est pas donné à tout le monde, une autre question se pose aussi : peut-on revenir à l’essentiel en se mettant à l’écart ? En parlant avec des collectifs belges spécialisés dans l’habitat léger, par exemple, je réalise qu’un exode urbain massif, dans un pays où la densité urbaine est trois fois plus élevée qu’en France, serait compliqué et sans doute même peu souhaitable. « En Belgique, l’“into the wild” profond dure dix minutes ! On a besoin de gens qui réexpérimentent la vie avec moins de choses pour donner envie aux autres, mais il ne faut pas que tout le monde quitte les villes pour aller dans la nature… sinon, elle n’aura plus la même allure ! », souligne Vincent Wattiez, qui habite dans le légendaire quartier autoconstruit de la Baraque, à Louvain-la-Neuve.
Vincent travaille pour différents collectifs qui œuvrent à la reconnaissance juridique des habitats légers : il connaît parfaitement les freins qui enserrent leur développement et les leviers qui contribueraient à leur épanouissement au cœur d’une société en pleine dynamique transitionnelle et en recherche d’un retour à des valeurs de solidarité. En Wallonie, environ 20 000 personnes vivent dans ce type d’habitat, pour des raisons variées : les gens du voyage le font depuis toujours, puis viennent ceux qui s’installent en zones de loisirs et enfin ceux que Vincent appelle les « mange-bio », qui font ce choix pour des raisons plus écologiques qu’économiques. Derrière une bonne dose d’humour belge, le regard de Vincent sur ces enjeux m’intéresse parce qu’il est affûté et qu’il a réussi à créer des amitiés politiques et stratégiques entre des publics aux motivations fort différentes. Conscients que ce travail d’alliance entre cultures prend du temps, Vincent et l’ensemble des membres mobilisés dans ses collectifs ne perdent pas le cap de la bascule qu’ils veulent opérer pour favoriser leur alternative : ils savent que les normes évoluent lentement et que la planification de l’aménagement du territoire et l’urbanisation sont des sujets sensibles hautement inflammables, sur lesquels les ententes doivent se travailler en amont pour espérer arriver à leurs fins. Sachant que ces ententes, évidemment, doivent être façonnées également en fonction des enjeux liés au reste du vivant… Pas simple.
Bétonisation
Aujourd’hui d’ailleurs, ce sont d’autres panneaux qui me font froid dans le dos : les pancartes annonçant la construction de lotissements ou les permis de construire en zones jusque-là préservées me donnent encore plus la nausée. Quand on sait que l’équivalent d’un département français disparaît sous le béton tous les dix ans et que l’artificialisation des sols progresse d’environ 8,5 % par an, on a de quoi questionner la « nature des projets » proposés par les aménageurs-bétonneurs.
Dans notre quartier, les « maisons Yes », « maisons Eglantine » ou « Alpha Construction » poussent comme jamais. La voisine qui élimine ses arbres entend bien bétonner 4 600 m2 pour y installer plusieurs maisons, le maire ayant accepté de passer le champ, auparavant inconstructible, en zone urbanisable. La tension foncière et le coût de la terre en zone périurbaine sont tels que beaucoup vendent leurs terrains pour des raisons financières. Ils répondent ainsi à une demande croissante d’urbains désireux de se mettre au vert alimentant dès lors le marché du logement neuf, l’aménagement des routes, les grands contournements et l’installation de zones commerciales. Comme le dit très bien, une fois encore, Baptiste Morizot, « notre époque est marquée par l’éco-fragmentation. Le bâti humain, les routes, l’artificialisation des terres grignotent de manière exponentielle les habitats des autres formes de vie et les poussent tout contre nous. Cela entraîne des conflits ». Des conflits et des pandémies, car à bien y penser, la zoonose à l’origine de la Covid-19 est assurément liée à un tel rapprochement. Comment faire, dans ces conditions, pour vivre en harmonie ? Comment subsister sans scier la branche de l’arbre de vie sur laquelle nous sommes assis ? Comment cesser d’abîmer nos liens au reste du vivant ? A ce stade de la réflexion, il est important de questionner la notion de « propriété » et la manière dont les enjeux ont aujourd’hui besoin d’être reterritorialisés. Cette terre sous nos pieds nous est indispensable. Il nous faut la redécouvrir, atterrir et comprendre que si nous partageons toujours le même habitat (la planète), il nous est nécessaire de réviser notre façon d’en partager la superficie. En vérité, nos relations sociales et politiques se trouvent modifiées avec un sol qui « devient de façon manifeste le catalyseur de conflits, de résistances, de réinvestissements affectifs et conceptuels dont on peine encore à dessiner les contours ».
L’enjeu de ce « retour à la terre » est bien évidemment de ne pas faire marche arrière. C’est parce que nous avons perdu pied, dans une société mondialisée, avec un capitalisme sans territoire et une agriculture hors-sol, qu’il nous faut renouer avec une économie qui remet les pieds sur terre, avec une vision politique qui intègre le sol et le non-humain – non comme des entités qui nous sont extérieures et qu’il nous faut protéger, mais comme des éléments en mesure de s’adapter et de réagir (chimiquement, biologiquement, géologiquement) à la pression qu’on exerce.
Chapitre 7 – Lutter
Zones à défendre
Aussi faut-il souligner, ici, le rôle des mobilisations citoyennes qui cherchent justement, un peu partout dans le monde, à mieux protéger notre environnement. Le slogan « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend » est bien connu des militants ayant pris l’habitude de défiler dans la rue lors de marches pour le climat. Il sonne terriblement vrai, et pourtant les termes d’« ayatollah », d’« écolo hystérique » ou d’« amish » fusent encore trop souvent aujourd’hui pour qualifier les militants écologistes. Si cela prouve que leur lutte dérange, cela signifie aussi que nous ne sommes pas au bout de nos peines pour faire entendre cette cause.
Nombreux sont les citoyens qui s’engagent aujourd’hui pour éviter le pire. Dans mon quotidien de journaliste spécialisée sur les questions d’environnement, je reçois fréquemment des messages au sujet de mobilisations organisées pour faire front à la destruction du vivant : l’été 2021, par exemple, a été marqué par le projet de vente du site agroécologique de Grignon (ancienne propriété d’AgroParisTech) à un promoteur immobilier et par la destruction des historiques jardins d’Aubervilliers, qui seront bientôt remplacés, en partie, par des complexes sportifs dédiés aux Jeux olympiques de 2024. Partout en France, des citoyens se mobilisent pour lutter contre la destruction des espaces naturels et l’artificialisation des sols par cette « arme de destruction massive » qu’est le béton.
Chaque fois, derrière les mots de ces fins connaisseurs du vivant, je sens l’incompréhension et la rage de celles et ceux qui m’envoient leurs messages. Julie Lefebvre, qui travaille pour le collectif Paysages de l’après-pétrole, me détaille ainsi le combat qu’elle mène depuis plusieurs années pour préserver la forêt de Romainville : « Cette forêt sauvage de 27 ha, constituée sur d’anciennes carrières de gypse, s’est reconstituée pendant cinquante ans. Elle représente un poumon vert exceptionnel à 2 km de Paris : les clématites et les houblons qui s’accrochent aux sycomores et aux merisiers forment une jungle au relief escarpé. Ce refuge de la biodiversité ordinaire (insectes, papillons, chauves-souris, oiseaux, renards, etc.), qui abrite aussi quelques espèces remarquables mais non protégées (cynocéphales gracieux, éperviers, agripaumes cardiaques) est sans équivalent en Seine-Saint-Denis et à une telle proximité de Paris. » Dans cette forêt, la région Ile-de-France veut installer une base de loisirs : à l’automne 2018, elle a défriché 4 ha de forêt et comblé 8 ha de carrières pour aménager une île de loisirs inaugurée au printemps 2021. Si les militants ont longtemps regretté le manque d’enquêtes publiques et de concertation, ils ont réussi à obtenir en définitive une médiation et la protection de 20 ha de forêt.
Vous l’aurez compris : ce sont souvent les mêmes problématiques, les mêmes histoires, les mêmes rapports de force. Et c’est un crève-cœur de voir qu’il est si difficile d’arrêter les bétonneuses.
Chapitre 8 – Transmettre
Les enfants des villes et des écrans
Aux enfants auxquels on demande d’être raisonnables, que l’on somme de se conformer à un cadre qui, avec le temps, les formate pour les faire entrer dans les normes et des boîtes, nous avons proposé un monde hors-sol : avec le temps, l’urbanisation, l’éloignement de la vie paysanne, les lieux de l’enfance ont changé. Désormais, les enfants des villes sont plus nombreux que les enfants des champs. Le rapport au temps n’est plus ponctué par le rythme d’une vie passée au grand air, à la ferme. On ne cultive plus le temps long et le sens de l’attente. En s’éloignant ainsi du rythme de la vie, nous sommes passés d’une logique qui transmet et cultive pour en nourrir une qui exploite pour produire. En ville, les enfants n’ont plus le monopole de la rue comme il y a encore quelques décennies : voitures, vélos, trottinettes rendent l’espace public moins pratique pour s’amuser dehors. Les parcs de jeux sont conçus sans place pour l’imaginaire, avec des matériaux ne craignant pas les intempéries et n’étant pas susceptibles d’être souillés d’excréments, comme beaucoup le craignent dans les bacs à sable. Nous avons créé des enfants « papier bulle » : ainsi, nous limitons au maximum les risques de maladies, de bobos, de difficultés quotidiennes.
Des enfants qui n’ont plus la même autonomie qu’avant non plus : en quatre générations, le périmètre laissé à l’enfant seul est passé de 10 km à 300 m. Les enfants n’habitent plus le monde comme nous l’habitions avant. Et le monde d’avant n’était pas non plus celui que nous côtoyons aujourd’hui. In fine, nous accordons moins de confiance à nos rejetons, nous ne leur permettons plus de s’épanouir comme auparavant en pareille situation d’exploration et d’autonomie. Ainsi, ce ne sont peut-être pas tant les enfants qui ont changé que les parents, avec leurs peurs et leurs appréhensions. Nous, parents, sommes sans doute plus attentifs à la sécurité des corps, mais mesurons-nous vraiment ce que cela peut créer au niveau de la sécurité psychique et affective des enfants ?
Pour la sociologue et formatrice Anne-Louise Nesme, cette recherche de sécurité physique est légitime mais ses effets sont délétères : « Comment nourrir un lien d’attachement sans pouvoir vivre d’expériences concrètes ? » Que nourrit-on avec nos peurs et nos interdits ? Comment intégrer son interdépendance au reste du vivant quand la nature, surtout en ville, est présentée comme un espace clos, interdit, sale ou dangereux ? Alors que l’enfance est une période clé où se construisent les fondements du rapport à soi et au monde, les enfants hors-sol, au périmètre d’exploration réduit, développent un lien limité à la nature – malgré les doudous ours et lapins ! Ultérieurement, il sera sans doute compliqué de créer à la fois de l’autonomie et du concernement. « L’environnement dans lequel un enfant grandit servira de point de référence à la façon dont il sera sensible à la nature, mètre étalon avec lequel il mesurera la dégradation de celle-ci et la qualité environnementale de son habitat au cours de sa vie. Aussi, si une génération naît et grandit dans un environnement dégradé, elle prendra cet état de son environnement comme une expérience de référence », explique le chercheur Minh-Xuan Truong.
On se rend compte, depuis le début des années 2000, des bienfaits de l’environnement sur la santé, et de la façon dont nous pouvons agir sur le syndrome de manque de nature pour résoudre d’autres maux dans la société. Karine Lou Matignon évoque d’ailleurs l’existence de liens entre la violence sur les animaux et la violence vis-à-vis des humains : « Dans certains pays, on observe des collaborations entre certains services (protection animale, justice, enfance) dès qu’on a un cas de maltraitance d’enfants dans une famille. On voit alors si le chien n’est pas maltraité, car souvent femmes et enfants battus le sont en même tant que l’animal de compagnie… » Aux Etats-Unis, des programmes en pleine nature ont même été développés pour essayer de canaliser la violence de certains enfants. « Des naturalistes, en 2005, ont lancé cette alerte en expliquant que préserver des espaces de nature pour immerger les gamins est crucial pour le bien même de la société », ajoute-t-elle. En attendant, en France, en 2015, 4 enfants sur 10 ne jouaient jamais à l’extérieur en semaine. Une majorité d’entre eux ne sait pas reconnaître des entités aussi communes qu’un pissenlit ou un chêne. Leur monde s’est rétréci, il s’est enrichi de peurs et d’écrans en s’éloignant des vivants. Quelle liberté ont-ils perdu ? De quelle sensibilité les privons-nous ? Comment leur offrir à nouveau un environnement adapté à leur rythme et à leur besoin, un espace de rêve et d’émerveillement loin des cadres de vie trop riches en stimuli ? Réponse : en les laissant libres de jouer, de rêver et de s’inventer… dehors, tant que possible ! Et en se gardant de trop intervenir.
L’enquête sauvage, La Salamandre, 2022, 256 pages, 20€
