Chères toutes et chers tous,
Alors que les scientifiques du Giec s’apprêtent à rendre public le deuxième volet de leur dernier rapport la semaine prochaine, on vous propose dès à présent de réserver votre mercredi soir pour débriefer cette sortie très attendue avec nos journalistes. Rendez-vous à la Base (31 rue Bichat, Paris 10e) mercredi 2 mars à 19h30.
En attendant notre édition spéciale à paraître ce lundi, vous pouvez potasser vos dossiers en vous replongeant dans notre décryptage du premier tome sorti l’été dernier.
Un numéro où l'on verra qu'il y a des modes qui pèchent et des pêches qu'on aimerait voir passées de mode.

L214 lève le voile sur le chalutage industriel
Coup de filet. L'association de protection animale L214 a filmé la souffrance des animaux marins à bord de chalutiers français et britanniques. Elle alerte également sur l'impact environnemental des méthodes de pêche peu sélectives.
Âmes sensibles... Les opiniâtres défenseurs de la condition animale de L214 ont décidé de frapper fort toute la semaine avec la parution de cinq enquêtes destinées à interpeller les candidat·es à l'investiture présidentielle sur la condition animale dans les systèmes d’élevage ou de pêche intensifs. De tous les volets mis en lumière (poulets de batterie, canards à foie gras, etc), la pêche au chalut est sans doute le moins connu du grand public. Et pourtant.
Sur les images filmées par l’association allemande Soko Tierschutz à bord de deux chalutiers pêchant dans la Manche, on peut voir des poissons suffoquant dans d’immenses filets ou sur le pont des bateaux : « l’asphyxie peut durer de 25 minutes à 4 heures », précise l'association dans un communiqué. Les poissons qui n’ont pas de valeur marchande sont rejetés à la mer, moribonds. Les autres sont découpés vivants et conscients. On peut, par exemple, voir les employés arracher les pinces des araignées de mer sans étourdissement préalable.
« Malgré le consensus scientifique concernant la sensibilité des poissons, la réglementation est minimale, et totalement ignorée », souligne L214. Pour la biologiste suédoise Lynne Sneddon, qui a notamment mis en évidence les récepteurs de la douleur chez les poissons, « personne n'accepterait ce genre de traitement pour les vaches, les porcs, les moutons ou les poulets ».

Alors que le déclin de la ressource halieutique se poursuit (Reporterre), L214 alerte aussi sur les impacts environnementaux de la pêche au chalut, très peu sélective. Pour plus de 90 millions de tonnes de poissons pêchées annuellement dans le monde, s'ajoutent 7 à 20 millions de tonnes de prises dites « accessoires » car non commercialisables. D'autre part, le chalutage altère les fonds marins, la partie raclant le sol ayant pour effet d'arracher, d'écraser ou d'enfouir la faune et la flore.
L214 demande aux candidat·es à l’élection présidentielle de s’engager à organiser la fin de la pêche industrielle, de la pêche au chalut de fond et de la pisciculture intensive sous 10 ans. Selon sa propre évaluation, seuls Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon semblent disposés à faire du bien-être animal une priorité. Du reste, les Français·es consomment en majorité du poisson importé (24 kilos sur les 35 consommés annuellement) avec des normes parfois moins-disantes, selon le WWF.

· Six mois après sa promulgation, la loi « climat et résilience », qui devait traduire les propositions issue de la Convention citoyenne pour le climat (Vert), affiche un taux d'application de seulement 14% et son impact réglementaire et législatif est très faible. Sur 353 dispositions prévues, seules 13 peuvent être considérées comme ayant une réelle portée tandis que 245 ont un impact faible, révèle Contexte (abonné·es).
· Aux États-Unis, la ville de New York se lance dans la construction d'un mur anti-inondation pour préserver l'île de Manhattan, qui pourrait être submergée par la montée des eaux d'ici à 2050. D'énormes panneaux en béton vont être érigés sur quatre kilomètres au sud de l'île. Si l'idée semble appréciée des habitant·es, des activistes contestent la surélévation de plusieurs parcs pour réaliser ce chantier, estimé à 1,3 milliard d’euros et qui devrait se terminer en 2026. - Franceinfo


« Skischam »
Mauvaise pente. Alors que la saison des sports d'hiver bat son plein, un nouveau mot venu d'Autriche pourrait bien se glisser dans le vocabulaire de certain·es vacancier·es. Le Skischam – littéralement « la honte du ski » – désigne le malaise croissant des fans de glisse vis-à-vis du bilan écologique de leur séjour à la montagne.
L'expression rappelle d'ailleurs le flygskam, la honte de l'avion, qui avait déjà saisi les Suédois·es. En effet, alors que le réchauffement climatique s'aggrave, la pratique des sports d'hiver nécessite de plus en plus souvent de fabriquer de la neige artificielle à l'aide d'eau et d'additifs, projetés sur les pistes par des canons à neige énergivores. Le creusement de retenues d'eau artificielles peut perturber l'écosystème local et la neige de culture, plus dense que la vraie neige, affecter les sols en les privant d'oxygène.
Enfin, les stations de ski sont rarement reliées à des réseaux de transports en commun; plus de 60 % de leur bilan carbone repose sur la mobilité carbonée, tandis que 20 % provient des émissions liées à la construction et au chauffage du parc immobilier. Pour en savoir plus, consultez ce dossier concocté par Mediapart.

La SNCF lance un vaste plan pour solariser ses gares d’ici 2030
La transition va bon train. Mardi, le réseau SNCF Gares & Connexions a annoncé un plan photovoltaïque de grande ampleur pour solariser des milliers de gares à horizon 2030.
1,1 million de mètres carrés de panneaux solaires dans les gares d’ici 2030 ; voilà l’objectif affiché par le gestionnaire des installations ferroviaires françaises. La capacité électrique installée pourrait ainsi atteindre 150 à 200 mégawatts, soit l’équivalent de la consommation électrique de près de 150 000 personnes. Mardi, SNCF Gares & Connexions a lancé un « appel à manifestation d’intérêt » (AMI) pour trouver un partenaire industriel chargé de déployer les équipements photovoltaïques.
Le gestionnaire des gares compte s’appuyer sur ses larges propriétés foncières : parkings, quais, toitures des halles de voyageur·ses et des bâtiments de l’entreprise, friches ferroviaires, etc. Début 2024, SNCF Gares & Connexions prévoit déjà de mettre en service 190 000 mètres carrés d’ombrières photovoltaïques sur les parkings de 156 gares, soit 25 à 30 mégawatts de puissance électrique. La première partie du plan pourrait aussi inclure quatre grandes halles voyageur·ses.

L’électricité produite sera injectée sur le réseau d’électricité et « participera au verdissement du mix énergétique national », énonce le gestionnaire des gares. SNCF Gares & Connexions prévoit de réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à 2019. L’objectif est également d’aligner sa consommation totale d’électricité sur la production d’énergies renouvelables réalisées sur ses propriétés foncières.
Ce projet photovoltaïque s’inscrit dans un vaste plan de transition écologique des quelque 3000 gares françaises. « Portes d’entrée des mobilités durables, les gares doivent donner envie de prendre le train et être exemplaires en termes de standards environnementaux », justifie SNCF Gares & Connexions.

Notre histoire avec la nature
Réactions en chêne. Écouter le chêne, les arbres et les forêts, comme une inspiration nouvelle à être au monde… À l’occasion de la sortie hier au cinéma du film Le Chêne de Laurent Charbonnier et Michel Seydoux, Création Collective propose une série de podcasts réalisée sous le patronage scientifique du Muséum national d’Histoire naturelle. Dans le quatrième épisode, l'historienne des sciences et de l’environnement Valérie Chansigaud éclaire l’histoire de notre relation aux plantes, où l’on comprend les origines de nos rapports asymétriques avec le reste des êtres vivants. Elle démonte l’idée d’un âge d’or des liens entre les humains et la nature, détaille avec soin notre façon d’exploiter les ressources naturelles, explore les ressorts d’un rapport complexe avec notre environnement avant de retracer les origines des mouvements de protection de la nature.
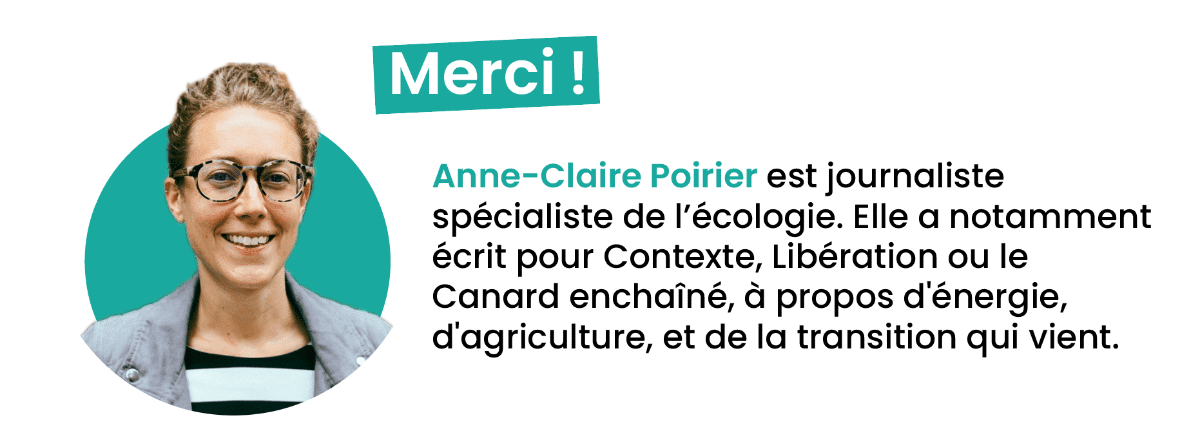
+ Anne-Sophie Novel et Justine Prados ont contribué à ce numéro

