Avec un peu moins de trois millions d’hectares cultivés en bio en 2021, c’est-à-dire 10% de sa surface agricole, la France était leader du secteur au niveau européen devant l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne. À côté des produits estampillés bio, une multiplicité d’indications sont apparues, à l’image de la certification «haute valeur environnementale» ou de la mention «local».
Que recouvrent ces différents termes ? Le comprendre est essentiel pour savoir ce que l’on met dans son assiette.
Le bio, un label public strictement contrôlé
Le label bio évolue dans un cadre législatif clairement défini, au niveau français comme européen. En France, le premier cahier des charges de la bio date de 1985, de même que le label AB (agriculture biologique) figurant sur les produits de la filière. Au niveau européen, ce mode de production alternatif à l’agriculture dite conventionnelle, qui domine depuis la seconde moitié du 20ème siècle, est reconnu au début des années 1990. Le label Eurofeuille devient obligatoire au sein de l’Union européenne à partir de 2010.
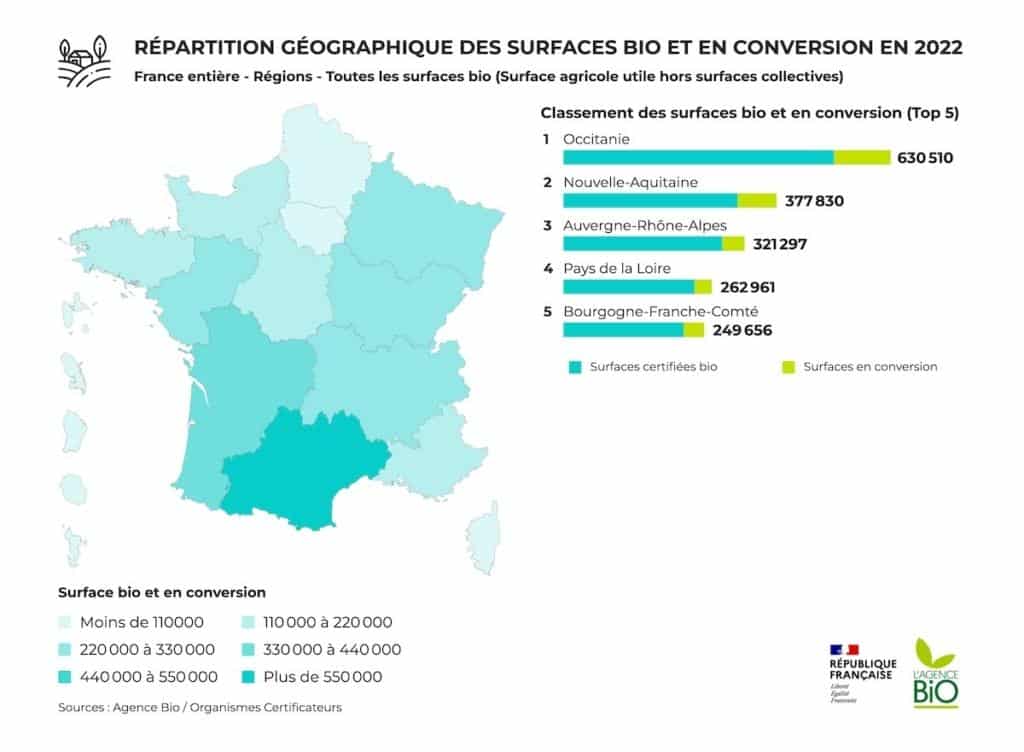
Le cahier des charges pour produire en bio implique la rotation des cultures, l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires, des engrais de synthèse ou des OGM ; les animaux d’élevage doivent recevoir de la nourriture bio, un nombre limité de traitements vétérinaires et ne pas être élevés hors sol. Pour garantir ces pratiques agricoles respectueuses du bien-être animal, de la biodiversité et du climat, des organismes certificateurs effectuent des contrôles.
En résumé : lorsque vous voyez le label AB sur vos paquets de gâteaux, cela signifie que le cahier des charges a bien été respecté. Le blé qui aura poussé pour élaborer la farine de vos biscuits est garanti sans pesticides.
La proximité, ce critère à géométrie variable
Vous l’aurez sans doute remarqué : le cahier des charges bio ne comprend pas d’indication géographique qui commanderait de produire «à proximité». On pourrait alors penser que la mention «produit localement», que l’on voit fleurir depuis 2020 et le premier confinement, répond à cette préoccupation d’être au plus près des consommateurs. En fait, pas vraiment !
«Pour la bio et d’autres appellations, comme les appellations d’origine protégée (AOP) ou contrôlées (AOC), le critère central de qualité de la production est défini de manière stricte et règlementaire, explique le sociologue Jean-Baptiste Paranthoën, auteur de l’ouvrage Les circuits courts alimentaires. Du côté du local, en revanche, la proximité n’est pas clairement définie. De quelle proximité géographique parle-t-on ? De celle du département, de la région, du pays, de l’Europe ? La question n’est pas tranchée».
Une définition «officielle» concernant la vente de produits en circuits courts existe bien, on la trouve sur le site du ministère de l’économie. Mais elle désigne une proximité au sens organisationnel et non géographique : «La notion de circuits courts est utilisée pour valoriser un mode de vente limitant le nombre d’intermédiaires mais ne prévoit pas de notion de proximité physique (kilométrage)». Acheter une bouteille de vin en Australie directement auprès du vigneron permet de cocher la case «circuit court».
En résumé : lorsque vous voyez la mention «local», sachez que la proximité géographique n’est pas fixée et que les informations sur la manière dont les produits ont été élaborés ne sont pas obligatoires. On est ici dans le flou.
Il existe bien sûr des réseaux, comme celui des AMAP (Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne) ou des CIVAM (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural) qui, de longue date, rapprochent producteur·ices et consommateur·ices dans une démarche de durabilité, mais ils restent marginaux dans le domaine des circuits courts. «Ce sont les ventes directes à la ferme qui restent la forme la plus répandue», précise Jean-Baptiste Paranthoën. Des fermes qui peuvent produire de manière conventionnelle à l’aide de produits phytosanitaires et d’intrants.
«Avec la question de la proximité géographique, du local, on entre dans le domaine de la confiance et de la croyance. Des produits bio élaborés plus loin, en Europe, pourront provoquer la suspicion, ce qui n’est pas vraiment justifié», analyse l’agronome Stéphane Bellon, ingénieur de recherche à l’Inrae.
On le comprend, en respectant un cahier des charges strict et harmonisé, les produits certifiés bio fournissent aux consommateur·ices une traçabilité et la garantie de modes de production respectueux de l’environnement.
Empreinte carbone et prix
Restent deux points fréquemment évoqués pour opposer bio et local : la question du poids carbone des productions et celle du porte-monnaie.
Produire à quelques dizaines de kilomètres des futur·es acheteur·ses semble à première vue un levier efficace pour alléger le bilan carbone de la production alimentaire. En réalité, le poids des transports dans l’empreinte carbone de l’alimentation est faible. En mai 2021, le réseau Action Climat présentait ses évaluations sur le sujet : «84% des impacts écologiques de notre alimentation résultent de la manière dont les denrées alimentaires sont produites : le transport des produits n’en représente ainsi qu’une part marginale».
Dans une période d’inflation comme celle que nous traversons, la question du coût des produits alimentaires se pose de manière brutale pour un nombre croissant de personnes. Si certains produits bio comme le lait, les œufs et le jus d’orange coûtent en moyenne près de 35% plus cher que ceux issus de la filière conventionnelle, l’Agence bio, qui soutient le développement et la promotion de l’agriculture biologique, rappelle qu’il est possible de contrer ces effets en s’approvisionnant en produits bio, bruts, de saison… et locaux.
«Il n’y a pas vraiment de sens à opposer le bio et le local. Compte tenu de ses modes de production, l’agriculture bio prend en compte les spécificités du territoire», conclut Stéphane Bellon. Mais s’il faut choisir, il apparaît clairement que c’est plutôt le bio qu’il faut favoriser, car il s’agit du label le plus étroitement contrôlé et qui offre la plus grande traçabilité aux consommateur·ices en matière de production agricole durable.
Photo d’illustration : Anna Kaminova / Unsplash
Cet article est issu de notre rubrique Le vert du faux. Idées reçues, questions d’actualité, ordres de grandeur, vérification de chiffres : chaque jeudi, nous répondrons à une question choisie par les lecteur·rices de Vert. Si vous souhaitez voter pour la question de la semaine ou suggérer vos propres idées, vous pouvez vous abonner à la newsletter juste ici.


