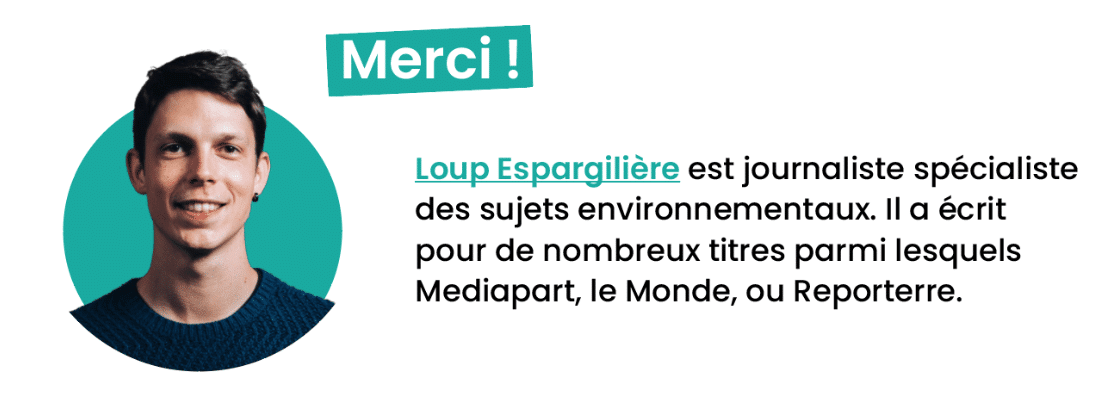Moins on entendra les activistes africains du climat, plus les prédateurs pourront sucer la moelle de leur continent.

La loi antigaspillage définitivement adoptée
Après des centaines d'heures de débats, et des semaines d'allers-retours, le Sénat a définitivement adopté, jeudi 30 janvier, la « loi antigaspillage ». En vrac, parmi les nouveautés de cette loi relative à l'économie circulaire :
- Des objectifs chiffrés : atteindre 100 % de plastique recyclé d’ici 2025 ; réduire de moitié le nombre de bouteilles en plastique à usage unique d'ici 2030 ; enfin, et c'est une date qui a provoqué l'ire des ONG : les emballages en plastique à usage unique seront interdits définitivement en... 2040.
- De nouvelles filières de responsabilité étendue du producteur (REP), qui mettent en pratique le principe du pollueur-payeur, seront créées pour les mégots, les matériaux de construction, les articles de sports et loisirs ou encore, les lingettes imbibées. Les fabricants des secteurs concernés devront payer pour la collecte et le traitement des déchets issus de leurs produits.
- Les produits électroniques et électroménagers devront faire apparaître dès 2021 un « indice de réparabilité » sur leurs produits. Cette note, de 1 à 10, donnera une indication sur la facilité ou difficulté à réparer l'appareil et à trouver des pièces détachées.
- La présence de perturbateurs endocriniens dans les produits devra être rendue disponible par les fabricants sur internet, et non pas sur leurs emballages, comme il en avait été question.
- L'interdiction de la destruction des invendus non-alimentaires neufs. Le réemploi, le don, le recyclage ou la réutilisation seront obligatoires.
La réforme présentée en détail est à lire sur le site du Figaro (AFP).

Les « violations des droits humains » de Total en Ouganda au tribunal de commerce
La pompe Afrique a encore de beaux jours devant elle. Des associations ont saisi le tribunal judiciaire de Nanterre pour faire cesser ce qu’elles considèrent être des « violations des droits humains » de la part de Total en Ouganda. Le pétrolier veut y exploiter plus de 400 puits de pétroles dans le parc national protégé de Murchison Falls et construire un gigantesque oléoduc. Jeudi 30 janvier, les ONG ont été renvoyées vers le tribunal de commerce.
Des dizaines de personnes déplacées manu militari sans avoir reçu de compensation, des paysans qui perdent l'accès à leurs terres... Les Amis de la Terre, Afiego, Cred, Nape, Navoda et Survie dénoncent des « violations ou graves risques de violations des droits humains » d’une filiale de Total et de deux sous-traitants. Les associations ont saisi le tribunal judiciaire pour forcer le pétrolier à appliquer la loi sur le devoir de vigilance, qui oblige les grandes entreprises à tenir compte des impacts de leurs activités en matière de sécurité et d'environnement.
Or, comme l'espérait Total, le tribunal s’est déclaré incompétent pour juger cette affaire, et l'a renvoyé devant le tribunal de commerce. Les ONG craignent que celui-ci sera plus clément et sensible aux arguments de la multinationale. A lire dans Mediapart.

De la diversité dans le mouvement climatique
« C'est comme si je n’avais pas été pas là ». Présente au forum économique mondial de Davos, l'activiste ougandaise Vanessa Nakate a découvert qu'elle avait disparu d'une photo où on la voyait en compagnie de Greta Thunberg et d'autres jeunes militant•e•s. Cette exfiltration opérée par l'agence américaine AP a fait naître un vaste débat à propos de la représentation de la diversité dans le mouvement climatique.
« Tout le monde dit que j’aurais dû me mettre au milieu […] Est-ce qu’un activiste africain doit se mettre au milieu simplement par peur d’être coupé de la photo? » a interrogé sur Twitter Vanessa Nakate, le 25 janvier dernier. Son indignation a provoqué une tempête sur les réseaux sociaux, forçant AP à s'excuser. Les messages de soutien et les témoignages ont afflué, signes que ce qui a pu être présenté comme une erreur ou une maladresse était le révélateur d'un problème plus profond.
Avec une dizaine d’autres jeunes activistes, Vanessa Nakate avait participé à un weekend d’ateliers à Davos. Elle dit avoir eu du mal à trouver des photos d’elle. « Les militants […] de couleur sont effacés. Des activistes m’ont écrit pour me dire que la même chose leur était arrivée mais qu’ils n’avaient pas eu le courage de dire quoi que ce soit », a raconté Vanessa Nakate au Guardian.
Au cœur de la polémique, la « culture » d'invisibilisation des minorités, pourtant souvent les plus affectées par les conséquences du réchauffement, comme l'explique encore au quotidien britannique, Jamie Margolin, militante latino-américaine fondatrice du groupe Zero Hero. A lire dans le Guardian (en anglais).
Hilda Flavia Nakabuye, la militante contre la « colère des dieux »
Compatriote de Vanessa Nakate, la militante ougandaise Hilda Flavia Nakabuye se bat sur tous les fronts pour alerter ses concitoyens sur l'urgence de la crise climatique.
La Croix nous raconte la riche vie de l'étudiante de 22 ans originaire de la région du lac Victoria, ravagé par les prédations et les sécheresses. Sa grand-mère invoque la colère des dieux, Hilda Flavia Nakabuye sait que les coupables sont ailleurs.
Parmi ses nombreux faits d'arme, la jeune femme a lancé la version ougandaise des Fridays for future, les vendredis pour le climat initiés par la Suédoise Greta Thunberg. En menant des actions de sensibilisation ou en interpellant les pouvoirs publics, elle tente de sonner la révolte dans un pays où les manifestants n'ont souvent pas leur mot à dire. Son portrait est à lire dans la Croix.

Après le Green deal, le Blue manifesto
Un plan de sauvetage européen pour les océans : 102 ONG, parmi lesquelles WWF, Greenpeace ou la Surfrider Foundation, viennent de signer le « Blue manifesto ».
Version marine du Green deal présenté fin 2019 par la Commission européenne, le « manifeste bleu » contient une série de mesures d'urgence à prendre à l'échelle européenne au cours des dix prochaines années.
Ces recommandations doivent entraîner la « protection forte ou complète d’au moins 30% de l’océan d'ici à 2030 », une transition complète vers la pêche sélective, la fin de la pollution des océans, la restauration des écosystèmes marins. Le manifeste (en anglais) comporte une liste des mesures précises et datées, parmi lesquelles la fin de l'exploitation minière des grands fonds marins, la ratification d'un traité mondial des océans ou encore, la création de zones interdites aux chalutiers. A lire sur le site de Seas at risk.

Le Guardian abandonne les publicités fossiles
Décidément, le Guardian est un phare dans la prise de conscience climatique parmi la presse internationale. Mercredi 20 janvier, le quotidien britannique a annoncé qu'il n'accepterait plus de publicités d'entreprises productrices de gaz ou de pétrole dans ses pages.
« Nous avons pris cette décision en réponse aux efforts entrepris depuis des décennies par cette industrie afin d'empêcher toute action en faveur du climat par les gouvernements partout à travers le monde », ont déclaré deux cadres du Guardian.
En octobre 2015, le journal avait déjà publié son « serment environnemental » : les journalistes s'y étaient engagés à employer des termes à la hauteur de la catastrophe (« crise » et non pas « changement » climatique), à témoigner de la sévérité des désastres liés au climat et à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2030.

Vers la reconnaissance des réfugiés climatiques
Ils seront des millions dans les décennies à venir et pourtant, ils n'ont aucun statut juridique. Dans un avis inédit, rendu public le 21 janvier, le comité des droits de l'Homme de l'ONU a ouvert la voie à la reconnaissance des réfugiés climatiques.
Les membres de cette instance des Nations unies, chargée de s'assurer du respect du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ont étudié la requête d'un habitant des îles Kiribati. Situé dans le Pacifique, cet archipel est directement menacé par la montée des eaux. Parti de son pays en 2007, cet homme a demandé l'asile en Nouvelle-Zélande, qui lui a été refusé au motif que sa vie n'était pas en danger.
Si le comité a jugé que la décision néozélandaise était justifiée, son avis a cependant ouvert la voie à la reconnaissance du statut de réfugié climatique. Les experts considèrent que « les Etats […] doivent permettre à tous les demandeurs d'asile qui affirment faire face à un risque réel de violation de leur droit à vivre dans leur Etat d'origine, d'accéder aux procédures de reconnaissance du statut de réfugié [ou de tout autre statut] qui les protégeraient de l'expulsion. »
Autrement dit, les Etats doivent au moins étudier les demandes d'asiles déposées au nom du risque climatique. Le Comité reconnaît également que le changement climatique représente une grave menace pour le droit à la vie des individus.
Les avis rendus par le Comité n'ont toutefois pas de pouvoir contraignant. Mais selon Filippo Grandi, haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, les 172 Etats signataires du pacte international relatif aux droits civils et politiques devraient l'appliquer. A lire dans le Monde.