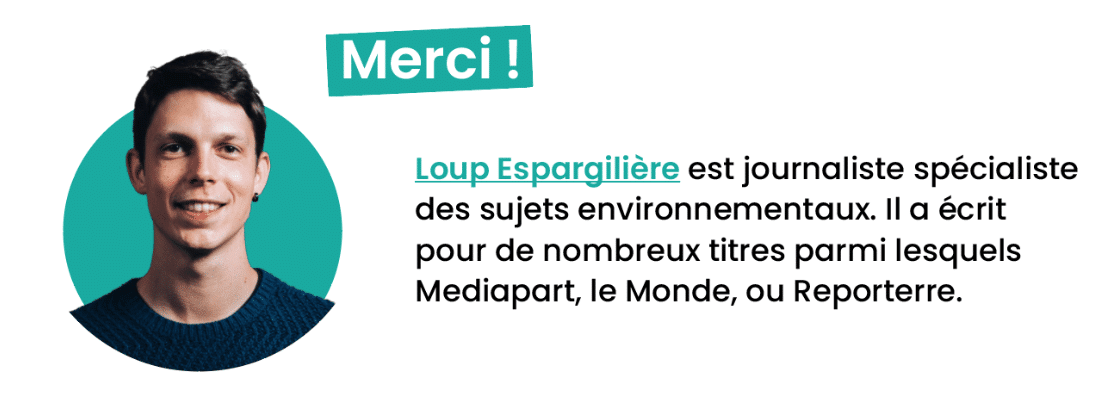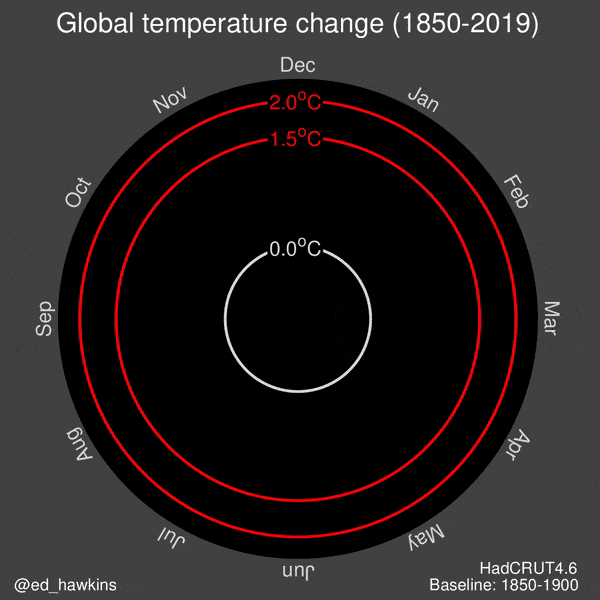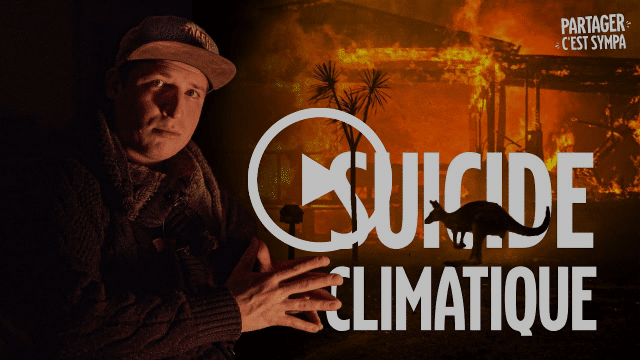Quelques drôles d'oiseaux refusent encore de le voir, mais c'est bientôt la fin d'une époque pour un certain monde agricole.

Les océans n'ont jamais été aussi chauds
La marmite bout. Selon une étude, parue lundi dans la revue Advances in Atmospheric Sciences, les océans n'ont jamais été aussi chauds qu'en 2019.
A l'aide, notamment, des données issues des 3800 balises Argo, les chercheurs ont collectionné les relevés de température entre 0 et 2000 mètres de profondeur à travers la planète. Ils ont non seulement constaté que 2019 était l'année la plus chaude jamais mesurée, mais que celle-ci détenait également la palme de la hausse la plus importante d'une année sur l'autre. Les cinq dernières années sont les cinq années les plus chaudes.
Les océans permettent une mesure beaucoup plus stable de l'évolution du réchauffement que la température de l'air, soumise à de fortes variations. Par ailleurs, ils absorbent plus de 90% de l'excès de chaleur dû aux activités humaines et jouent un rôle de thermostat planétaire, comme l'explique le Figaro.
Des océans plus chauds génèrent des tempêtes plus importantes, et ils dérèglent le cycle de l'eau, causant inondations, sécheresses, montées des eaux et incendies. Les vagues de chaleur marine, dont le nombre augmente, mettent en danger la vie marine. Coraux et mollusques sont menacés par l'acidification des océans due à une absorption de plus en plus grande de CO2. A lire dans le Guardian (en anglais) et dans 20 Minutes.
La Terre non plus n'a (presque) jamais été aussi chaude
La surface terrestre n'est pas en reste. Après le service européen Copernicus, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) confirme que 2019 est la deuxième année la plus chaude sur Terre. Avec elle, la décennie qui s'achève est également la plus torride depuis les premiers relevés, effectués dans les années 1850.
2019 s'est située à 1,1°C au-dessus de la moyenne de l'époque pré-industrielle (1850-1900). L'objectif, fixé dans l'Accord de Paris en 2015 de contenir le réchauffement sous 1,5°C paraît de plus en plus hors de portée. « Au rythme actuel des émissions de dioxyde de carbone, nous nous dirigeons vers une augmentation de la température de 3 °C à 5 °C d’ici à la fin du siècle », a estimé, mercredi, Petteri Taalas, secrétaire général de cette institution spécialisée des Nations Unies. Une prévision encore bien en-deçà de celle réalisée par des chercheurs français en septembre 2019 : jusqu'à +7°C en 2100.
En 2020 et dans les années à venir, les phénomènes métérologiques extrêmes tels que ceux qui frappent l'Australie depuis plus de quatre mois devraient se multiplier, selon l'OMM. A lire dans 20 Minutes.

Greenpeace et les « huit de Cattenom » condamnés à des amendes
En octobre 2017, ils avaient tiré des feux d'artifice depuis le site de la centrale nucléaire de Cattenom (Moselle) pour en montrer les failles ; Mercredi 15 janvier, la Cour d'appel de Metz a condamné les huit activistes de Greenpeace, ainsi que l'ONG elle-même, à de fortes amendes.
Les activistes écopent de peines de 180 jours-amende qui vont de 4 à 11 euros, soit entre 720 euros et 1 980 euros au total. Le directeur de la campagne nucléaire de Greenpeace, Yannick Rousselet est également condamné. Il devra s'acquitter de 270 jours amende à 10 euros. L'amende pour Greenpeace s'élève à 25 000€. Enfin, tous sont condamnés solidairement à verser des dommages et intérêts à EDF : 50 000€ au titre du préjudice moral et 211 806 euros pour préjudice matériel et économique.
Il s'agit toutefois d'une demi-victoire. En première instance, les activistes avaient été condamnés à des peines de prison, ferme pour deux d'entre eux. « Cette décision reconnaît implicitement le bien-fondé de nos motivations et la réalité du danger nucléaire. En écartant les peines d’emprisonnement, les juges montrent qu’ils ont été sensibles à nos arguments et à la vague de soutien qui a accompagné ce procès » a expliqué le directeur général, Jean-François Julliard, dans un communiqué. Aucune des parties n'a, pour l'heure, annoncé son intention de faire appel de la décision. A lire sur Reporterre.
La FNSEA veut bloquer les stations d'épuration
C'est une autre forme d'activisme, en quelque sorte. La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) menace de bloquer les stations d'épuration du pays si un moratoire n'est pas appliqué sur les nouvelles zones de non-traitement.
Un décret, entré en vigueur le 1er janvier, fixe désormais des distances minimales entre habitations et épandage de pesticides. Les agriculteurs ne peuvent plus pulvériser à moins de 5 mètres des logements pour les cultures basses, 10 mètres pour les cultures hautes, et 20 mètres pour les produits les plus nocifs (cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques). Des zones jugées bien trop restreintes par les associations, mais déjà suffisantes pour s'attirer les foudres de la FNSEA.
Les agriculteurs récupèrent une partie des boues d'épuration, déchets générés par les stations, pour les utiliser comme engrais dans leurs champs. Mardi, lors de ses vœux à la presse, le syndicat a annoncé qu'il pourrait demander aux agriculteurs de cesser de récupérer ces rejets, afin de saturer les stations d'épuration. Et de laisser patauger les collectivités qui en sont responsables. A lire dans 20 Minutes (décidément).

Une cellule militaire contre l'«agribashing »
Ceci est bien réel. Afin de lutter contre les atteintes faites aux agriculteurs, le gouvernement s'est allié à la FNSEA et aux Jeunes agriculteurs (JA) pour créer la cellule Déméter : une mission opérée par la Gendarmerie que dénoncent de nombreux membres d'associations environnementales et de producteurs dans une tribune.
Le site du ministère de l'agriculture résume ainsi les faits visés par la mission de la cellule Déméter : les « actes crapuleux », mais aussi les « actions de nature idéologique, qu’il s’agisse de simples actions symboliques de dénigrement ou d’actions dures ». « On aura compris : il s’agit de faire taire tous ceux qui mènent des actions symboliques contre le système de l’agriculture industrielle, dont la FNSEA est le principal soutien », dénoncent les signataires de la tribune.
Alors même, écrivent-ils encore, que le gouvernement est incapable de démontrer que l'agribashing, ce supposé dénigrement systématique de toute une profession, est réellement une tendance.« Depuis quelques années, un phénomène grandit, inacceptable. De plus en plus, nos agriculteurs sont visés par des intimidations, des dégradations, des insultes », a déclaré Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, lors de la présentation de la cellule, le 13 décembre dernier. Seul chiffre avancé supposé prouver ses dires : « Depuis le 1er janvier 2019, les atteintes à l’encontre du milieu agricole sont en hausse de 1,5% ».
Les signataires s'alarment encore de la future « intimidation accrue de tous les adversaires décidés de la FNSEA, qui passe nécessairement par la surveillance électronique et informatique, d’éventuelles écoutes téléphoniques, voire des filatures, des infiltrations, ou pire encore, la délation ». A lire sur le site de Reporterre.

Bannir totalement les pesticides
Nous ferions bien d'en prendre de la graine. En 2016, l'Etat indien du Sikkim a interdit totalement la vente et l'usage de pesticides. Et ça va très bien pour lui, merci.
Dans un long reportage, Libération retrace la genèse de cette révolution, initiée en 2003. Au début, les sols appauvris par des décennies d'agriculture chimique ont nécessité une transition en douceur. Cet Etat himalayen, plus épargné que les autres en raison de son enclavement, a pu reconvoquer des méthodes traditionnelles.
Les subventions pour les engrais chimiques ont été réduites de 10% par an entre 2003 et 2010. Elles ont été remplacées par des dons d'engrais bio. Alors que dans le reste du pays, ces subsides sont en forte augmentation. Depuis 2015, les 76 169 hectares de terres agricoles du Sikkim sont certifiés biologiques. Un récit à lire dans Libération.

Causerie au coin du mégafeu
L'Australie brûle et ses dirigeants regardent ailleurs. Dans sa dernière vidéo, Vincent Verzat de « Partager c'est sympa » raconte l'état du débat public australien sur la crise climatique. Déni, volonté de maintenir le statu quo... les dirigeants de l'un des plus gros exportateurs mondiaux de charbon refusent d'entraver le business pour de basses considérations écologistes.
Une préfiguration, selon le youtubeur, de ce qui pourrait advenir dans une France dirigée par un gouvernement néolibéral, si de telles catastrophes devaient survenir.