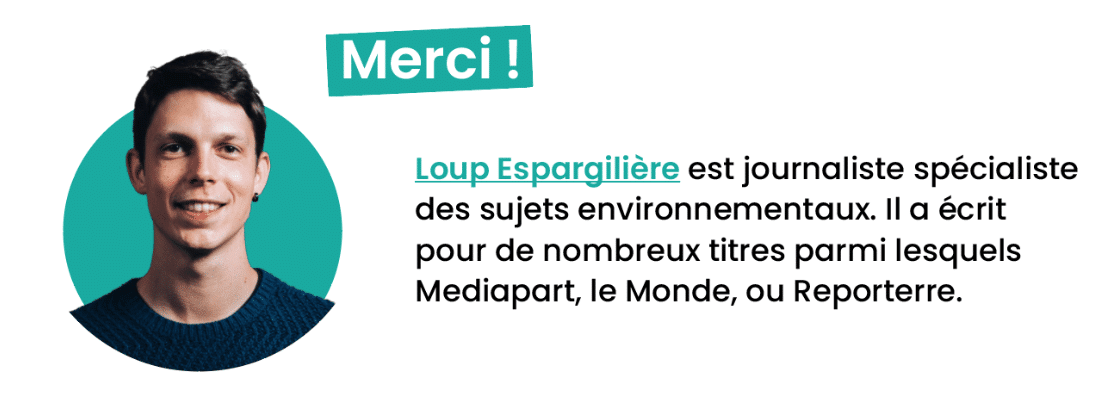Neige et sable = 2/20. Engagement = 10/20. Les jeunes qui luttent pour la défense du climat notent sévèrement l'action de leurs aînés.

Les émissions liées à énergie ont stagné en 2019
Voilà une stagnation qui fait plaisir à voir ! Après deux années de hausse, les émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie ont cessé d'augmenter en 2019, selon les derniers chiffres publiés, mardi 11 février, par l'Agence internationale de l'énergie (AIE).
Comme l'expliquent les Echos, l'AIE comptabilise la production d'électricité, le chauffage et la climatisation, ainsi que les transports et l'industrie parmi le secteur énergétique.
33 milliards de tonnes de CO2 ont ainsi été émises l'an dernier, comme l'année précédente. Ce, malgré une croissance économique mondiale de 2,9%. Parmi les raisons de cette stagnation : « la part croissante des énergies renouvelables (principalement éolienne et solaire), le passage du charbon au gaz naturel, et une plus grande production issue du nucléaire », explique l'AIE.

Aux Etats-Unis, les émissions produites par le secteur énergétique ont décru de 2,9%. La baisse est de 5% dans l'Union Européenne. Au Japon, celles-ci ont chuté de 4,3%. Mais le pays a annoncé la construction de 22 centrales au charbon dans les cinq prochaines années. Dans le reste du monde, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté.
Certains, dont l'AIE, se prennent à espérer que 2019 constituera un pic dans les émissions mondiales, qui baisseront ensuite inexorablement. « L'humanité est toujours en route pour l'enfer, mais nous avons levé le pied de l'accélérateur », estime, pour sa part, Laszlo Varro, l'économiste en chef de l'AIE. A lire dans les Echos.

Après Lubrizol, la prévention des accidents industriels renforcée
Les leçons de Lubrizol auront-elles été retenues ? L'incendie de l'usine de produits chimiques, en septembre 2019, a révélé de nombreuses failles dans la gestion des sites industriels dangereux. Mardi 11 février, le gouvernement a annoncé une série de mesures pour améliorer la prévention des risques industriels.
En 2018, seules 18 000 inspections avaient été menées sur les 500 000 installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) que compte la France, sites qui peuvent présenter des risques sanitaires et écologiques. Parmi ceux-ci, un peu plus de 1300 sont estampillés Seveso, en raison d'un niveau de danger potentiel plus important. En 2006, 30 000 contrôles étaient réalisés chaque année.
La ministre de la transition écologique, Elisabeth Borne, a promis une augmentation de 50% des contrôles sur les sites industriels d'ici 2022. Comme cela existe dans l'aviation, un bureau d'enquête « indépendant » devra identifier les causes des accidents industriels. Les sites Seveso « seuil haut », les plus à risques, devront réaliser tous les ans un exercice de mise en œuvre de leur plan d’urgence. Enfin, les industriels devront tenir à jour une liste des produits dangereux présents sur leur site. A lire dans le Monde (AFP).

Le Delta de l’Ebre menacé par les tempêtes et par les humains
En Espagne, la plus grande zone humide du bassin méditerranéen est menacée de toutes parts. Tempêtes, surexploitation et érosion des côtes risquent de rendre infertile le riche delta de l'Ebre.
Les vents violents de la tempête Gloria, qui a frappé le sud de l'Europe à la fin du mois dernier, ont envoyé des vagues jusqu'à 30 mètres à l'intérieur des côtes du delta, situé à 175 kilomètres au sud de Barcelone. Rizières et canaux d'irrigation ont été submergés d'eau de mer, qu'on a retrouvée jusqu'à trois kilomètres à l'intérieur des terres, comme le raconte le Guardian.
« Le delta est un équilibre entre le fleuve et la mer, et depuis quelques temps, c'est la mer qui l'a emporté », résume le représentant des producteurs de moules au quotidien britannique.
L'écosystème du delta de l'Ebre est mis en péril depuis des années par la surexploitation du fleuve du même nom. 181 barrages ont été implantés tout au long de son parcours, retenant les précieux sédiments qui abritent une part de la biodiversité et protègent les côtes de l'érosion.
Les habitants et producteurs du delta craignent d'être frappés par une nouvelle tempête alors que la réparation des dégâts de Gloria n'est pas achevée et qu'ils n'ont « plus rien pour retenir la mer », des mots d'un cultivateur de riz. A lire dans le Guardian.
Les stations pensent à l'après-ski
Alors que commencent les vacances d'hiver pour une partie des Français, les stations de ski sont bien obligées de constater que la neige les déserte de plus en plus souvent.
L'intégralité du domaine skiable des Vosges est fermée. La région Grand-Est n'a connu que deux épisodes de neige depuis le début de l'hiver, comme le rapporte 20 Minutes. Dans les Pyrénées, plusieurs stations ont connu la même pénurie de neige.
La limite d'altitude à laquelle la pluie se transforme en neige est en train de grimper aussi vite que le mercure. Les températures augmentent plus rapidement en altitude qu'en plaine : on attend par exemple une hausse de 1°C à 2,7°C degrés en moyenne d'ici à 2030 dans les massifs des Pyrénées, selon une étude de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique.
Si, contre toute logique, certaines prévoient de s'implanter de plus en plus haut pour y trouver de la neige, de plus en plus de stations se cherchent un avenir. En Haute-Garonne, le conseil départemental a repris la gestion de trois stations pyrénéennes en 2018 et prévoit d'y investir 25 millions d'euros en cinq ans pour passer à des activités « quatre saisons », rapporte France Inter. Randonnée, fitness, spa, luge toutes saisons... les stations de montagne sont condamnées à soigner leur dépendance à la poudreuse alors qu'aujourd'hui, un tiers de la neige skiée dans les Alpes est artificielle.

Rallier les profs à la cause climatique
Face à l'accumulation de preuves de la catastrophe, certains jeunes, lycéens ou étudiants, ne comprennent pas le peu d'engouement de leurs professeurs pour la cause climatique. Ils leur font savoir dans une forte tribune, publiée mercredi 12 février dans le Monde.
S'il louent l'engagement de leurs enseignants dans la bataille contre la réforme des retraites, les signataires s'émeuvent de ce que la crise climatique ne les pousse pas encore massivement dans les rues.
« L’âge moyen des enseignants aujourd’hui est de 43 ans, écrivent encore les auteurs de la tribune. Or, selon les projections actuelles, quand nous aurons atteint cet âge, vers 2045, le monde sera à 2 degrés, voire 3 degrés de réchauffement par rapport à l’ère préindustrielle […]. Qui d’entre nous est assez naïf pour s’attendre à prendre sa retraite vers 2070 dans un monde à + 5 degrés ? ».
Les signataires implorent leurs aînés : « Nous ne comprenons pas pourquoi il en est ainsi alors que nous avons désespérément besoin de votre aide […] que vous pesiez de tout votre poids pour forcer une action politique comme vous le faites pour les retraites […] que vous vous engagiez massivement contre la crise climatique, comme si nos vies étaient en jeu, parce qu’elles le sont. » A lire sur le site du Monde.

L'agrandissement de l'aéroport de Bristol n'aura (probablement) pas lieu
Il n'y aura probalement pas de ZAD à Bristol. Dans le sud-ouest de l'Angleterre, des élus locaux ont rejeté un projet d'extension de leur aéroport pour des raisons écologiques.
Par 18 voix contre 7, le conseil du North Somerset a refusé que soit agrandi l'aéroport de Bristol. En 2011, ses propriétaires avaient obtenu l'autorisation de faire passer la capacité de 7 à 10 millions de voyageurs annuels et l'objectif, à terme, était d'atteindre les 12 millions. Le projet devait voir la construction de 3000 places de parking, une extension d'un terminal et du réseau de navettes.
« Le conseil a considéré que les effets néfastes de l'extension de l'aéroport sur [la zone alentour] et, plus largement, sur l'environnement, surpassent les minces bénéfices » potentiels, a expliqué le président du conseil, à l'issue de la séance.

Une décision applaudie par les militants écologistes qui s'étaient mobilisés pendant les trois jours précédent le conseil. Extinction Rebellion avait organisé une opération « autruche », pour symboliser l'aveuglement des partisans du projet.
Le processus juridique n'est toutefois pas terminé et des recours sont encore possibles, mais cette décision prise par des élus locaux marque un coup potentiellement fatal à ce projet. A lire dans le Guardian.

Du sable sur les mains
Il n'y a pas que dans le delta de l'Ebre que les sédiments viennent à manquer. 40 à 50 milliards de tonnes de sable sont extraites chaque année. L'appétit insatiable du secteur de la construction provoque érosion des côtes et des lits de fleuves, corruptions mafieuses et mise à sac d'écosystèmes, comme l'explique Datagueule dans son épisode intitulé « A feu et à sable ».